Chercheurs à la BU : Joëlle
Deniot - Édith Piaf La voix,
le geste, l'icône
JEUDI 7 novembre 2013*
14 h Campus Tertre
BU Lettres, Sciences humaines
et sociales (salle de formation
au 1er étage).

Bibliothèque Universitaire Lettres Sciences Humaines.
Bonjour,
La
conférence est accessible sur la
Webtv de l'université
http://webtv.univ-nantes.fr/fiche/3998/joelle-deniot-edith-piaf-la-voix-le-geste-l-icone
Si vous souhaitez en obtenir une
copie, il faut vous adresser au
PAM
pam@univ-nantes.fr
Bien cordialement, Laure
Teulade
Cette conférence accompagne
l'exposition éponyme organisée à
la Bibliothèque universitaire de
droit, d'économie et de gestion,
du 9 octobre au 15 novembre.
Mireille Petit-Choubrac,
diplômée de l'École des
Beaux-arts de Toulouse,
actuellement plasticienne dans
la région de Saint-Nazaire,
exposera plus de quarante
encres, gouaches, fusains
originaux consacrés à Édith Piaf
dont nous célébrerons en
octobre 2013 le cinquantième
anniversaire de la disparition.
Ce travail d'artiste qui, tout
de noir et blanc, évoque les
visages et la performance
chantée de Piaf, présente la
particularité de s'articuler -
coopération rare dans la
recherche universitaire - à
l'analyse que Joëlle-Andrée
Deniot, professeur de sociologie
à l'université de Nantes,
consacre aux langages
scéniques de la célèbre
chanteuse et à ceux de quelques
autres grandes voix féminines
qu'elle inspira.
Ces deux perspectives sont
réunies dans l'ouvrage intitulé
EdithPiaf : La voix, le
geste, l'icône.
Esquisseanthropologique,
publié en 2012 à Paris, aux éditions Lelivredart.
À l'issue
de la conférence, l'ouvrage
pourra être acheté auprès de la
librairie Durance, présente à
cette occasion.
Dernières publications :
-
Edith
Piaf : La voix, le geste,
l'icône : Esquisse
anthropologique
- Lelivredart 2012 (voir
la disponibilité à la BU)
-
Corpographies
d'une voix : Piaf, la
passionaria de la chanson
française,
sous la direction de B.
Lebrun, l'Harmattan. 2012
-
Le rêve
noir, hantise, corps, corpus,
sous la dir. de J. Deniot et
J. Réault, avec L. Delmaire),
Lestamp 2012
-
Les formes
orphiques et sociales de la
transmission chansonnière
: Douai, Bertin, Forcioli,
PU Bordeaux 2011
Les rendez-vous
Chercheurs à la BU consistent à
faire intervenir nos chercheurs
à la Bibliothèque Universitaire
pour présenter le sujet de leurs
recherches, en 1h environ.
Ces rencontres sont ouvertes à
tous.
"
|
 Images
pour une voix Images
pour une voix
Le langage scénique d’Edith
Piaf*
Joëlle-Andrée Deniot
Université de Nantes-
Habiter-Pips - UPJV
*
Cet article est
extrait de J. Deniot, J
Réault (Editeurs) avec L.
Delmaire,
Espaces Temps et Territoires,
Cahiers du Lestamp-Habiter-Pips
N° 2.
Nantes Lestamp-Edition Mai
2010,pp 234-257
Copyright mai 2010. Tous
droits réservés. Disponible
à la B U de l'Université de
Nantes et à l'UFR de
sociologie. |
« L’espace tout ébranlé, qui
nous touche ne veut de notre
être que l’ouïe. »
Rainer Maria
Rilke,
Chant
éloigné
Editions Verdier, 1999
C’est par le choix de
traitement d’une figure iconique -
Édith Piaf - ayant marqué le siècle
dernier, puis aussi par le choix
d’un support d’approche – celui des
« performances » archivées sur
documents audio-visuels – que
j’ai décidé de condenser, sous forme
d’un livre, une bonne part des
réflexions, investigations,
observations que je mène sur la
chanson et la voix depuis plusieurs
années déjà. Cette optique prise, je
la qualifierai comme étant celle
d’une ethnologie, d’une
ethno-esthétique du geste chanté.
Cet accès au sujet par les images
de la voix permet de faire
entrer dans l’espace, la voix, le
chant, eux qui n’existent que
dans l’écoulement de la durée ;
ainsi rapatriés dans l’espace, ils
entrent dans la pensée de l’œil et
en conséquence, peut-être (bien que
de façon toujours imparfaite) dans
les dimensions mentales et
discursives de la
Raison
graphique.
L’espace
fugitif et bruissant des chansons
Les chants sont des images
labiles du temps. Comme toute
musique, les chansons incarnent cela
d’abord dans leur propre matérialité
mélodique et rythmique. Mais
au-delà du signifiant sonore, les
chansons s’accordent à une
sémantique temporelle. Temps
affectif de la mémoire, temps épique
du récit, de l’histoire,
scansion des cycles cosmiques,
coutumiers, langage de l’anecdote,
des chroniques, proto-langage des
berceuses inaugurales que « votre
mère vous chantait »… la
liste est difficile à clore
lorsqu’il s’agit d’évoquer cet
arpège des temporalités
passant dans l’air des chansons qui
disent aussi l’hypnose des modes et
l’enthousiasme de l’instant.
Plus
paradoxal et surtout moins essentiel
d’allier voix, chant et espace…
C’est pourtant sur ce point qu’ici
nous allons insister en nous
demandant, en un premier temps, sous
quelles formes pertinentes chansons
et territoires peuvent-ils se
rencontrer et en un second temps,
comment cette rencontre s’est-elle
réalisée, manifestée dans l’exemple
d’Edith Piaf qui, à l’instar de Brel
se consumant au feu jailli de sa
bouche,
serait – si l’on en croit Daniel
Bougnoux, spécialiste de la chanson
française et francophone – une de
ces rares chanteuses ayant
à ce
degré confondu les planches avec un
bûcher.
Certes
le paradoxe n’est pas mince. D’un
côté, un monde taillé dans les
souffles, les feulements,
les rumeurs des mots, un monde
vibrant dans l’air, un monde à peine
né qu’évanoui, celui de la durée
furtive que les collecteurs eurent
tant de mal à capter, et dont ils
ont toujours tant de
mal à retrouver
l’écho.
De l’autre, un
monde couturé
d’empreintes, d’inscriptions et de
traces, celui de l’espace, ce
premier conservatoire si concret des
cultures.
Pourtant
le maillage, sur plusieurs registres
et à différents niveaux de
complexité, de ces deux éléments
fort peu semblables ne fait aucun
doute. En effet, que les chansons
aient à faire avec le « propre d’un
lieu » toute l’histoire de la
chanson française (je me limite à
cela, car telle est la limite de mon
terrain d’investigation) en
témoigne.
La
patrie, c’est un drapeau, c’est un
hymne. Chansons de village scandant
les activités, les fêtes, les drames
dans la civilisation paysanne,
chansons d’escales dans les métiers
de la mer et du fleuve, chansons des
forges, chanson de la mine dans
l’univers ouvrier, chansons de rues
– celles du
prolétaire du XIXème
siècle, celles du rappeur de ce
début du XXIème siècle
– chansons de routes du compagnon,
chansons de déroute du chemineau,
chansons de barrières du Paris
pittoresque et voyou d’Aristide
Bruant… le territoire hante le chant
des hommes. Il est une de ses
grandes sources inspiratrices.
Ce
supra-langage de l’événement en tous
genres que furent les chansons dites
de tradition orale, mais autrement
dit, celles d’avant le triomphe de
la scène sur le vivant, parle
toujours d’événements certes locaux
mais surtout susceptibles d’être
indexés à une situation, à la
spécificité d’un lieu. Au plus
simple mais au plus fort aussi, de
cette rencontre entre voix et
espace, il y a donc la chanson comme
puissance captatrice, force
amplifiante de symboliques
territoriales. Á feuilleter
de récents travaux de collecte, en
l’occurrence sur la Sarthe,
et à ne même regarder que les titres
de chansons nées entre la fin du XIXème
siècle et l’immédiate période
d’après la seconde guerre mondiale,
on saisit qu’elle déploie comme un
écheveau d’identifications
proxémiques.
Cet
amour familier, complice de l’ici
qui fait sens et lien
est au cœur des chansons. Que lit-on
en effet, dans ce bouquet sarthois
de chansons précédemment évoqué.
Cueillons au hasard quelques
titres : Allons tous à Malicorne,
Ligron, La p’tite mancelle, La
chanson de Coulaines, La joie de
vivre à Fresnay, Les filles de
Saint-Aubin, Les empoisonneuses de
Bouloire, Les gars de Dollon, La
Braderie du Mans, Les sabots de
Pontvallain, Je suis d’Assé le
Boisne, Chanson du curé de Chemiré
en Chamie… C’est une vraie leçon
de géographie, les chansons
s’égrènent là, de lieu en lieu,
peut-être emboîtent-elles le pas des
colporteurs, des marchands
ambulants… En tout cas, elles
redoublent et réinventent la
mémoire toponymique.
Á l’inscription des lieux-dits,
de leurs bornes, s’ajoutent échos et
résonances des lieux chantés.
Toutefois le fait que la chanson
soit un des supports favoris
d’expression et d’exercice de la
symbolique territoriale, n’est pas
le seul point de rencontre entre
spatialité et cantillation.
Toute chanson n’existe « vraiment »
qu’en acte, autrement dit toute
chanson n’existe que liée à un
espace d’écoute qui infléchit et
l’horizon de son interprétation et
l’horizon de sa réception. Cet
accommodement du chanter à la
morphologie spatiale s’illustrent de
plus sur les différents registres de
pose et d’écoute de la voix :
registre matériel, registre
phénoménologique et registre
imaginaire.
Matériellement tout lieu où l’on
chante, où l’on a chanté (place,
rue, cour, église, mais aussi café,
taverne,
caveau, salle de réunion, de
meeting, de récital) s’appréhende
d’abord comme
forme d’habitacle de la
voix ; est d’abord à
considérer comme enveloppe
acoustique contraignant des modes de
projection vocale, de
réflexes et de ressentis
interprétatifs. Les chansons
s’imprègnent du lieu, puis la voix
repère le lieu, en délimite un mode
de connaissance et de maîtrise. Ce
qui fait d’ailleurs penser et dire,
entre anthropologie et éthologie, à
certains musicothérapeutes
que chanter en son expérience
cruciale, c’est peut-être renouer
avec une pratique immémoriale,
mammifère ou cétacée, qui consiste à
marquer sinon la possession, du
moins la traversée du lieu et que la
musique, traversée d’un certain
nombre de lieux, serait géographie
humaine avant d’être histoire et
d’avoir une histoire.
Mais à
la différence des dauphins balisant
leur espace océanique « des bips »
suraigus de leur sonar, notre
perception est toujours mythique
Dans ce rapport de la chanson, de la
voix chantée à la forme et à
l’étendue du territoire, il y a
l’espace comme enveloppe acoustique,
mais il y a également l’espace comme
manteau de symboles. Le ravissement
des chansons s’éprouve à la
confluence des deux.
Ainsi
l’espace inscrit dans la voix des
chansons est-il toujours également
une figure d’espace, une espèce
d’espace culturellement signifiantes
et comme telles menant vers des
pentes stylistiques qui appellent
une gamme de messages chantés,
certains types d’adresse (plus ou
moins fusionnelle, familière,
liturgique) aux passants, au peuple,
aux fidèles, aux publics rassemblés.
Chanter dans la rue même après la
disparition des chanteurs de rues,
même dans le fil de la dernière mode
des « arts de rue », c’est malgré
tout adopter un grain de voix et un
ton musical qui ne peut pas faire
abstraction du passé, même
stigmatisé, même enfoui.
Ainsi en est-il quand il s’agit de
chanter dans une église même en mode
profane, même après laïcisation du
lieu
La forte
et multipolaire territorialisation
de la chanson constitue ce que l’on
pourrait appeler, sa tendance
anthropologique lourde.
Chansons de tous, chansons de
saltimbanques, chansons d’artistes…
elles témoignent toutes de leur
ancrage dans des cultures locales
et/ou nationales. Toutefois la
prééminence croissante en quantité
et en valeur des supports
technologiques dans la production
musicale tend actuellement vers sa
totale déterritorialisation.
Dématérialisation de l’espace
d’écoute ou du moins nomadisme de
cet espace, dédifférenciation de
l’interprète, standardisation de la
langue et homogénéisation des
rythmes, au-delà de la
multiplication de sous-genres, de
l’artefact de styles dérivés : tout
converge à fabriquer de la « chose
musicale » hors sol ;
l’investissement récent des majors
dans la livraison clefs en mains de
spectacle tous terrains en est
peut-être la phase ultime.
Edith
Piaf, elle qui chante dans les rues
de Belleville, qui débute au Gerny’s
de Louis Leplée, elle que
l’on consacre vedette inimitable à
l’A B
C
sous l’occupation,
elle qui concourt, de 1955 à 1963, à
la légende de l’Olympia, cette
ancienne institution du music-hall …
appartient bien au récit national de
la chanson et du spectacle. Par les
personnages du peuple parisien
circulant dans ses refrains, surtout
ceux de ses débuts, encore très
empreints de référence mimétique aux
langages de la chanson réaliste, par
la performance très physique de ses
récitals, par l’extrême éloquence de
sa présence scénique, Edith Piaf est
bien une figure exemplaire de ce
monde de la chanson
territorialisée.
Son étude est alors
d’autant plus pertinente que
paradoxalement, c’est à l’heure des
cultures
de la musique
hors sol, que l’on cherche à
réveiller son mythe, comme en
témoignent, inépuisable glose
inspirée de l’original, les
nombreuses reprises de son
répertoire et récemment même le film
très médiatisé d’Olivier Dahan.
Ce lieu
d’ombres et de ténèbres que nous
appelons
une scène…
C’est Pierre Legendre,
revenant à l’étymologie du mot
skéné, skotos qui avance cette
idée de scène, à ne plus seulement
penser comme estrade, architecture
de déroulement du spectacle, mais
comme paradigme spéculaire
dont se dotent les sociétés ;
paradigme spéculaire initial
instituant, en toute civilisation,
une normativité de la rencontre du
subjectif et du social, une
normativité des identifications au
grand Sujet (dirait Dany-Robert
Dufour).
Ce sont les scènes-sources de
l’Etat, du droit, de l’art et de
leurs montages discursifs, que
désigne là Pierre Legendre. Il y a
donc à dissocier « petite » et
« grande » scène, car cette idée de
P. Legendre me paraît féconde.
La
scène, c’est l’espace matériel aux
importantes mutations historiques
variant au fil des métamorphoses
technologiques et plasticiennes ; la
Scène, c’est l’espace logique, hors
temps fondant la fiction d’un sujet
monumental,
instituant un lieu
d’inscription d’enjeu de
représentation qui ne sont pas ceux
du sujet particulier,
fondant un langage qui relève de la
problématique générale de
l’identité, une langage garant d’une
transcendance sociale.
Café-concert,
music-hall, cabaret… autant
de formes historiques d’accueil du
divertissement et de la chanson. Le
XXème siècle les voit
naître, prospérer et/ou décliner.
D’origine hexagonale, d’origine
anglo-saxonne, chacune de ces salles
essentiellement urbaines, d’abord
parisiennes et marseillaises, pour
une moindre part, ont déjà, avant la
venue de Piaf à la lumière, donné le
ton du loisir populaire dans le
premier tiers du siècle. Chacun de
ces espaces a déjà configuré, selon
des logiques de genres et de styles,
des modes d’insertion, des modes
d’écoute de la chanson dans
l’économie spectaculaire socialement
très hiérarchisée
des villes. Lorsque la môme Piaf
débute sa carrière, l’univers du
caf’conc’ s’efface, remplacé par
celui du music-hall où elle
réalisera ses plus grands tours de
chants. ABC, Bobino,
Folies-Belleville, Olympia sont ces
terres d’élection ; les salles de
cinéma du Coliseum, du
Gaumont-Palace également.
Curieusement les mondes new-yorkais
de l’art feront (et font toujours)
d’elle, l’emblème de ce que l’on
nomme outre-atlantique « chanteur,
chanteuse de cabaret », lieu où elle
se produira pourtant que très peu en
France et très peu aux Etats-Unis,
puisque c’est au Carnegie Hall
qu’elle subjugua le public
new-yorkais.
Or cet
« étrange » décalage nous met en
dialogue avec les propositions
Legendriennes, différenciant schème
pratique et schème logique de la
théâtralisation, car Piaf n’advient
pas à n’importe quel moment, dans le
procès de stylisation des chansons.
En effet, le miroir des chansons ne
relève plus du même domaine
mental dès lors que la voix chantée
des rengaines, des complaintes, des
romances ne se donne pas seulement à
entendre (comme c’est le cas dans la
rue, dans les sociétés chantantes,
les cafés, le caf’conc’ etc…)
mais dès lors qu’elle se donne
également à contempler dans
l’éloquence d’un visage, d’un
corps-signe.
Ce
glissement de la chanson vers le
geste total de l’interprétation
correspond dans le même temps à son
entrée dans l’ère de la fascination.
Cela s’amorce avec Yvette Guilbert,
s’affirme et s’affine avec Damia,
notamment. Edith Piaf arrive dans le
sillage déjà confirmé de cette
chanson artisanalement scénographiée,
combinant dans l’écoute, espace
acoustique et espace visuel, art de
la présence vocale et art du
corps musical signifiant. Piaf qui
est issue de l’expérience plus
immédiatement jaillissante de la rue
aura d’abord du mal à se soumettre à
ces médiations dramaturgiques, mais
c’est elle qui pourtant, portera à
son point d’orgue, ce geste total de
la voix vue s’échappant des passions
de l’âme.
Et si
Piaf est contemporaine de cette
confrontation de la voix aux
cultures du regard, elle l’est aussi
d’un changement de registre
cathartique des chansons,
passant désormais par
l’identification directe aux
bonheurs, aux malheurs de
l’interprète.
La
requête d’authenticité a fait son
apparition dans l’horizon d’attentes
des auditeurs-spectateurs. Au-delà
du personnage, la personne est
conviée à s’exposer.
C’est un autre mode de
subjectivation de l’expérience
sociale
qui cherche là son langage.
Ce dernier naît avec la chanteuse
réaliste Fréhel, il s’amplifie avec
Piaf, connaît son âge classique
durant la période considérée comme
« âge d’or » de la chanson
française. La notion d’interprète
devient en ce cas d’ailleurs, plutôt
ambiguë puisque l’on est là entre
persona scénique, visant
composition et cohérence
stylistiques autour d’un répertoire
et « théâtre pauvre »
visant le dépouillement, la
confidence à vif de soi.
Plutôt que d’endosser personnages et
récits des chansons, il s’agit
d’incarner le chant même de sa vie.
Reste
que maintenir à la fois une
esthétique cantologique tournée vers
la beauté de la voix et une ascèse
de dévoilement personnel, tourné
vers des ébranlements
émotionnels et psychiques, relève
d’une incroyable gageure, tant ces
deux niveaux peuvent même sembler
antithétiques. Un des éléments de la
grâce d’Edith Piaf s’appuie sur une
telle tension, sur ce jeu
d’équilibre toujours risqué et
souvent réussi. Piaf sur scène
crée l’immensité intime.
Et c’est par ce biais, par cette
dimension cachée, par cette
dimension poétique de l’espace, que
Piaf qui n’aura que rarement chanté
dans des lieux feutrés pour initiés,
pourra, peut encore être appréciée
comme figure tutélaire de l’art du
cabaret,
vu de New-York d’abord comme échange
intense, face à face privilégié avec
l’auditoire.
|
|
 |
 |
|
1-Edith Piaf,
Olympia, 1961 |
2-D'après Juliette
Greco,
La rose Noire,
1950 - Dessin de JD. |
|
Costume de scène noir (Ferré,
Barbara, Gréco, Mouloudji)
s’opposant à « l’habit de lumière »
des chanteurs de Music-hall, les
artistes historiques du cabaret,
cultivent cette esthétique du
dépouillement qu’intensifie
l’étroitesse du cercle des
auditeurs. C’est dans ces salles de
petite échelle que s’ajustent, en
gammes ironiques ou graves,
interprètes et publics s’éprouvant
les uns les autres. Dispositif
spatial d’exhibition et sceptre
imaginaire de la représentation
tendent à coïncider, comme c’est
souvent le cas, et ce pour concourir
à l’épanouissement d’un genre
spectaculaire spécifique.
Piaf est
plus universelle, plus singulière,
plus extrême. Elle, c’est au
music-hall qu’elle portera l’habit
noir ; c’est hors échelle, hors
creuset du récital de proximité (à
la différence des chanteuses
réalistes qui la précèdent, elle
adopte immédiatement le micro)
qu’elle se fera voix-sujet de
vérités inouïes, voix-sujet
d’alarmes sans recours.
L’immensité intime voguant sur
les vagues du souffle d’Edith Piaf
est aussi d’une autre nature. La
persona scénique d’Edith Piaf
installe un espace signifiant qui
pour être intime, n’en n’invite pas
pour autant à la confidence : le
chant de Piaf sera toujours porté
par les réminiscences de sa voix de
rue, traversé par les énergies d’une
fureur non domestiquée. La
persona
scénique d’Edith Piaf, dans le
même ordre d’idée, n’invite pas non
plus à la connivence :
l’Amor Fati qui parcourt ses
chansons ne se partage pas sous ce
mode. Son esthétique, son être de
scène invite plutôt au partage
tremblant d’un rite sacrificiel, à
l’immersion dans une immolation
vocale, dédiée à quelque divinité
implacable, dans l’enceinte d’un
grand théâtre antique.
L’espace
convoqué par le chant de Piaf est
d’abord invisible car il est
d’abord mythologique. Aucun lieu ne
peut vraiment le contenir, car « cet
invisible »requis transcende
aussi tout ancrage. C’est Piaf qui
fait de l’Olympia, une légende et
non
l’inverse. C’est Piaf qui
donne au cabaret new-yorkais son
aura et non
l’inverse.
On a pu écrire que le
cercle magique de la scène (piste de
cirque, amphithéâtre ou simple halo
lumineux) contient toujours le
lointain rappel anthropologique d’un
temps violent des offrandes sacrées.
Jamais métaphore de l’espace
scénique comme modèle réduit de
l’autel des sacrifices ne fut plus
juste qu’avec Edith Piaf ; elle qui,
dans ses dernières années, chercha à
littéralement se perdre dans son
chant ; Quel lieu peut se
montrer à la mesure de cela ?...
Peut-être aucun ? Peut-être
tous ?…Puisque c’est dans les
passages secrets d’une scène
méta-physique que cette émotion se
déploie.
Ce
hiatus, souligné par la personnalité
vocale de Piaf, entre espace concret
et espace mythologique des chansons,
nous amène à reposer la question de
leurs rapports aux territoires, la
question du mouvement passé, présent
de leur territorialisation et
détérritorialisation. En effet,
Edith Piaf, outre le fait qu’elle
chante dans un période d’essor de la
chanson française dont les vedettes
s’exportent avec succès, semble se
situer à une charnière ou plutôt
dans un entre deux. D’un côté
symbolique, dynamique, emprise du
lieu, comme nous l’avons dit
précédemment, sont bien au centre de
son personnage évocateur d’un
quartier, d’un ancrage social, d’une
ville, d’un peuple, d’une langue,
d’un accent, d’un
patrimoine. D’un côté, elle
est bien cette voix signée de
multiples territoires. Mais c’est
aussi le dépassement de l’ici et
maintenant qui en fait la signature.
C’est alors un effacement du
territoire au profit d’une échappée
dans les étoiles qui s’affirme dans
ses chansons, dans leur durée
diffuse autour du monde.
Pourtant, s’il y a bien une synergie
interne de déterritorialisation des
chansons en général
depuis qu’elles ne sont plus
fondamentalement liées à l’oralité
des cultures d’ailleurs, il faut se
demander à quel type de
déterritorialisation avons-nous
affaire ? Celle évoquée à propos
d’Edith Piaf relève davantage d’une
capacité du singulier à
s’universaliser et à se pérenniser,
celle de la chanson contemporaine de
nulle part, de nulle demeure
langagière,
qui s’impose par toute une série de
médiations technologiques
sophistiquées est d’un autre type.
Cette dernière est au contraire,
déterritorialisée par abstraction
têtue, mercantile ou militante -
mais l’une renforce l’autre- de
toute référence.
Si le
tour de chant d’Edith Piaf était
virtuellement inséré dans un espace
mythologique, Piaf chantait pourtant
bien plantée au sol, s’éloignant
rarement du micro, restant donc
amarrée à un espace localisé
restreint ; comme s’il fallait
réduire l’espace théâtral du chant
au seul territoire densément
approprié du corps de l’interprète,
à ce seul espace tout saturé de
gestes empathiques, elliptiques,
souterrains, narratifs pour que le
rituel scénique s’accomplisse au
plus haut de sa puissance.
Calligraphies
d’un souffle
Comme nous le signalions au
début de ce texte, les voix, les
chants qui s’écoulent comme l’eau,
ne sont pas aisément
conceptualisables. Tout symbolisme
intonatif bien que ressenti et perçu
comme tel, est difficile à
verbaliser. Le sonore, le
vocal,
la durée ne s’appuient pas
sur des traditions de lexique
stabilisé.
De
même qu’il faudrait des larmes pour
évoquer les larmes, comme
l’écrit Jean Loup Charvet,
de même faudrait-il des mélodies
pour évoquer les chants,
peut-être une chanson pour évoquer
la chanson. Toute voix abolissant en
quelque sorte le langage.
Pour
comprendre et décrire une voix, nous
pouvons pourtant nous aider de la
lumière, en décrire la réverbération
dans la mobilisation sensible du
corps de l’interprète.
Peut-être n’y a-t-il de
linguistiquement discernable,
d’analytiquement exprimable que
l’espace visuel de la voix ?
Peut-être faut-il se résoudre à
seulement capturer la voix dans
l’image, à raisonner cette dernière
qu’indirectement, dans le miroir du
visage et des gestes, tout en se
sachant là au seuil de l’indicible.
En effet, dans l’espace de l’image,
nous retrouvons les langages rodés
de la couleur, du dessin, de la
cinétique, de la chorégraphie, de la
sculpture, arts et techniques du
trait, du pas, du plan, du volume
dont notre civilisation de
l’œil est plus philosophiquement,
plus logiquement et métaphoriquement
maîtresse.
En dépit
d’une certaine économie
démonstrative dans l’éloquence
visuelle de la voix – à la
différence, par exemple, d’une Damia
qui la précède ou d’une Juliette
Greco qui viendra plus tard –
Edith Piaf s’inscrit bien toutefois
dans cette logique scénique
de la voix imagée ; elle s’y inscrit
d’ailleurs si nettement qu’elle doit
même au lyrisme muet de ses
postures, de ses mains, de ses
yeux…une grande part de son
iconicité d’interprète. Pas d’icône,
sans déité certes. Mais pas d’icône
non plus sans adhésion de l’œil à de
grands portraits lumineux. Affiches,
photos de presse, dessins,
lithographies, montages filmiques
ont tant souligné sa silhouette, la
spiritualisation de son regard dans
son chant, l’expressivité grave de
sa physionomie d’enfant, de jeune
femme, de femme noyée…qu’il est
désormais difficile d’éprouver
l’esthétique de Piaf en aveugle,
faisant abstraction de toute cette
fresque de reflets et de doubles.
La voix
de Piaf fait signe, nous fait signe,
preuve en est dans cette
graphématisation constante que sa
personnalité vocale ne cesse de
provoquer : amateurs de
croquis à main levée – Jean Cocteau
lui-même –, coloristes, peintres
cherchèrent, cherchent à transposer,
décrypter l’épure de Piaf et ce
jusque sur son lit de mort. Peu de
chanteurs ou chanteuses sont
parvenus à susciter autant d’ardeur
polygraphique. Seul Léo Ferré
dont les spectacles étaient voulus
comme d’authentiques représentations
et drames picturaux peut en ce
point, lui être comparé.
Voir
la voix, c’est en fin de compte
écouter l’image,
écrit
Louis Marin.
Le son est la lumière sous une
autre forme, l’une et l’autre
procèdent de vibrations, écrit
Balzac. Chacun de dire qu’il est des
paroles, des larmes, des éloquences
de l’âme
où l’auditif et le
visuel intercèdent l’un pour l’autre.
Les chansons de Piaf sont de cette
étoffe-là …de celle où les
longs échos…de loin se confondent,
de celle où dans …la ténébreuse
et profonde unité, vaste comme la
nuit et comme la clarté, les
parfums, les couleurs et les sons se
répondent.
Un élan ascensionnel de la voix, des
voilements plus subtils que le son,
un flux d’invocation diffus dans
tout le corps, effleurant les nerfs
et la peau, tout est en osmose chez
la chanteuse. Le territoire du chant
de Piaf s’appuie sur tous les
registres kinesthésiques de
l’espace ; ce chant premier, ce
chant voyant, épris de sa voix se
donne volontiers à entendre dans la
lumière.
Seule, debout, face au public…
la lumière sur la voix, c’est
d’abord une toile de fond, une
silhouette, une couleur. Ce n’est
pas immédiatement que Piaf adopta
son fameux costume de scène sombre
comme le firent les chanteuses et
chanteurs de la Rive Gauche. Elle
apparaît encore sur quelque scène du
début jusqu’en 1937, avec le tablier
de gigolette, elle prend parfois des
accessoires, foulard et manteau,
dans Elle fréquentait la rue
Pigalle à l’ABC en 1941,
superposant ainsi à la fiction de
l’espace scénique, un autre espace,
celui de la rue, y glissant sa
mémoire des anciennes galères. Mais
dès les récitals de 1937, Edith Piaf installe
l’espace calligraphique de son
chant. La couleur, c’est le noir,
c’est le soir. Noir de la robe ;
noir du fond de scène ; noires les
chansons ; noire la sève des fêlures
qui en guide l’entrain. Blême,
l’éclairage l’encerclant de son
écrin.
|
 -3
-3
|
La toile… d’où sa voix
surgit, s’échappe, se
détache, chavire, est un
espace d’ombres.
J’ai longtemps vécu dans
les ombres des branches
et mon cœur n’y est que
tremblements de feuilles
écrivait Fernando
Pessoa ; j’imagine bien
la parenté de cette
phrase avec la poétique
du dispositif scénique
d’Edith Piaf. D’un côté,
l’intonation
incandescente, tout à
son espace céleste, avec
cet air de revenir d’un
songe, d’un voyage
lointain au sortir de
chaque chanson, de
l’autre, une esthétique
figurative précise
visant à donner corps et
scintillement de chair à
la chanson. Le langage
scénique de Piaf est
ambivalent ; c’est entre
l’espace brisé de
l’affect musical sans
image et l’espace
retrouvé d’une
expressivité gestuelle
exigeante qu’il se
déploie.
Espace brisé
dans la voix-sanglot des
dernières notes de
l’Accordéoniste lorsqu’elle
dissimule son visage sous son bras
violemment replié et que toute
musique immédiatement se tait.
Espace brisé quand elle se
replie, fermant les yeux, au plus
profond des ciselures intimes de sa
voix, dans les montées mélodiques ou
les refrains de L’hymne à
l’amour, de La vie en rose,
de Mon légionnaire, des
Mots d’amour, de T’es beau,
tu sais etc…
Quand dans les dernières
mesures de la Foule, elle
s’éloigne du micro en un pas de
danse
bouleversant et maladroit, un
pas d’étrange funambule, laissant
flotter
avant de
disparaître dans l’obscurité,
quelque vision fantomale. Toute
plainte est au bout du conte, sans
larmes et sans voix. Silence et nuit
enchâssent ses cris.
 4 4
Espace retrouvé :
la geste vocale de Piaf est
aussi vocalise et grammaire de
gestes. J’étudie cette polymorphie
et polyphonie de sa gestualité à
travers une lente collecte de toute
une panoplie d’images. J’engrange et
j’analyse les images fixes des
photos de studio, des pochettes de
disques, des reportages
journalistiques, des portraits
dessinés, peints, parlés ou écrits
et surtout je travaille les
enregistrements audio-visuels
disponibles sur totalité ou fragment
de ses tours de chants ;
enregistrements que je décompose,
recompose en séquences suivies de
gestes posés, iconographiés à raison
d’un arrêt sur image toutes les
4 ou 5 secondes environ,
ceci donnant environ une série d’une
trentaine de photographies par
chanson intégralement filmée.
Entre
forme et sens
Toute langue s’entend sur
deux registres distincts : d’une
part sur l’axe syntagmatique, auquel
correspond – pour aller vite –
l’unité réalisée d’un énoncé et
d’autre part sur l’axe
paradigmatique qui désigne l’horizon
des rapports associatifs assortis à
l’enchaînement hiérarchisé des mots
et des phrases.
Si l’on
ne saurait décrypter le langage des
gestes comme réalité linguistique,
on peut toutefois tenter de
transposer ces deux dimensions du
syntagme et du paradigme à la
lecture des gestes, notamment ceux
de la performance scénique des
chansons. Je me contenterai ici,
dans le cadre de ces journées sur
l’espace et le territoire, de
n’évoquer que l’aspect syntagmatique
de la palette gestuelle d’Edith
Piaf. Quelques syntagmes seulement…
l’apostrophe, l’imprécation, le
récit, le fatum, l’imploration,
l’instant de grâce et celui ou
premier ou dernier de la
transfiguration irreprésentable…
D’abord
commençons par l’apostrophe,
cet espace-signe de la rencontre
frontale :
|
|
 |
 |
|
-5 Le disque usé
1943 |
-6 Olympia, 1958 |
|
Les chansons de Piaf sont ponctuées
de gestes vigoureux d’adresse au
public qu’elle aborde plus en
conquérante qu’en séductrice. La
présence de Piaf, c’est d’abord
l’énergie d’un être arraché à la
mort, l’énergie d’une personne
dressée face au monde, un monde dont
la dureté la frappa de plein fouet.
Telle est sans doute l’allégorie
fondatrice qui, soit en mode
majeure, soit en mode mineur, en
creux ou en pointillé, s’instille en
tout tracé expressif de sa voix.
Piaf chantant lance des appels. Elle
provoque le face à face dans Je
ne regrette rien ; elle
exalte, retient le contact à
bout de bras et d’influx mélodique,
elle ameute, mains ouvertes et voix
rivée à sa verticalité … Padam,
padam, padam, écoutez le chahut
qu’il me fait… A moins qu’avec
ce clin d’œil amusé (Mon manège à
moi) ou ces mains sur les
hanches, leitmotiv postural d’entrée
dans la plupart de ses chansons,
elle ne cherche à muer cet espace
d’adresse – ce syntagme de
l’apostrophe – en manière d’officier
la cérémonie en femme du peuple,
sûre de sa souveraineté frondeuse.
|
 |
 |
|
-7
C 1941
Elle fréquentait la rue
Pigalle |
-8 N
Edith Piaf
quarantième anniversaire
|
Syntagme de l’imprécation,
disais-je, je vise là tout l’espace
déictique animant son chant.
A la différence de l’espace
d’adresse, tous les gestes
d’indexation y sont prononcés non en
direction de l’auditoire mais en
direction de quelque
interlocuteur abstrait ou témoin
absent : personnage né de la
chanson, amant disparu, démon caché,
ennemi en fuite. L’espace
épidictique interpelle un irréel
passé, présent ou à venir.
Tourné vers l’espace de la chanson,
il est signe
d’exclamation face à un au-delà… Il
se joue là un troublant paradoxe
entre le réalisme familier
des gestes et les éléments évoqués.
On est bien dans la fiction vraie du
théâtre, on accepte volontiers d’y
entrer et cela par le biais de
moyens aussi élémentaires
qu’efficaces. Le style gestuel
d’Edith Piaf se transforme au fil de
son art. Elle met du temps – le
temps lent de trouver sa singularité
– pour inventer ces archétypes
inoubliables du geste chanté que
nous lui connaissons, mais elle
gardera toujours, au gré de ces
métamorphoses, cette écriture
épidictique de la chanson. Les
gestes aussi sont des palimpsestes…
et ce lexique-là qui est le plus
spontané, le plus idiosyncrasique
fut aussi le plus récurrent, tel un
refrain rodé dans des espaces de
plein air, ceux de la voix exposant
ses paroles, hors distance de
l’estrade et sans écrin.
L’espace narratif, lui se
combine à l’espace déictique, mais
au-delà de la désignation, il
symbolise des actes, des
atmosphères, des caractères…
suspendus dans les mots ailés de la
mélodie.

-9
ABC 1941
Elle fréquentait la rue Pigalle
Les
chansons d’Edith Piaf qu’elles
soient de la veine réaliste, de la
veine des romances ou de la veine du
poème plus sophistiqué sont toujours
des récits dont elle suit, dont elle
fait suivre par indications
convenues, par détails très
figuratifs ou par amorces plus
elliptiques la courbe et le propos
dramatique. Là encore beaucoup de
nuances et beaucoup de
transformation dans cet espace
narratif qui peut aller de
l’insistance presque burlesque dans
L’homme à la moto, pour
passer à la touche tragi-comique
stigmatisant le triste sort du
Clown et même se dépasser
jusqu’à la figuration non pas de son
chagrin, mais du chagrin de l’autre,
ce héros aérien qui dialogue
imaginairement avec elle, ce
Milord
que sa belle a quitté sur le
quai et qui ne veut pas danser… Ces
gestes narratifs sont parfois très
concis, parfois très
enfantins, mais toujours surprenants
et nettement façonnés. Elle
sort son mouchoir pour signifier ses
larmes dans Elle fréquentait la
rue Pigalle, elle
trouvera bien d’autres manières
invisibles et muettes pour les
donner à
ressentir.
On peut dire rapidement qu’en
cet espace narratif, elle se
promènera de la mimétique de ces
débuts vers des compositions vocales
plus chorégraphiques.
Syntagme du fatum, le vocable
choisi par commodité d’exposition
n’est sans doute pas le meilleur,
puisque toute ou presque toute
manifestation du geste vocal de Piaf
contient ce sens généreux, fiévreux
du destin. La trace vocale du fatum
est chez elle davantage à comprendre
dans une synergie associative de
signes, de couleurs, de silences et
de sons qu’à réduire à un schéma
analytique. Toutefois l’espace
tragique par excellence d’Edith
Piaf, c’est en premier et dernier
lieu, en deçà de son chant,
son visage.
|
 |
|
-10 photo
1944 in
Edith Piaf quarantième
anniversaire |
Son
visage qui sait le voyage sans
retour, qui en porte l’aura.
L’intensité de sa beauté
tragique est frappante dans nombre
de ces photographies des années
40-44). Si son chant figure un
espace tragique, son visage, lui, le
préfigure.
Il lui
suffit d’apparaître dans la lumière
noire de la scène et tout est déjà
dit, si ce n’est chanté. En ce sens,
il est cet énoncé réalisé du fatum,
ce syntagme radical.
Le syntagme d’imploration,
l’espace lyrique de Piaf. Lui aussi
envahit tout. Mais je cherche à
repérer, à indiquer là son
expressivité propre dans le langage
scénique de la liesse, de l’élan, du
tourment, de l’échec amoureux. Sans
doute est-ce, en ces moments que le
don de sa voix est à son acmé.
|
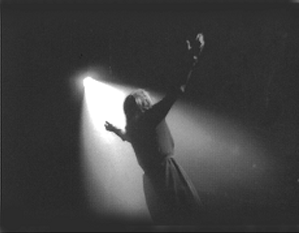 |
|
-11
Monsieur Saint Pierre
1944 |
|

|
 |
|
-12 Photo in
Edith Piaf 40°anniversaire |
-13 Carnegie Hall 1957 |
Mobilisations nerveuses des mains,
supplique des bras en croix, poings
serrés à hauteur de la gorge,
passage à la limite du jeu de
l’émoi… La graphie vocale se sature
de tropes et de sens ; elle entre
dans l’allégorie baroque. Nous
disions aussi syntagme de la grâce.
Le ravissement est possession, il
est extase. L’espace lyrique nous
mène plutôt du côté de la
possession. Mais il y a chez Piaf
une mystique suffisamment marquée de
la voix pour qu’elle puisse
s’abandonner à l’effusion de
l’extase. Des bras levés en corolle
autour du visage, des doigts
effleurant légers, les cheveux, le
sommet de la tête renversée, des
yeux levés s’absentant du monde,
voilà le portrait sans retouche de
Piaf passée dans ce corps
ascensionnel, enchanté de son
chant…au-delà de son chant.
Les images nous la montrent
chantant dans cet état d’apesanteur
et de songe extatique.

-14 Photographies in
Edith Piaf quarantième
anniversaire
|
 |
|
-15 Le geste célèbre de
L’Accordéoniste
Composition de l’auteur à
partir
d’une
photographie de 1953 |
Enfin
parler de syntagme de
l’irreprésentable peut sembler
étrange. Il s’agit seulement, en
l’occurrence, de pouvoir souligner
ces moments qui, chez la chanteuse,
semblent gommer tout espace
symbolique langagier, qui seraient
comme des moments de suspens de
toute grammaire des gestes. Alors
que nous parlions d’une geste vocale
accomplie où chair, muscles, peau,
cœur et âme s’assemblaient, le corps
d’Edith paraît parfois en désaccord.
Soudain, elle se tient les bras
tombant le long du corps ; ce sont
alors des membres déliés de tout
sens, de tout signe, ramenés à leur
fragilité, à leur pesanteur. Et là
voilà elle-même posée là, comme
dépeuplée, sans détour, en bord de
piste, en bordure d’abîme. Ce
mutisme de la vision émotionnelle
est un passage à la limite, un
moment d’invasion de la pure
vocalité. Il n’y a plus rien à voir,
à montrer…pour quelques instants
seulement, car dans cet espace
furtivement asymbolique, le langage
revient subitement, puissamment par
le regard, ce lieu suprême du chant
bouleversé de Piaf qui dit alors
l’éternel fleuve des désespérances
du Jadis.
Sans
oublier dans ce langage du souffle
et de l’âme, le syntagme de
l’emblème radical. Car dans cet
univers de gestes, certains sont
entrés au panthéon, comme ce geste
de l’Accordéoniste faisant à
lui seul, synthèse ultime puisqu’il
est, au gré
de ses innombrables reproductions,
devenu analogon de la chanteuse
éternisée, de la chanson-culte de
son répertoire et de son
esthétique interprétative.
Paysages
Pour quitter cet espace
scénique d’une voix qui fit date
dans l’histoire francophone et dont
l’impression perdure, j’aimerai
signaler que cet exemple chansonnier
nous mène aux bords d’un concept
plus vaste, celui de paysage sonore
qui transporte l’idée de suite
spatiale vers celle de suite
temporelle, celle de plans étagés
vers celle de séquences, de fuites
d’instants minimaux.
Raymond Murray Schaffer
invente pour cela le néologisme de
soundscape qui, au-delà de
l’usage mimétique d’un anglicisme
de bon ton, profile l’ambition
interdisciplinaire d’une esthétique
du sonore s’accordant en bien des
échos avec notre recherche actuelle
transversalement tournée vers une
anthropologie du « charme » des voix
écrites, parlées, chantées.
« Et
ta voix comme une eau, elle-même
s’efface… »
Bibliographie
BAUDELAIRE, Charles,
Les Fleurs du mal,
(Correspondances, œuvres complètes),
Paris, Robert Laffont, 1980
BOUGNOUX, Daniel, « On ne connaît
pas la chanson », in
Esprit, n°7, juillet 1999
CASSIN,
Barbara, COHEN-LEVINAS, Daniel (dir.),
Vocabulaires de la voix,
Paris, L’Harmattan, 2008
CAUQUELIN, Anne, « Ce que m’apprend
Murray », in Une larme du
diable : revue des mondes
radiophoniques, Brest, 2009
CHARVET,
Jean Loup,
L’éloquence des larmes,
Paris, Desclée de Brouwer, 2000
DENIOT,
Joëlle, VRAIT,
François-Xavier (dir.) avec DUTHEIL
Catherine, Dire la
voix, Paris, L’Harmattan, 2000
DUFOUR,
Dany-Robert, L’art de réduire les
têtes, Paris, Denoël, 2003
HIRSCHI,
Stéphane, Jacques Brel : chant
contre le silence, Paris, Nizet,
1995
LEGENDRE, Pierre, De la société
comme société texte, Paris,
Fayard, 2001
MARIN,
Louis, Des pouvoirs de l’image,
Paris, Seuil, 1993
SCHAFER,
Raymond Murray, Le paysage sonore,
Paris, Lattés, 1979
PROTAT,
Jacques, Le cabaret new-yorkais,
prolégomènes à l’analyse d’un genre,
thèse de doctorat sous la direction
de Jacques Patriat, Université de
Bourgogne, 2004
ROUTEAU,
Luc, « Le Bouz-karki », in
DUMOUCHEL, Paul, DUPUY, Jean-Pierre
(dir.), Violence et vérité autour
de René Girard, Colloque de
Césiry, 1983 |
|
Daniel Bougnoux, « On ne connaît pas la
chanson » in Esprit Juillet,
1999.
Idem.
Je pense en particulier au groupe Zebda aux
nombreux titres- drapeaux sur ce thème.
Référence bien sûr à la fameuse chanson de
Gaston Couté « Les mangeux de terre ».
François Jacquemot, « La voix traversée
des lieux », in J. Deniot,
C. Dutheil, F.-X. Vrait (dir.), Dire la
voix, Paris, L’Harmattan, 2000. François
Jacquemot cite lui-même à ce propos Gabriel
Bacquier.
Selon l’étymologie skéné (scène) se
rapproche de skotos (ombre,
ténèbres). L’humain exige une scène, il
s’y écrit un discours qui porte en lui le
lieu d’ombre et de ténèbres qui le sépare du
monde cf. Pierre Legendre, De la
société comme société texte, Paris,
Fayard, 2001.
Scène biblique, Scène du fantasme : on
retrouve en théologie et en psychanalyse ce
schème de la Scène, archétype primordial de
toute symbolisation
Dany-Robert Dufour, L’art de réduire les
têtes, Paris, Denoël, 2003.
Pierre Legendre, op. cit.
L’idée de la mêlée sociale au temps
florissant du caf’conc’ est en grande
partie, un leurre.
Stéphane Hirschi (in
Jacques Brel : chant contre le silence,
Paris, Nizet, 1995) assimile ce passage à
l’émergence de l’interprète moderne
Expression de l’idéal théâtral selon
Grotowski
Jacques Protat, Le cabaret new-yorkais,
prolégomènes à l’analyse d’un genre,
thèse de doctorat sous la direction de
Jacques Patriat, Université de Bourgogne,
2004.
Car il y a bien un art de cabaret en France,
il vient de l’esprit montmartrois puis
s’implante durant les années « Saint-germain
des prés », dans des lieux comme les trois
Baudets, la Rose noire, l’Ecluse (60 places
maximum) et les noms emblématiques de cette
chanson « rive Gauche » sont ceux de Gréco,
de Boris Vian, des frères Jacques… on est
loin de l’univers de Piaf, en apparence du
moins.
Luc Routeau, « Le Bouz-karki » in
Colloque de Césiry : Violence et vérité
autour de René Girard, sous la direction
de Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy,
1983.
Moins qu’en toute musique toutefois ;
musique si apte aux voyages, qu’elle
entraîne en ses sillages flux, reflux,
migrations des cultures.
L’usage à stricte fin communicative
rudimentaire, ne fait pas d’une langue,
une demeure même d’emprunt.
Jean Loup Charvet, L’éloquence des
larmes, Paris, Desclée de Brouwer,
2000.
Louis Marin, Des pouvoirs de l’image,
Paris, Seuil, 1993.
Jean Loup Charvet, op. cit.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal,
(Correspondances, œuvres complètes),
Paris, Robert Laffont, 1980.
Anne Cauquelin, « Ce que m’apprend
Murray » in Une larme
du diable : revue des mondes
radiophoniques, Brest, 2009.
Raymond Murray Schafer, Le paysage
sonore, Paris, Lattés, 1979.
Yves Bonnefoy in « Le
dialogue d’angoisse et de désir »,
in Poèmes, Pierre
écrite, Paris, Editions Mercure de
France, 1978, cité par Danièle Pistone
in Vocabulaires de la
voix (présentés par B.Cassin,
D.Cohen-Levinas), L’Harmattan, 2008.
|