|
___________________________________
Retour des
peuples
1. Les milieux
populaires du
Non français
à l'Europe
oligarchique
prétendant
constitutionnaliser
la
mondialisation
d'avant sa crise
Jacky REAULT
Maître de
Conférences -
UFR de
Sociologie à
l'Université de
Nantes,
LESTAMP-Association
Droits de
reproduction et
de diffusion
réservés ©
LESTAMP - 2005-
2009
Dépôt Légal
Bibliothèque
Nationale de
France
N°20050127-4889
Réflexions de
premier moment,
analyse spatiale
et multivariée
du Non français
au référendum
européen de 2005
à l'encontre des
oligarchies
régnantes jusque
dans l'Ouest
catholique et
européiste -
Avril -Juin
2005, Revu et
complété
décembre 2008
Mon
intuition
globale
d’historien est
que cette
journée du 29
mai 2005 vaut
bien celle de la
prise de la
Bastille
quoiqu'elle soit
strictement
défensive et que
son débouché
politique est
bien peu assuré
si l'on
considère le
niveau et la
largeur d'esprit
des
récupérateurs
qui prétendent
l'orienter et
l'absence de
tout véritable
leader populaire
capable
d'unifier cette
marée de liberté
retrouvée. Dans
cet article on
ne boudera pas
notre jubilation
de citoyen, le
plaisir du
premier degré,
mais on
cherchera aussi
plus
méthodiquement
les composantes
historiques
sociales et
culturelles d'un
rapport Oui/Non
qui risque
d'être longtemps
structurel dans
la pérennité et
les
métamorphoses à
venir de la
société
française. La
spatialisation
des votes sera
notre principal
mode
d'expérimentation
sociologique
ici, sur un
territoire
français à la
fois unitaire et
structuré par
des
espaces-temps,
une
spatialisation
que nous avons
dans de nombreux
autres travaux
croisée avec la
canonique
analyse
statistique de
corrélations sur
une corpus de
centaines de
variables
sédimentées sur
trente ans.
C'est pourtant,
en considération
de plus que
l'esprit du
temps, une de
ses
fondamentales
structures
gnoséologiques,
après la
"Galaxie
Gutenberg",
celle qui passe
par l'image
diffusée par les
media de masses
et d'abord
internet, par
l'image
librement
diffusée sans
fin, que nous
allons pénétrer
médiatiquement
donc aussi dans
ce qui n'est
qu'un premier
niveau
d'analyse, trop
contemporain
pour prétendre
être histoire,
d'un évènement
historique de
première
grandeur.
La
galaxie
internet, notre
nouvel et
ambivalent
cosmos
Contrairement à
la vision
dualiste
initiale (début
des années 2000)
des
pisse-vinaigres
des sciences
sociales
éthologiques de
l'éternelle
domination,
l'accès à
internet est
virtuellement de
de plus en plus
réellement un
bien commun et
non le lieu d'un
apartheid, au
plus ne relègue
t il
résiduellement
et
provisoirement
que les plus
âgés toutes
catégories
confondues.
Autant et
peut-être plus
que les textes
les images qui y
circulent
offrent aux
multitudes qui y
circulent les
ressources d'un
réseau
conjuguant les
offres
réappropriables
par chacun, de
l'émotion et de
la connaissance,
Torrents
d'images
médiatiques
réduites à
l'anecdote
désignifiante
Rares icônes
porteuses de
récits débordant
de sens au delà
de l' allégorie.
Les premières ne
sont même pas
des eidola
mais les
secondes bien
plus des
eikona de la
tradition
platonicienne
puisque
porteuses non
seulement
d'identification
personnelle
possible
mais d'un savoir
propre.
On commencera
par deux images
à faire encadrer
d’urgence pour
un livre
d'histoire
illustré à
destinations des
nos petits
enfants refusant
de devenir les
post-citoyens
d'un empire
formé des
pays de la
soumission,
cet archipel
mondialisé tout
autant virtuel
que réel. Elles
nous sont toutes
les deux
parvenues
par
l'effervescence
spontanée des
internautes
connus ou
inconnus qui ont
débarqué sur mon
écran. L'image
politique du net
permet de
conjurer r la
position passive
par l'initiative
active. Tout le
monde est
diffuseur et si
l'image est
jubilatoire,
enthousiaste;
l'avenir
politique ne
sera de ce point
de vue plus
jamais comme
avant, et si le
premier temps a
favorisé les
oligarchies,
premières
"branchées", le
temps de
l'universalisation
advenu ou en
passe de l'être
fait de
l'échange sur le
net un attribut
( certes inégal
mais c'est
politiquement
peu important)
virtuellement du
peuple tout
entier.
La formule de la
soumission
sembla d'abord
aller comme un
gant à la
démocratie
désubstantialisée
(Guy Bois)
qu'engendrent
les puissances
conjurées pour
imposer la
"nécessité
unique ( le
trépas)" de la
mondialisation.
Elle est, il
faut le rappeler
l'expression
fondatrice
autant que
réductrice de sa
propre œuvre
beaucoup plus
contradictoire,
de l'André
Siegfried des Tableaux
politiques de la
France de
l'Ouest,
lorsque son
républicanisme
de combat
s'irritait de ce
qu'il pensait
être un destin
éternisé
(l'asservissement
volontaire
supposé des
peuples
de l'ouest
français, aux
maîtres de la
rente foncière
et du
catholicisme
unanimiste).
Aucun destin de
soumission
(ou de
domination
dans la vulgate
démobilisante du
sociologisme)
n'est jamais
adjugé quand
il s'agit
d'humains non
massifiés et il
y a désormais un
demi-siècle que
l'historiographie
a retrouvé la
fierté d'une
résistance
jusque chez les
chouans de la
contre-révolution
Piètres
sociologues ceux
qui n'ont pas
intégré l'apport
le plus profond
de la pensée de
... Marx. Voir
et penser
la contradiction
dans l'essence
même des choses.
La contradiction
au sein du réel,
n'est-ce pas
l'inverse
gnoséologique de
l'injonction
binaire des
media massifiant
comme des
discours de
désubstantialisation
de la démocratie
des politiciens
de media et de
la publicité
marchande et
manipulatrice
dont ils
s'inspirent.
Revenons à nos
images. Toutes
les images
médiatisées ne
doivent pas être
fétichisées,
comme
irréductiblement
addictives ;
sur ce point
Régis Debray a
raison contre
Guy Debord, le
spectacle
est une fonction
anthropologique
de toute société
normale, ne
serait-ce que
comme moment
spéculaire de
son unité (Lacan
et Durkheim) et
certaines images
peuvent être
radicalement
libératrices ou
sublimantes
(l'icone) ou
irrémédiablement
tragiques. On
s'arrêtera ici
sur deux
seulement, car
la troisième
n'est que la
tautologie
textualisée
de la deuxième,
tautologie (lire
sur cela Clément
Rosset) ne
signifiant pas
épiphénomène de
la connaissance,
en l'occurrence
lorsque
l'assertion
redondante
s'inscrit, et
avec quelle
efficacité, dans
le performatif
de l'action
politique,
redoublée de sa
composante la
plus subversive
possible,
l'humour, et le
rire induit, qui
verrouille
l'effet de
ridiculisation
de
l'adversaire..
L'une, celle qui
nous montre avec
quel bonheur
Nicolas Sarkozy
et Françoise
Hollande en
compères
satisfaits,
n'est rien
d'autre que la
couverture d'un
magazine de très
large diffusion,
Paris-Match,
certes on donne
ici en plus sa
version quelque
peu subvertie
par un texte
diffusé sur le
web, mais c'est
pour le plaisir
autant que pour
la démonstration
l'image "dit"
tout et plus
encore.
L'autre,
produite de
l'agence
France-Presse,
se passe de tout
commentaire, le
texte étant
purement
informatif. Le
premier ministre
(Lionel Jospin)
l'homme de la
gauche plus
rien
(plurielle)
comme le
qualifiait ses
critiques de
gauche) met
gentiment la
main sur
l'épaule du
président de la
République,
Jacques Chirac,
qui le devance
suscitant le
rire du
président du dit
MEDEF, Mouvement
des Entreprises
de France, à
distinguer de
l'antécédent
patronat
français.
C'est le baron
Ernest-Antoine
Seillières, du
lignage de
maîtres de forge
des Wendel, dont
la vaniteuse
contribution à
la
mondialisation
prédatrice de
l'industrie
française,
soumise aux
injonctions
libérales et
impériales du
centre du monde,
qui a oublié que
c'est le renfort
de l'Etat
français, bon
prince toujours
pour le
capitalisme
défaillant, qui
sauva au début
des années 80 le
groupe séculaire
de sa grande
famille du cruel
entonnoir de
l'histoire des
faillites.
Honneur au
photographe
anonyme : Belle
brochette,
indeed, si
l'on veut bien
nous pardonner à
la fois cette
familiarité et
cette soumission
ironique à la
langue que tous
tendent plus ou
moins à nous
faire substituer
à la notre tant
dans
"l'entreprise"
que dans la
"recherche",
réduite de facto
au quantitatif
et aux idées
transférables et
sans sols, donc
simples.
Nous vivons le
temps de
l’ambivalence
des images. La
majorité celles
que déverse en
chaos de sens et
de non sens le
flux médiatique,
chaque jour dans
l’œil du cyclope
télévisuel au
sein des vies
privées, sont
les leurres de
l’enfermement
interprétatif
réduit à
l’anecdote
excluant tout
récit (Christian
Salmon,
Verbicides
Climats). Elles
s'adressent à
des individus
structurés par
les formes de
(dé)
subjectivation
de la
mondialisation,
psychotiques et
acritiques
(Dany Robert
Dufour, L’art
de réduire les
têtes.
Fayard 2002 ) et
elles alimentent
leur dé
subjectivation.
A l'inverse, il
en reste de plus
rares échappées
à la moulinette
du nivellement
de masse et de
planète, qui
ramènent aux
mémoires
identificatrices
et aux
symbolisations
de
l’appropriation
possible d’un
monde à
connaître dans
les limites des
raisons de
l’individu
moderne, névrosé
et critique. On
part ici de deux
photos
subjectivantes
en ce
qu'elles
induisent le
regard d'un
sujet libre en
mouvement de gai
savoir et de
surcroît un
citoyen (adulte
libre fondé en
droit au sein
d'un peuple
souverain) parce
qu'elles
condensent plus
qu'elles-mêmes
dans un
feuilletage de
sens inépuisable
embrayeurs
d'associations
libres et
disponibles pour
la réflexion
autant que pour
les respirations
de l'imaginaire.
Elles sont
virtuellement
des œuvres elles
sont
inséparablement
des actes.
Qu'est-ce
qu'une date ?
D'abord ces
marqueurs de
réalité et de
mémoire qui
condensent les
transformations
opérées dans
l'opacité des
structures dans
un
évènementialité
qui les
visibilisent ce
qui n'exclut pas
la nécessité de
les interpréter.
Les dates, ces
data par
excellences qui
font référence
doivent plus que
jamais
structurer le
savoir sur les
sociétés en un
temps de
retour
fulgurant de
l'histoire en
pieds-de-nez à
ceux qui
l'avaient
enterrée, avec
ses sujets
personnels et
sociétaux,
nations,
peuples
ensemble
civilisationnels,
tribus de
l'effervescence
juvénile, les
classes
peut-être mais
celles des
sociétés de la
mondialisation,
1995,
novembre-décembre
la révolte
nationale et
sociale des
classes moyennes
salariés des
services publics
et des classes
populaires
solidaires
contre le
dépeçage de la
société
salariale
(Aglietta
Brender 1984)
française.
2002 Le 21
avril, la
révolte
populaire légale
aux élections
présidentielles
après les
accords de
Barcelone, le PS
cosignataire
passe aux
oubliettes et y
est encore
(février 2009),
Avril 2005, le
Non radical
français à la
désouverainisation,
passant par
la
constitutionnalisation
du libéralisme,
un non Etat
européen asservi
au pouvoir
financier.
Entre ces deux
moments qu’il
est légitime de
relier sinon de
confondre, les
élections
présidentielles
françaises
d'avril 2002, et
le referendum
sur la
« constitution
européenne » de
juin 2005, deux
photos se sont
révélées dès
leur production,
à valeur
historique parce
qu’elles ont
condensé des
flux de sens et
de valeur
probatoires qui
ont été
réappropriées
par des
multitudes à qui
leurs
représentants
naturels ne
donnent depuis
longtemps plus
rien à penser.
Ces deux
élections ont,
contre toute
prédiction
évolutionniste
des tenants de
l'abolition des
sociétés
humaines dans
une humanité
d'avant Babel,
réduite à
l'espèce, de la
fin de
l'histoire, ont
manifesté
l'irréductible
dynamique de
l'historicité
des sociétés. La
première à
évincé
spectaculairement
le représentant
d'une gauche qui
depuis vingt ans
prétendait se
passer de
peuple, - et sur
ce point le
fugace vainqueur
populiste (?)
avait beau jeu -
et l'humiliation
sera difficile à
inverser. La
seconde a vu un
peuple
désouverainisé
par ses propres
représentants et
qui n'avait pu
dans le premier
épisode que
résister par la
dérision, se
manifester de
nouveau en
souverain de
lui-même sur un
vote
radicalement
univoque et de
facto
révolutionnaire
quoique que l'on
puisse parier
que toutes les
forces possibles
des
bureaucraties
continentales,
des media
monopolisés, de
l'argent, vont
tout faire pour
lui faire
oublier comme
elles vont tout
faire pour
abattre, ceux
qui dans le camp
des compères en
euro-mondialisation,
ont eu le
courage de faire
sécession et
d'abord Laurent
Fabius qui n'y
pourra mais, ca
r il n'a ni la
configuration
sociales ni les
ressources
personnelles
pour oser un
appel au peuple
qui mettrait en
pièce toute le
carcan
idéologique et
institutionnel
que depuis 1983
il a lui même,
comme premier
ministre de
François
Mitterrand,
largement
contribué à
édifier.
 |
Ce
fut Non, et quel non !
L'histoire des
peuples
est repartie et c'est
vraiment cette fois-ci
dans une campagne de
résistance à la
mondialisation. Guy Bois
et ses analyses qui ont
radicalisé notre
perception et ont enfin
permis d’unifier tant de
forces disparates et de
phénomènes apparemment
éclatés, (Une
nouvelle servitude,
essai sur la
mondialisation
2003,
François-Xavier de
Guibert) n'ont jamais
été si nécessaires et si
confirmés. Le colloque
du Lestamp aussi qui se
déroulait à la
Médiathèque de
Nantes-centre du monde,
en décembre dernier
n'aurait pu viser plus
au centre de la
contradiction principale
du temps actuel. Notre
communication y
annonçait « Le
retour
des
peuples
». Il va venir ! Elle va
venir, ou plutôt pour
l'essentiel on en donne
ici la moitié de la
teneur, nous réservant
de développer plus tard
l'autre dimension de
l'antagonismes des
peuples
et de la mondialisation,
celui des pays et de
l'empaysement voire
celui de
l'éventuellement fin des
paysans.
Un
rêve citoyen et de
sociologue ?
si les
sociologues rêvaient et
si les
majorités
populaires étaient un
objet, comme
ils disent,
légitime.
On y est dans ce
retour
!. Ce vote, même analysé
à la diable et de haut,
s’avère un vrai rêve de
citoyen et de
sociologue ; enfin de
ceux d'entre eux qui
s'intéressent plus à la
réalité sociale et à
l'histoire vivante plutôt
qu'à la "(re)
construction" de cette
réalité et à l'évolution
(un seul sens dont seule
une cléricature érigée,
en secte disciplinaire
possède, seule, la clé)
et qui cultivent cette
culture de la rupture
épistémologique d’avec
les prénotions du sens
commun ; culture devenue
l'alibi imposteur de
leur séparation
méprisante d’avec la
communauté de leur
peuple.
Pour le
citoyen un peu
sociologue,
ce
vote « c'est la très
nette volonté de
protestation des classes
populaires » doit
reconnaître un des
ténors de la classe
parlante, Roland Cayrol
lui-même (La Tribune du
30 mai 05 ) pourtant
expert en promotion des
élites de la pensée
unique. Mais pourquoi de
protestation ?
sinon, pour insinuer les
bornes populistes -
cette insulte suprême
des oligarchies
régnantes - et la
dimension sous-politique
où l’on veut confiner
tout cela ; la
protestation sociale ce
n’est pas si grave, cela
ne touche pas au dogme
de la nullité politique
adjugée des
peuples,
alors qu'en l'occurrence
il s'agit ici de la
conjonction convergente
des trois angles du
populaire la nation
politique, le peuple des
rapports sociaux les
dites (et très floues)
classes populaires, le
peuple des cultures
communes.
Volonté
générale
nous suffit
(hein Jean Jacques !) ;
c'est qu'en l’occurrence
ces classes populaires
que là encore, la
chirurgie sociologique
habituelle délie confine
comme plèbe, voir comme
"bas" M. Verret, O
Schwartz), sont
inséparables de peuple,
Populus..
Sujet collectif, auteur
(auctor, auctoritas),
de la souveraineté et
pas seulement depuis les
révolutions modernes et
d’abord la nôtre.
Volonté du
peuple ! Rien de moins,
rien de plus. D'’un
peuple retrouvé, clé de
toute résistance, même
si, comme toujours, ce
sont d'abord les classes
populaires et d'abord,
los olvidados par
excellence, les ruraux,
ces
périphérisés
de l'intérieur,
ouvriers (la moitié) et
chasseurs (le seul
mouvement social
populaire et
démocratique né depuis
la mondialisation), même
si ce sont ces deux
évocations repoussées
par la bien-pensance qui
manifestent le plus
clairement cette
volonté. Ce qu’ils
refusent et toujours
plus de vote en vote
depuis 1984, (en
changeant à chaque fois
la majorité politique
entre les deux pôles du
pareil au même) et
avec le plus de
conséquence, maintes
observations permettent
de l’expliciter, ce
qu’ils refusent, pour le
moins trois violences
qui leur sont faites
depuis que l’air du
temps de la
mondialisation a conquis
les oligarchies des très
grandes villes
accaparant les pouvoirs
de scènes et les paroles
médiatisées.
- La première est celle
de l’injonction à leur
disparition comme nation
libre et indépendante.
La seconde
reconnaissance attendue,
comme au temps du
progrès social des
Trente Glorieuses
de la société
salariale,
c’est la
reconnaissance de leurs
intérêts spécifiques à
la fois différenciés de
classes, essentiellement
des producteurs, c’est
la reconnaissance de
droit à la
territorialisation (empaysement
J Réault Coll.
Lestamp 2, 4 Décembre
2004) protégée.
- L’unité de
l’ensemble, dans des
sociétés modernes
démocratiques, aptes à
gérer leur légitime
conflictualité, est la
nécessité organique mais
aussi la valeur plus ou
moins universelle, en
tout cas dans
l’universel concret de
la nation, du lien entre
les classes et les
nations dans leurs
luttes solidaires
retrouvées.. Ce lien
entre luttes de classes
(c'est peut-être
vieillot mais plus
robuste que luttes de
classement), et
constitution nationale
de la société salariale,
c'est Emmanuel Todd, (un
des rares sociologues
ayant échappé à la
neutralisation de la
politique par le
monopole
de Sciences
Po) qui en a
radicalisé l'expression
scientifique dans
l’analyse des votes de
1981 à 1994 (Sur le
malaise politique
français,
Fondation
Saint-Simon), prélude
théorique à
l'élection de Jacques
Chirac sur la fracture
sociale, et au sursaut
populaire de l'automne
1995. Mais il retrouvait
ainsi ce qu'avait théorisé
l’œuvre fondamentale qui
pense et clôt les Trente
glorieuses de la
normalisation
démocratique des
rapports du capital et
du travail sur fond de
progrès social :
Les
métamorphoses de la
société salariale
(Aglietta et
Brender, Calmann-Lévy
1983), publiée
l’année de la
renonciation des
« élites » de scène en
France, et à échéance
les auteurs eux-mêmes, à
toute résistance
conséquente à la
mondialisation.
- Le troisième
refus est celui des
fondamentaux de
l’humanisation,
sur le
rapport de la loi et des
communautés (qu’indique
mais que ne résume pas
l’inceste), sur les
grandes différenciations
fondatrices de la
raison, parents/enfants,
hommes/femmes, âges de
la vie et de raison
interférant, sur la
légitimité de l’indigène
sur le territoire qu’il
a façonné pour paysager
le pays des humains. (P.
Legendre, De la
société comme texte.
Fayard 2002)
Tout ce que,
sous couvert de
tolérance absolutisée,
de dénégation nihiliste,
de rejet de tout rapport
nature et culture, d’Antinationisme,
on fait norme le
piètre et mortifère
modèle de la pensée zéro
(Todd,
l’illusion
économique,
2002, P A
Taguieff,
Résister au
bougisme
2001). Les
oligarchies mondialisées
imposent avec violence
et mépris, au sens
commun populaire
disqualifié et méprisé,
certes peut-être de très
loin à partir de
l’épicentre californien-
si justement repéré, de
sa prison par Régis
Debray identifiant le
noyau libéral absolu de
la pensée 68 - mais
surtout relayé par les
post-intellectuels de
l'identité négative
monopolisant les scènes
de la financiarisation
uniforme des media de la
mondialisation.
-
Brèves remarques
intermédiaires sur le
peuple et le populaire
pour un lieu commun des
sciences sociales.
On a reporté en annexe
sous le titre
Retour
des
peuples
-II-,
Peuple politique peuple
social peuple sociétal,
pour un lieu commun des
sciences sociales,
le
développement beaucoup
plus ample qu'il nous a
paru nécessaire
d'apporter à cette
réédition de décembre
2008, qui n'a plus
l'alibi du
faire
vite
de
la réaction à chaud
sur un évènement
historique, quoique
l'histoire, en
l'occurrence en cette
nouvelle crise du
solstice 2008 (après
celle prémonitoire de
1995), se soit remise à
galoper, telle qu'en ses
révolutions et que
chaque jour nous livre
pour le moins un nouvel
"évènement historique"
On renvoie notamment
dans cette newsletter à
la suite de Tribune
libre,
Comment
résister à la débandade
de
la raison, sur les sens
possibles du pacte entre
Ségolène Royal et
Georges Frêche. //, et à
notre texte
Apocalypse
à Manhattan,
pour
la première grande crise
de la mondialisation,
celle du 11 septembre
2001) prodrome à maints
égards de l'actuelle
crise systémique. (2009)
Quel
(s) peuple(s) sociaux
dans le vote de juin
2005 pour le
sociologue ?
Chiffrons
donc, c'est l'approche
la plus simple mais le
nombre pensé dans la
mobilisation
démocratique des
sociétés est toujours
plus que lui-même, il y
a de quoi faire, quoique
les institutions de
sondage ont presque
toujours au cours de la
campagne dissimulé leurs
croisements avec les
catégories sociales et
spatiales pour nous
enfermer dans
l’indexation aux
boutiques politiciennes
radicalement hors sujet.
Quel est le vote supposé
des "électeurs
socialistes" etc.. Ce
type même de
questionnement
abolissait du même coup
la conception citoyenne
du vote et la démocratie
pensée dans son rapport,
également fondateur, au
peuple social, indexant
les identités aux
modalités identifiants
du travail et de
l'emploi.
Mieux que
l'évidence affichée par
les sondages, de
stratifications
économiques, un vote
d'actifs, de
travailleurs.
Le oui est
certes aussi la réponse
de la grande aisance et
de la richesse quoiqu'il
serait réducteur de se
borner à cette
perspective économiste
élémentaire, à
virtualité démagogique
quand elle est moniste.
On en éprouve d'abord
l'heuristique avant d'en
venir à beaucoup plus
complexe l'indexation à
des territoires
culturels,
anthropologiques,
historiques.
Ont dit NON, on
commence désormais à le
savoir en épluchant
vraiment beaucoup de
papier, 66 % de
ceux qui gagnent moins
de 1000 euros par mois,
66 % de ceux qui gagnent
moins de 1500 (notons
que la scission
misérabiliste
qu'affectionne la
deuxième gauche et
les réseaux dominants
nantais, des "exclus"
opposés aux salariés
n'existe pas face à
l'avenir d'une nation,
il n'y a ni "banlieue"
ni "pauvres" mais une
milieu populaire
solidaire) 55 % votent
non, de ceux qui gagnent
entre 1501 et 3000, mais
plus que 40 % de ceux
qui gagnent entre 3000
et 4500 et 26 de ceux
qui gagnent plus ( CSA
La Tribune ). C'est beau
comme à la revue ;
y = ax pour les amoureux
des fonctions
statistiques.
Mais mieux
encore vaut
l'aune du
rapport au travail,
près de 70 % des
ouvriers plus de 60 %
des employés, la
majorité des professions
intermédiaires.. Quant
au rapport du Oui et du
Non à l'emploi,
cet autre marqueur des
"rapports sociaux de
production" du peuple
social de l'après-classe
ouvrière historique, il
est tout aussi parlant
en bloc : 60 % du
salariat cadres compris
(64 pour ceux du public
et même 58 % pour ceux
du privés ont voté non.
( Où se trouve la
scission que tentent,
depuis une génération de
creuser ensemble, les
media la CFDT, le
patronat et leurs
respectives dames
patronnesses (les
humanitaires)
entre ces deux pôles du
travail libre en France
? ) ; quant on passe au
niveau du détail,
l'intensité du rejet se
manifeste comme un
véritable hurlement, 71
% des intérimaires ont
voté non, 69 % des CDD
(dont pourtant la
majorité sont des
femmes) et les CDI sont
encore 58 % cadres et
fonctionnaires compris
.Il n'est jusqu'aux
inactifs dont 54 % ont
voté non; malgré le
pilonnage niais et
sénile des universités
bien pensantes, la
majorité des étudiants
n'a pas suivi alors
qu'elle est en train
éprouver l'Europe des
masters, celle du
nivellement intellectuel
par le bas des
Universités, de la
reféodalisation, de la
déstructuration radicale
du temps de
l'apprentissage
intellectuel
(semestrialisation).
Seuls donnent
une très courte majorité
au non les patrons,
- ce qui donne une large
part de Non dans le
peuple des petits
entrepreneurs condamnés
par la mise en
concurrence mondiale de
la normalisation
européenne -
encore est-ce en fin de
campagne et par tropisme
chiraquien, et les
retraités,
irréductibles à
une tiroir d'économisme
sociologique, dont le
légitimisme et le besoin
de conformité s'ajoutent
à une provisoire
protection maintenue,
acquis pourtant
précarisé de la France
de l'indépendance
nationale et de la
croissance des Trente
Glorieuses, du compromis
social de société
salarial entre le
communisme et le
gaullisme. L'Ouest de la
contre- révolution, sur
lequel on revient plus
loin, a bénéficié de ce
point de vue de son
suréquipement
clientéliste en maisons
de retraite sous la
coupe des notables des
deux grands partis du
consensus libéral et
mondialiste. Qui
n'a pas vu hier les cars
entiers affrétés par
quels fonds publics ou
occultes, déplaçant les
pensionnaires des
maisons de retraite vers
les isoloirs du bon vote
dans la ville de Nantes
qui donne 60 % au oui ?
Ce sont bien
plus globalement et plus
génériquement les
actifs
(les
travailleurs
au sens large
d'une respectable
sociologie indigène) qui
sont en même temps les
adultes
chargés de
famille
- et donc
d'avenir - qui
sont, comme à l'automne
1995, le socle de cette
nouvelle résistance à la
mondialisation qui, pour
la première fois et
grâce à cette seule
forme du suffrage
universel national
direct, n'est plus
affaire de minorités
ésotériques, les
sympathiques mais si
radicalement
dépopularisés
intellectuels et
militants d'Attac.
Beaucoup de ces derniers
d’ailleurs n'osent plus
se dire antimondialistes
et veulent tant se faire
montrables pour ne pas
déplaire aux media
financiarisés qui les
ont transformé en
gentils "alters,"
incapables de
solidariser avec les
autres formes de
résistance populaire
anti-américaines au
niveau mondial, ou à
leurs yeux trop
conservatrices au niveau
national, en invoquant
comme si souvent la
social-démocratie pour
masquer ses trahisons
colonialistes, une
laïcité alibi de la
xénophobie
anti-arabo-musulmane, ou
un évolutionnisme
progressiste qui
archaïse le volant
d'inertie
anthropologique rural en
particulier, populaire
en général, résistant
sur tous les
fondamentaux
anthropologiques que le
processus de
mercantilisation, le
poids des classes
culturelles centrales,
les media, et ceux qui
s'enferment dans une
anachronique identité
progressiste, prétendent
inverser. Alors que la
grande question actuelle
des
peuples
et des classes
populaires est celle de
la résistance et d'abord
de l'autoconservation.
Le premier devoir de
surcroît.
Quel(s)
peuple(s) sociétaux ?
Du
nombre au
peuple dans
des variations
territoriales autant que
sociales des
milieux
socio-spatiaux-mémoriels
concrets : Les
polarisations spatiales
du
oui et du
non
Le Non
vient de
reproduire un
lieu commun,
autour d'un
bien commun
menacé ;
il a rappelé au monde
que voulait toujours
vivre le peuple
français, il a montré à
ce peuple que le mépris
et la tyrannie des
nouvelles oligarchies
n'était pas une
fatalité. Commune
commune ! c'est le
premier cri de
l'émergence des
peuples
modernes au sein
même du féodalisme.
Une souveraineté
empaysée
dans les
territoires de temps
longs d’une
France-diversité au sein
de l'économie- monde qui,
tout à la
fois, centre
et
périphérise.
Dans le macrocosme de
l'économie-monde de
Fernand Braudel, nous
ajoutons l'idée,
éprouvée par de
multiples travaux, de
l'heuristique des
microcosmes
sociétaux
(sociétés
pensées comme
microcosmes du monde
mondialisé, ce qui
n'épuise pas le monde),
au sein desquels se
structurent tout aussi
intensément cette clé de
l'organicité du monde
total, la
centration
et la
périphérisation,
tout aussi bien dans la
société centre
(Etats-Unis) que dans le
premier cercle des
sociétés centrales (dont
la France), que dans les
sociétés des
périphéries. La
mondialisation, son
multiplicateur
bruxellois, sa monnaie
de financiers, ses
serviteurs de tous les
"partis de
gouvernement", en gros
grands et petits
oligarques, engendrent
des faits sociaux et
politiques d'une
intensité et d'un éclat
démonstratif à la
hauteur de ce leur
colossale imposture
culturelle et politique
qui se présente aussi
comme une véritable
révolution de la
décivilisation. Le Non
populaire d'hier
se singularise avec une
prodigieuse évidence
comme inséparablement
territorial et social et
dans les deux cas, le
tout et ses
fractionnements
civilisationnels
(espaces-milieux des
genres de vie de la
ville et de la campagne)
et sociaux (séparations
en milieux de classes)
sont l'unité d'analyse.
Vitalités
des résistances rurales
face à l'injonction du
dépaysement
(JR 2004)
Sécessions des
centre-villes de l'archipel
de la mondialisation
Ce vote est donc
un vrai rêve réalisé de
géographe social aussi.
Le non est d'abord et à
un point insolent, celui
des campagnes qui une
fois de plus assènent
aux monopolisateurs de
la parole des scènes
médiatique ou
sociologiques qu'elles
existent bel et bien,
savent encore chasser,
entre hommes, et savent
que même en cours
d'extermination
euro-mondialistes des
petits agriculteurs sont
encore les
indispensables
empayseurs,
producteurs
de paysages et de pays.
Les ruraux n’ont
pas oublié le
"charbonnier maître chez
soi" long idéal
millénaire (presque)
arraché une certaine
nuit du 4 Août 1789
après le plus puissant
mouvement populaire
victorieux de l'histoire
de France, trop
abusivement réduit à une
expression que l'on
croirait déjà empruntée
aux media de Maastricht
et de la constitution de
Giscard, vilipendant les
attardés et les crétins
: "la grande peur". La
plus puissante
réalisation historique
jamais réalisée de ce
que Roger Dupuy a
fortement élaboré comme
Politique du
peuple
(Fayard 2002),
cet impensable ou plus
précisément ce refoulé
de la
science
politique,
science naine,
appendice des chapelles
médiatiques et même de
l’histoire progressiste,
l'autre histoire sainte
se drapant dans l'empire
du bien pour domestiquer
et moderniser les
peuples,
à l'égal des libéraux.
Les résultats
spatialisés offrent un
vrai festival de
révélations plus riches
en un seul jour que dix
ans de production de
sociologues, ces gens
qui ne savent rien
d'organique sur leur
société pensée comme un
tout.. En un mot,
l’unique bloc cohérent
de départements
qui donnent une majorité
au OUI au milieu d'un
océan de Non a
constitué, il y a deux
cent ans, l’espace
principal de la
Contre-révolution ; (
l'histoire profonde et
fondatrice rejoue de
bien loin - relisons
Braudel -).
Les choses se
sont bien éclaircies
depuis la répétition
générale du vote autour
du traité de Maastricht
; le poids de l’Eglise
catholique constituait
encore le principal
discriminant et le vote
hors Paris correspondait
à deux siècles de
catholicisme
post-révolutionnaire ;
les réalités de la
mondialisation on fait
un sort à l’emprise de
la plus ancienne
multinationale. Ce
qui reste une constante
en revanche, c’est la
deuxième matrice de
l’acquiescement
majoritaire à la
solubilisation des
peuples
dans l’alcool du marché
: les bobo-lands des
très grandes villes les
plus mondialisées -
Paris-plage-vélo, Lyon
la fédéraliste et
quelques autres
métropoles peuplées de
cadres
supérieurs
et de ces si
commodes "sans papier".
Rapportée à
cette toujours si
vivante grande
polarisation de la
révolution néolithique,
entre ville et campagne
et malgré ces
interpénétrations
digitalisées qui
semblaient les
dédifférencier, la
géographie du non et du
oui est tout aussi
massivement exclusive
(même dans les
départements de l’Ouest
à oui majoritaire, on la
retrouve aussi) Les bien
éduqués du Oui, des
villes de l’archipel de
la mondialisation
s’opposent au Non
ruraliste, osons le
dire rural voire
ruraliste.
C'est pour les
Verts, et
n’est-il pas à la fois
savant et citoyen
d’adorer rendre verts
ceux qui nous disent que
l’espèce humaine est de
trop sur la 3° planète),
mais plus encore
impénitent historien
d’esprit, c’est avec une
double jubilation «
scientifique » que je
vois réactualiser cette
constante, dans les
moments-clés de
résistance nationale, le
populaire de tout le
territoire, peuple
urbain compris, et le
rural forment un
ensemble-milieu
organique (que les
économistes de la
consommation telle
Nicole Tabard, ont
repéré depuis
longtemps). Et dans ce
tout c’est -
contrairement à toutes
les analyses
technocratique et
évolutionno-progressistes
la ville, ou ce qui en
reste, disons l’espace
artificialisé du
résidentiel urbain qui
est tirée par le rural-,
c'est le peuple rural
qui est le noyau dur,
"conservatoire" du
peuple-nation, qui donne
le ton, et non les
villes d’où viendraient
tout initiative et force
d’attraction si l’on en
croyait ceux qui nous
les présentent depuis
deux siècles comme en
mission de civiliser les
campagnes, tant chez les
marxistes courts comme
chez les libéraux
(Encore Michéa et son
Impasse Adam
Smith !). Entre la
Vendée et la
dékoulakisation !
(Note de l'éditeur 2010,
Sur la place de l'Ouest
dans l'ensemble des
écosystèmes sociaux des
mobilisations ( J Réault
Lersco-CNRS 1989 cet
essai chorématique
emprunté à Lestamp-HP,
UPJV, Nantes 2010,
copyright).
|
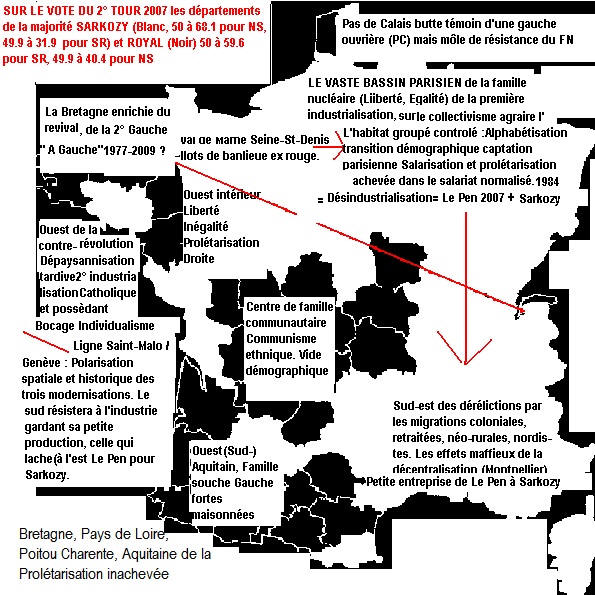
Nous empruntons les
systèmes familiaux à E.
Todd, dans notre
problématique des
écosystèmes sociaux
(populaires) du
développement. (JR
Lersco 1989).
Carte synthétique
extraite de "Nicolas et
Ségolène..." (Sociologie
des présidentielles et
formes de prolétarisation
J Réault 1989, 2010.)
Cliquer sur la carte
pour accèder à
l'article
ou
Cliquer Ici
|
|
| Erratum
du chorème
pouvant encore subsister sur le
site, pour le "Vaste bassin parisien"
(Nord-est) Lire
Prolétarisation achevée et non
prolétarisation inachevée.
Cette dernière concerne
essentiellement l'Ouest de la
contre-révolution ( A
Siegfried), première droite,
et de la dépaysannisation
tardive qui devient vivier de la
Deuxième gauche;
l'Aquitaine est est une forme
oliganthropique et première
gauche radical-socialiste de la
prolétarisation inachevée.
Extrait de J Réault
Nicolas et Ségolène 2007 ou
le mystère de la dame de Vix.in
J Deniot, J Réault, Espaces
Temps et territoires. Ed.
Cahiers du Lestamp-HP, 2, Nantes
2010. Egalement disponible
sur ce site.
Fin d l'insert éditorial 2010 |
Recul
de l'emprise d'église
sinon des réminiscences
de l’Ouest
de la
contre-révolution ?
C'est
cependant de
Nantes, que nous
écrivons. Il y paraît
bien clos ce cycle des
révolutions dans l’Ouest,
notre territoire
d'études de temps long
biographique, où les
villes républicaines
résistaient aux piques
vendéennes et à
l'invasion étrangère. Ce
sont désormais les
campagnes qui résistent
et les villes qui se
laissent envahir. Nantes
ou Rennes (on hésite)
paraissent désormais
comme l’épicentre de
l’onde de
l’anti-tremblement de
terres du OUI. C’est de
là que ressurgissent des
vassalités et
oligarchies d'Ancien
régime, mais toujours
dans ce seul espace de
l'Ouest ( Bretagne et
Pays de Loire à
l'exclusion de toute
autre région française )
: pays de la
soumission disait un peu
méchamment A. Siegfried
qui savait pourtant
aussi les réserves
démocratiques qui y
coexistaient avec ceux
qui veulent toujours des
maîtres-notables,
monarchistes puis
socialistes veillant sur
leur salut, pays de la
"déférence sociale",
pour E Todd qui, quoique
anglophile, ne répugne
pas à la litote, joyau
stylistique de notre
classicisme.
Ici, nous l'avons écrit
depuis longtemps, les
forces dominantes,
anciennes et nouvelles
bien unies, deuxième
gauche (CFDT, majorité
du PS) et première
droite (les Verts, les
Bayroutistes, la
majorité de l'UMP) a
écrit si joliment Todd,
s’engouffrent dans la
logique délétère de la
fusion dans le grand
tout mercantile
bruxellois, sous une
bureaucratie plus bornée
et plus inhumaine que
toutes celles qui l'ont
précédé dans les
Etats-nations, dans la
décentralisation dévoyée
et dans une rampante et
quasi ethnique Europe
des régions. Ce bloc de
l'abolition de la France
toujours à l'avant-garde
de la transmission d'une
identité négative
substituée à sa grande
histoire, tente de
nouveau d'en finir avec
la loi républicaine. Il
n'y a pas d'alternative
au raffermissement de
l'unité de la loi et du
bien commun, dans son
acception moderne et
française de service
public pour balayer les
ententes de copains pour
contourner l'une et
l'autre pour en finir
avec l'omerta locale à
virtualités lyncheuses
jusqu'au sein des
institutions, pour
dénoncer sous les
oripeaux
anarcho-libéralistes qui
n'est jamais ici que
l'avènement d'une
"féodalité de marché",
qui ne connaîtrait que
la loi du plus fort et
l'asservissement du plus
faible dans la recherche
d'une sécurité privée
sous les apparences du
contrat. Entre le fort
et le faible c'est la
loi seule qui protège et
le contrat qui asservit.
Jacky REAULT
Juin 2005.
En guise de
postface réflexive sur
l'implication de
l'auteur sujet dans le
"sujet" analysé.
Ce texte émane
d’un universitaire
improbable écrivant du
sein de ce double
ensemble, l’Ouest
intérieur retrouvé de la
contre-révolution et
Université de Nantes où
précisément la
souveraineté
populaire le vive la
nation du printemps
1789, le primat de Loi
sur les privilèges
opaques, les unanimités
locales de réseaux tout
puissants, la diversité
des sources culturelles
légitimes, ne sont plus
vraiment à l'ordre du
jour. Les politiques
d’épuration et
d’exclusion dans au
moins deux départements
(Psychologie et
sociologie) en sont des
manifestations désormais
passées au domaine
public.
En savent
cruellement quelque
chose par exemple les
enseignants chercheurs
d'un laboratoire qui a
du devenir associatif
pour maintenir son
existence et la liberté
d’expression de ses
membres et dont l'objet
reste précisément la
connaissance des milieux
populaires et que l'on
veut dans tous les sens
possibles du terme,
(qu’ils ont tous
éprouvés depuis trois
ans), éliminer comme
école de pensée et pour
certains d'entre eux
comme professeurs,
interdits de direction
et d'enseignement au
niveau des thèses, dont
l’une vient d’être
« blâmée » par les
instances
disciplinaires, cette
justice entre soi. Mais
c'est à tous les niveaux
et pas seulement dans
nos régions oui-ouistes
que populaire et peuple
sont devenus l'interdit
absolu des sciences
sociales établies !
______________________________________
Note de 2008 sur
Retour
des
peuples
I, Réflexion de premier
moment sur le Non
français au
referendum....revu
et corrigé et complété,
en novembre et décembre
2008.Seuls
des éclaircissements
théoriques sur l'image,
et des précisions
documentaires et
historiques ont été
ajoutés au texte de
2005.
L'interprétation
livrée à chaud en 2005
reste intacte ainsi que
les données numériques,
elle garde les traces
d'une émotion de citoyen
appliquée à
différents registres de
réalités.
Loin de nous
l'idée de la dénier.
Science sociale
sans conscience de soi
n'est qu'une imposture
positiviste
(pages roses
d'un Larousse de 2084).
Le seul complément
théorique significatif
est l'ajout du "commun"
dans l'approche du
"populaire".
Cette triple entrée
complexe d'un peuple
et d'un
populaire à
jamais insaisissable et
protéiforme tout en
étant irréductible,
signifie dans les
travaux élaborés au sein
du Lestamp, un refus de
s'enfermer dans à la
fois l'antinomie, le
faux binaire, et la
qualification
anachronique et
stratifiante, du couple
d'un millénaire
brouillage des sciences
sociales enfermées et
écartelées entre
Populus
plebs,
L'alibi de ses
confusions latentes
alimente aussi une
post-sociologies
méprisantes du
haut et du
bas,
récemment affublées d'un
complément
misérabiliste, le
fragile, par un
binôme de mandarins
pratiquant la mixité
sans doute pour se
couvrir du ridicule
(voir sur le Web, Haut,
Bas, Fragile...
________________________________________________
« Il
n’y a pas, il ne peut y
avoir une civilisation
mondiale au sens absolu
que l’on donne souvent à
ce terme, puisque la
civilisation implique la
coexistence de cultures
offrant entre elles le
maximum de diversité, et
consiste même en cette
coexistence »
Cl.
Lévi-Strauss,
Anthropologie
structurale II p. 417
 |

|
2.
Retour
des
peuples - hiver
2008-9
Cliquer sur
J Réault

Peuple politique
peuple social peuple
sociétal (du commun)
Un essai de définition
des trois strates de' la
nébuleuse populaire et
d'un concept complexe de
peuple.
ANNEXES
Annexe 1
David
Looseley University Of
Leeds.
d'après le site de la
revue Volume, infra,
qui l'a publié; article
distribué aux membres de
IASPM Francophone
Europe.
« Musiques populaires : une exception francophone ? », un regard de cultural studies en forme de dialogue avec deux chercheurs du Lestamp.
On publie ici un texte de la principale figure scientifique vivante des Cultural studies anglaises, David Looseley qui rend compte ici du Colloque de Louvain Musiques populaires : une exception francophone ? de février 2007, et des interventions de Joëlle Deniot Jacky Réault et Gérome Guibert (ancien doctorant de Joëlle Deniot,). Sur la conception du populaire, un des thèmes centraux évoqués par David Looseley, et développée notamment dans ce colloque par J Deniot et J Réault co-fondateurs du Laboratoire d'Etudes et des Transformations des Milieux populaires, voir sur le site lestamp.com, leurs fiches personnelles ( Chercheurs du lestamp) Equipe Lestamp), sur les sites de Joëlle Deniot, chanson réaliste et chanson française de multiples articles interférents et sur www.sociologie-cultures.com, Pour un lieu commun des sciences sociales, L'essai en co-production, Le Commun et, l'article de J Réault, Peuple politique Peuple social Peuple sociétal, l'article de Joëlle Deniot dans le livre collectif, Le peuple dans tous ses états.
David Looseley (d'après le site de Volume, infra)
« Musiques populaires : une exception francophone ? »
Synthèse du premier colloque de l’IASPM – branche francophone d’Europe organisé les 8 et9 février 2007 à Louvain-La-Neuve, Belgique par Christophe Pirenne. [Première parution dans Copyright Volume! 5-2 2006, p. 199-204]
Les 8 et 9 février 2007 s’est tenu le tout premier colloque de la branche francophone d’Europe de l’IASPM (International Association for the Study of Popular Music), créée en 2005. L’absence d’une telle branche au sein de cette association mondiale de chercheurs spécialisés dans l’étude des musiques populaires avait longtemps été à regretter. Il fallait de toute évidence qu’une telle structure existe pour contrebalancer le poids traditionnellement accordé par l’Association aux musiques anglophones. Et celles et ceux qui, comme moi-même, ne sont ni francophones d’origine ni citoyens de pays francophone, mais qui se penchent quand même sur les musiques actuelles francophones, souhaitaient particulièrement le dialogue entre les visions analytiques et culturelles de deux cultures universitaires qui n’ont pas eu grand chose à se dire en la matière.
Pourtant, comme Gérôme Guibert l’a rappelé dans sa communication, on oublie souvent qu’une branche spécifiquement française avait déjà existé, de 1985 à 1989, et qu’un premier colloque IASPM avait eu lieu en pays francophone d’Europe. En 1989, c’est même la 5e biennale de l’association mondiale qui se tient à Paris, à l’instigation d’Antoine Hennion et de a revue Vibrations, attirant 80 intervenants de 24 pays. Mais selon G. Guibert, cet événement ambitieux et prometteur a plutôt déçu, révélant ‘les fractures entre recherche francophone et anglophone’, et ne mettant en présence que ‘des blocs de chercheurs homogènes et antithétiques’. Les raisons en étaient à la fois linguistiques (le colloque fut en principe bilingue, mais ses correspondants ne l’étaient pas) et épistémologiques, puisque les Anglophones représentaient pour la plupart la nouvelle ‘pluridiscipline’ des popular-music studies, issue des cultural studies, alors que les Français (majoritaires parmi les francophones) se réclamaient de disciplines spécialisées et séparées. Dialogue de sourds donc.
Dix-huit ans plus tard, l’expérience a été beaucoup plus réussie. Il est vrai que le colloque de Louvain-La-Neuve a été plus confidentiel et a réuni uniquement des francophones—d’origine ou d’adoption (Français, Belges, un Québécois, trois Anglais, plus un Français installé en Angleterre). Et ils étaient toujours pour la plupart des représentants de disciplines plus ou moins traditionnelles : musicologie, histoire, études littéraires, science humaines. Pourtant le dialogue s’est instauré tout de suite entre les diverses approches de celles-ci et les perspectives pluridisciplinaires des cultural studies. D’abord, de nombreux intervenants— pour la plupart, les plus jeunes—ont directement évoqué ces perspectives, interrogeant les personnalités fondatrices des popular-music studies comme Philip Tagg, Simon Frith ou Adorno. Par ailleurs, le titre du colloque a favorisé ce genre de rapprochements, en privilégiant ce vocable contesté de ‘musiques populaires’ et en invitant les intervenants à sepencher sur ce qui singularise les musiques francophones.
La problématique d’une exception francophone a en effet servi de tremplin à plusieurs thèmes et préoccupations, qui se faisaient jour au fur et à mesure des 24 communications, malgré la diversité de celles-ci. J’ai moi-même donné le coup d’envoi, Christophe Pirenne m’ayant invité à faire en guise d’introduction un tour d’horizon de cette problématique. J’ai donc cherché à faire ressortir les composantes distinctives des discours publics français sur les musiques populaires (médias, professionnels de la musique, intellectuels, institutions), à savoir: la difficulté de nommer ces musiques, le souci d’éviter le ‘populisme culturel’ des cultural studies, et, de concert, un certain refus de percevoir ces musiques comme uniquement un plaisir privé. D’autres communications ont interrogé la notion d’une spécificité francophone sous des angles bien différents du mien, mais elles ont toutes permis de voir, explicitement ou non, que cette spécificité existe bel et bien dans le domaine musical, s’incarnant avant tout dans le mot même de ‘chanson’. Vocable qui n’a pas son équivalent en anglais et qui s’offre donc en alternative à l’hégémonie croissante de la notion anglo américaine de popular music, mais qui semble également résumer toute une panoplie de significations esthétiques, culturelles et sociétales qui—c’est le moins que l’on puisse dire—ne sont pas faciles à cerner.
En décortiquant la carrière et l’image publique de Mistinguett, en partie à l’aide des Stars d’Edgar Morin, Catherine Putheil-Dessin a exposé les différences entre les processus de mythification en oeuvre au music-hall français et au cinéma, soit entre ‘vedette’ et ‘star’. Joëlle Deniot, replaçant son papier dans le contexte de débats très récents sur la notion de chanson française, a identifié pas moins de cinq ‘topiques’ pour définir l’originalité de celle ci, parmi lesquelles la proéminence de la langue, du mot—‘le chanter pour dire’—et le chassé-croisé entre monde de lettres et monde de la chanson’. Des approches essentiellement littéraires et linguistiques ont également été adoptées par Céline Cecchetto (‘Popularité et mémoire dans la chanson française contemporaine’) et Jean-Nicolas de Surmont (‘L’Ingénierie lexicale au service de la poésie vocale : propositions, problèmes, solutions’). Par contre, Stéphane Hirschi a voulu mettre en relief une tout autre conception de cette spécificité. Pour lui, la chanson se définit par sa fredonnabilité, par l’interprétation que l’on en fait et qui lui donne corps, et par une temporalité spécifique qu’il a qualifiée de ‘compte à rebours’ et d’ ‘expression d’une agonie’.
Mais le caractère exceptionnel de la chanson française n’a été ni la seule préoccupation des deux journées, ni la seule découverte. Pour beaucoup dans la salle (Fabien Hein : ‘Jésus, Satan et les musiques populaires’, Damien Tassin : ‘Le « Gai Savoir » des pratiques rock’, pour n’en citer que ces deux exemples), les musiques populaires, c’est avant tout le rock, ou—comme l’on dit beaucoup plus en anglais qu’en français—pop music : les musiques nées depuis l’avènement du rock’n’roll, et plus ou moins sous son influence. Catherine Rudent s’est demandée s’il y a ‘une façon de sonner’ populaire, et a suggéré que ce soit la répétition. Dans une communication particulièrement riche, François Ribac, répondant à sa propre question provocatrice, ‘pourquoi les Beatles sont-ils anglais ?’, c’est-à-dire pourquoi les musiques anglophones ont-elles été ‘populaires’, a souligné l’importance des travaux empiristes des scientifiques et ingénieurs britanniques depuis Newton, travaux qui dans les studios d’enregistrement du vingtième siècle ont favorisé une démarche expérimentale chez les ingénieurs du son.
Ainsi, sans que cela soit directement prévu au programme, beaucoup des débats se sont spontanément portés sur les définitions conflictuelles du terme ‘populaire’. Mot piégé par sa 'polysémie’ (Stéphanie Molinaro : ‘Le Concept de musique populaire à l’épreuve de la réalité sociale du rap’), sa ‘malléabilité’ (Vincent Rouzé : ‘Populaire, vous avez dit populaire ?’), et surtout par l’analyse misérabiliste des ‘Bourdivins’, qui ont mis en circulation une distinction fort douteuse et hiérarchisée entre la fonction esthétique du savant et une fonction présumée sociale du populaire. Pour certains, le populaire garde son sens séculaire : celui du Front populaire de 1936, comme Jacky Réault l’a déclaré dans l’un des débats et confirmé dans sa propre communication, ‘La Chanson comme mobilisation populaire’. Pour d’autres, peut-être majoritaires, le ‘sens anglo saxon’ des musiques dites ‘populaires’, défini par plusieurs intervenants comme ‘musiques de masse’ ou ‘musiques connues de tous’, est dominant. Mais ce clivage sémantique est, pour moi, moins béant qu’on ne pourrait le croire, car ce fameux sens anglosaxon est en réalité plus complexe, la notion de ‘musiques de masse’ étant toujours contaminée par le sens (francophone) de ‘musiques du peuple’, ce qui donne en effet une double légitimité à la pop-music, à la fois commerciale et sociale.
Plusieurs communications ont interrogé en effet l’enjeu de cette légitimité par l’entremise de l'opposition apparemment binaire entre haute culture et culture de masse. S. Molinaro et Anne Pétiau ont cherché à repenser la notion de musiques populaires à partir, respectivement, du rap et des musiques électroniques. Olivier Julien a exploité ses travaux antérieurs sur les Beatles pour situer les musiques populaires entre musiques folklorique et sérieuse : elles ne sont ni l’une ni l’autre mais composent une nouvelle synthèse urbaine et ‘phonographique’.
Dans la discussion qui a suivi ce papier et celui de V. Rouzé, qui tous les deux avaient mis en doute l’idée selon laquelle popular music égalerait musiques authentiques du peuple, il y a eu un débat passionné et passionnant sur la question, que J. Réault a su résumer en une revendication: ‘surtout ne pas créer une orthodoxie du populaire’. Ce qu’on pouvait observer en effet, c’était à la fois un glissement du langage critique francophone vers le sens anglosaxon, les frontières entre chanson et musiques populaires devenant de plus en plus 'poreuses’ selon Cécile Prévost-Thomas, mais en même temps un mouvement vigoureux de résistance à ce glissement. Ce qui montre qu’au moins les études sur les musiques populaires francophones se trouvent aujourd’hui à un carrefour, alors qu’en 1989 il semblait s’agir de deux routes parallèles qui n’allaient jamais se croiser.
La question de la légitimité s’est aussi posée sous deux angles bien différents de ceux-ci. Premièrement, des approches comparatistes, ou le populaire a été cerné à travers l’histoire de l’art (Emmanuel Parent), les musiques expérimentales (Matthieu Saladin), et le dualisme musique de création/musique d’exploitation (Barbara Sallé). Et deuxièmement, par le biais de la politique culturelle. Jean-Charles François, aidé par son collègue Eddy Schepens (qui aussi prononcé le mot de la fin), a montré dans son intervention sur le Cefedom Rhône-Alpes à Lyon que le débat entre musique sérieuse et musique de masse n’est pas que théorique mais retentit au niveau institutionnel. A Lyon, en 2000, à la suite d’initiatives prises par Catherine Trautmann, alors Ministre de la Culture depuis 1997, il fut décidé que, en plus du jazz déjà reconnu, il fallait accueillir toutes les pratiques musicales, même les musiques actuelles/amplifiées. Mais, à en croire J.-C. François, c’est une chose de reconnaître ces musiques ; c’en est une autre de les faire cohabiter avec les musiques déjà en place, car il y a toujours ‘un refus de vivre ensemble’. Autre vecteur de légitimation, les quotas radiophoniques, dont Bruno Rodriguez a retracé les enjeux depuis leur mise en place en 1994-1996. Le Québec a des quotas depuis 1971, mais Martin Lussier, doctorant en communication à Montréal, a plutôt souhaité aborder la légitimité sous une autre forme : celle de la logique de la catégorie institutionnelle à l’oeuvre aux premières ‘Bazarderies’ tenues à Montréal en 2005 pour explorer et consolider les musiques dites ‘émergentes’. Ici, le chemin de la reconnaissance, c’est la dénomination tactique, car pour que la scène émergente existe, ‘il faut la nommer’.
La dénomination comme moyen de légitimation peut aussi expliquer la montée depuis les années 60 de la notion politique de francophonie, traitée par C. Prévost-Thomas. Derrière la création d’institutions comme le Conseil francophone de la chanson, il y a un désir d’affirmer non seulement une langue partagée (180. 000 Francophones dans le monde), mais aussi des éléments culturels : ‘une solidarité qui permettrait de partager des valeurs communes’. Bien sûr, le problème que cela pose est de savoir identifier ces valeurs, car les communautés linguistiques concernées sont souvent éloignées géographiquement et culturellement les unes
des autres. C’est toute la question posée par le point d’interrogation figurant dans le sous-titre du colloque et c’est une question que nous n’avons pas suffisamment approfondie, d’autant moins qu’une grande proportion des communications étaient en réalité focalisées sur la France—ironie, puisque nous étions en Belgique. Cette problématique pourrait être poursuivie par la branche à l’avenir, et peut-être à la lumière de nouvelles perspectives ouvertes par les études post-coloniales.
En 1989, à Paris, la confrontation souhaitée entre cultural studies anglophones et recherches francophones sur les musiques populaires, c’est, selon G. Guibert, ‘la guerre de Paris [qui] n’aura pas lieu’. En 2007, à Louvain-la-Neuve, cette ‘guerre’ a bien eu lieu mais il ne s’agissait plus d’une guerre. Ce qui m’a frappé, c’est que les études françaises, plutôt fermées sur elles en 1989, se sont admirablement ouvertes depuis au dialogue international. Le problème, c’est que le monde anglophone n’a guère renvoyé l’ascenseur, bien que les choses commencent à bouger. C’est cette invisibilité des musiques francophones d’Europe au sein des préoccupations dominantes de l’IASPM qu’il faut contester. Cette ambition ne doit pas pour autant signifier l’abandon de la spécificité des approches analytiques francophones. Pas de pensée unique. Le caractère hautement innovateur des cultural studies, de pair avec l’hégémonie mondiale de la langue anglaise, risquent de faire croire à de nouvelles générations de chercheurs francophones qu’il faut obligatoirement passer par là. En effet, il faut passer par là sans doute, mais il est impératif que cela ne revienne pas à un nouveau conformisme. Les études sur les musiques populaires internationales ont besoin des francophones d’Europe, justement parce que les questions posées, les méthodes adoptées par ceux-ci sont ‘exceptionnelles’ : elles ont une autre couleur, une autre histoire, elles proviennent parfois d’une autre vision de la culture et de la société et c’est très bien comme cela.1 Pour qu’il y ait confrontation, synthèse, il faut qu’on soit deux. D’ailleurs, bien que plus institutionnalisés aujourd’hui qu’à leur naissance, les cultural studies en Grande-Bretagne comme aux États-Unis sont loin d’avoir une identité stable et sûre d’elle. Les perspectives que nous avons échangées à Louvain-La-Neuve se doivent donc de s’y frayer une place. La branche francophone d’Europe est maintenant là pour cela.
David Looseley
Université de Leeds, Royaume-Uni
Notes
1. Le groupe international de recherche sur les cultures populaires que j’ai récemment lancé à Leeds (Leeds Popular Cultures Research Group) a justement pour ambition de situer, de‘localiser’ les cultures populaires dans leurs contextes nationaux, culturels, linguistiques, etc.(voir le paragraphe du site intitulé ‘Locating Popular Cultures’). La langue de travail du groupe est l’anglais, mais ses membres sont de diverses nationalités et il rassemble, entre autres, beaucoup de linguistes : francophones, hispanophones, italophones, etc. Pour d’autres renseignements, voir http://www.leeds.ac.uk/smlc/Popularculturesresearchgroup.htm
Annexe 2
insérée le
27 février
2011.
Ce document
osant nommer
"l'impuissance
et la
lâcheté de
l'Union
européenne"
concernant
notamment
les
chrétiens
d'orient,
nous paraît
d'une
importance
capitale
quoiqu'il
n'émane pas
de la
hiérarchie
de l'Eglise
de France ou
de simples
fidèles mais
d'hommes
politiques
relayés par
le quasi
officiel
"France
catholique".
Les
catholiques,
certes bien
affaiblis
s'aperçoivent-ils,
même s'il
est trop
tard
peut-être,
qu'après
avoir été
les
principaux
initiateurs
d'un
appareil
d'Etat dit
"européen"
dès le
traité de
Rome, et
toujours
plus depuis
séparé des
peuples, ils
sont comme
les peuples,
les nations,
les citoyens
de
républiques
qu'ils ont
ainsi
contribué à
désouverainiser,
les
personnae
nullae d'une
machinerie
financière
culturellement
réduite à la
chosification
nihiliste
des êtres
humains
réductibles
à une espèce
biologique
c'est à dire
pré ou
a-symbolique
et donc
offerte aux
manipulations
sans limites
(A Supiot)
d'une
techno-science
financiarisée,
comme
anthropologiquement
(avec le
déni des
sexes et de
l'humanisation
progressive
de
l'embryon),
à la
"débandade
de la
raison"
Il est
évident que
l'éventuelle
prise de
conscience
plus large
d'une telle
réalité dans
les
différentes
sphères de
la nébuleuse
catholique
d'Eglise
(bien
affaiblie)
et/ou de
culture
(toujours
largement
majoritaire),
- qui
supposerait
un
engagement
conséquent
des hommes
politiques
de cette
pétition
d'un jour-,
aurait des
effets
politiques
pertinents
d'une grande
portée. On
s'efforcera
de les
mesurer (
avec les
moyens que
nous avons
mis en œuvre
dans notre
article
"Nicolas et
Ségolène
2007..."-
sur ce site)
lors des
prochaines
échéances
électorales
entraînant
peut-être de
nouvelles
contradictions.
Cette
interrogation
ne signifie
pas que nous
nous
illusionnons
sur l'enjeu
réel de ces
liturgies si
neutralisées
au sein
d'une
"démocratie"
toujours
plus
désubstantialisée
par la
mondialisation
- Guy Bois-
et l'effet
de levier
supplémentaire
qu'y apporte
le consensus
européiste
des deux
partis "de
gouvernement"
majoritaires
de l'ex
gauche et de
la quasi
droite.
_______________
Document
emprunté à
France
CATHOLIQUE
dont, sans
évidemment
partager
toutes les
positions
nous lisons
avec profit
depuis
longtemps la
liste de
diffusion
notamment
pour leur
courageuse
résistance à
l'euthanasie
rampante qui
serait, sous
prétexte de
dolorisme
humaniste
syncrétique,
le triomphe
tardif de la
déshumanisation
hitlérienne
du monde.
Jacky Réault
27 février
2011
Début
du Document
L’Europe et
les libertés
religieuses :
Dominique
SOUCHET
dénonce
l’impuissance
et la
lâcheté de
l’Union
européenne
mardi 1er
février 2011
Dominique
SOUCHET, député
de la Vendée et
initiateur de
l’appel des
parlementaires
en faveur des
chrétiens
d’Orient, se dit
profondément
choqué par la
décision prise
hier par l’Union
européenne de ne
pas condamner
les atteintes à
la liberté
religieuse au
Moyen-Orient.
Alors que la
France, la
Hongrie,
l’Italie et la
Pologne avaient
insisté pour que
les 27 adoptent
une déclaration
sur les
persécutions
antichrétiennes,
notamment en
Egypte et en
Irak, l’Union
européenne a
préféré se
réfugier dans la
neutralité en ne
mentionnant
aucune
communauté
spécifique ni
aucun pays en
particulier.
Ce silence de
l’Union
européenne, qui
constitue un
aveu
d’impuissance et
de lâcheté, ne
peut
qu’encourager
ceux qui
cherchent à
déstabiliser les
communautés
chrétiennes du
Moyen-Orient à
poursuivre leurs
intimidations et
leurs attentats.
La diplomatie ne
consiste pas à
refuser de
nommer les
réalités, mais à
les affronter
avec courage et
intelligence.
Devant la
carence de
l’Union
européenne,
Dominique
SOUCHET et les
230
parlementaires
français qui ont
désormais
rejoint son
appel lancé il y
a quelques
semaines,
invitent le
Président de la
République et le
Ministre des
Affaires
étrangères à se
tourner de
manière
privilégiée vers
les Nations
Unies.
Il appartient
désormais au
Conseil de
sécurité de
rappeler
solennellement
aux Etats que la
protection de
leurs minorités
religieuses et
l’un de leurs
tous premiers
devoirs.
Dominique
SOUCHET
Député du
Mouvement Pour
la France
Membre de la
Commission des
affaires
étrangères de
l’Assemblée
nationale
Conseiller des
affaires
étrangères
La France doit
porter la voix
des chrétiens
d’Orient
par Dominique
Souchet,
député de la
Vendée,
conseiller des
affaires
étrangères
Le cri d’alarme
des chrétiens
d’Orient n’a
jamais été aussi
fort. Les
persécutions et
les attentats
dont ils sont
victimes les
poussent plus
que jamais à
l’exode. Le
risque de
disparition des
communautés
chrétiennes du
Moyen Orient est
donc réel. Nous
ne pouvons
rester inertes
ni indifférents
devant une telle
perspective.
Nous devons
agir, à la fois
à très court
terme et pour
assurer dans la
durée la
sécurité des
chrétiens
d’Orient.
L’horrible
attentat de
masse
d’Alexandrie est
venu illustrer
dramatiquement
les craintes que
nous exprimions
juste avant
Noël. Cet
attentat
confirme que
nous sommes en
présence d’une
stratégie
délibérée qui
vise à
déstabiliser les
communautés
chrétiennes du
Moyen-Orient,
ainsi que les
Etats dont elles
constituent la
composante
originelle. Face
à ce mouvement
de fond, la
France doit
rappeler
fermement que la
vocation d’un
Etat est de
protéger la vie
de l’ensemble de
ses citoyens et
d’assurer la
sécurité de
toutes les
composantes de
sa population.
Pour éviter
qu’un tel drame
ne se
reproduise, nous
demandons au
ministre des
Affaires
étrangères
d’intervenir
auprès des
autorités des
pays du Moyen
Orient
concernés, pour
leur demander de
prendre des
mesures de
sécurité toutes
particulières
autour des lieux
fréquentés par
les chrétiens,
spécialement à
l’occasion des
fêtes
religieuses.
Nous rappelons
qu’il est dans
la tradition
diplomatique de
la France de
porter la voix
des chrétiens
d’Orient. La
France, en
raison de sa
politique
étrangère
équilibrée,
dispose d’une
grande
crédibilité dans
cette région du
monde et elle
peut jouer un
rôle majeur en
faveur de la
protection des
minorités
chrétiennes
d’Orient. Elle
peut et doit
peser de toute
son influence
pour demander
aux pays
concernés d’être
les garants du
libre exercice
du culte sur
leur territoire
et les
protecteurs,
face au
sectarisme
fanatique, des
minorités
religieuses
menacées de
disparition. En
Irak, elle doit
user vis-à-vis
des autorités de
la capacité
d’influence que
lui confère
l’aide apportée
à la formation
des forces de
sécurité.
Depuis 2007, la
France a
accueilli 1.300
chrétiens qui
ont fui l’Irak.
Cet accueil est
nécessaire et il
honore notre
pays. Mais il
est sans effet
sur le processus
d’épuration qui
vise aujourd’hui
les chrétiens
d’Orient. Si
rien n’est fait
pour garantir
sur place leur
sécurité, leur
exode risque de
s’accélérer de
manière
dramatique.
Nous savons que
le contexte
politique et
culturel de la
région rend
difficiles des
solutions
immédiates. Mais
nous demandons
au gouvernement,
au-delà des
mesures
d’urgence que
nous
préconisons,
d’agir avec
détermination et
fermeté auprès
des instances
internationales
pour faire de la
protection des
minorités
religieuses une
priorité.
La France doit
user de son
influence pour
que les pays
dont la
législation est
inspirée de la
charia
reconnaissent le
droit de chaque
personne humaine
à exercer sa
liberté de
conscience.
Notre pays, qui
s’est toujours
donné pour
mission la
défense des
droits
fondamentaux, ne
peut plus rester
sourd devant les
intimidations,
les conversions
forcées, les
appels au
meurtre, les
enlèvements et
les attentats
qui rythment
chaque jour la
vie des
chrétiens dans
un nombre
croissant de
pays. Il est
important,
enfin, que notre
pays, en tant
que membre
permanent du
Conseil de
sécurité des
Nations Unies,
prenne
l’initiative
d’un projet de
résolution qui
aille au-delà de
la déclaration
un peu pâle qui
a été adoptée
après l’attentat
de la Toussaint
à Bagdad, même
s’il s’agit d’un
pas dans la
bonne direction.
Il est essentiel
que le Conseil
de sécurité
réaffirme
solennellement
le droit de
toutes les
minorités à
pratiquer
librement et en
sécurité leur
religion. Les
chrétiens
d’Orient doivent
se voir
reconnaître le
droit de vivre
en paix sur la
terre où ils
sont présents
depuis les
premiers
siècles. Ils ne
doivent plus
être forcés de
choisir entre la
conversion, la
mort ou l’exil.
Dans une région
aussi sensible
que le Proche et
le Moyen Orient,
personne n’a
intérêt à voir
disparaître les
minorités
religieuses, car
elles sont des
éléments
irremplaçables
d’équilibre
social et des
vecteurs de paix
permanents.
Œuvrer pour le
maintien de leur
présence, c’est
œuvrer pour la
paix. Notre
diplomatie doit
donc s’engager
résolument en
faveur de ce
combat pour la
liberté de
conscience. En
agissant ainsi,
elle œuvrera
efficacement en
faveur de la
paix dans tout
le Moyen-Orient.
A l’inverse,
l’absence de
réaction
diplomatique
suffisamment
forte de la part
de la France,
serait
immanquablement
interprétée
comme un
encouragement au
départ par des
communautés qui
sont aujourd’hui
menacées
d’élimination.
Sont signataires
de cet appel au
1er février 2011
…
…
Consulter Le
site France
Catholique.
(note de
l’éditeur de
www.sociologie-cultures.com
)
Répondre à cet
article
·
L’Europe et les
libertés
religieuses :
Dominique
SOUCHET dénonce
l’impuissance et
la lâcheté de
l’Union
européenne
1er
février 20:12,
par BRUN Daniel
Honte à la
Commission
Européenne.
Honte aux
représentants
des Etats qui
n’ont pas voulu
faire cette
démarche. En
outre, dans ces
conditions, on
se demande à
quoi sert le
service
diplomatique
(Mme Ashton,
etc.), dont elle
s’est dotée à
grand frais , et
qui démontre sa
totale
inutilité.
Lamentable. On
avait déjà eu le
coup de
l’agenda.
L’Europe est un
ectoplasme.
Fin du
document France
Catholique que
nous remercions
de cet emprunt
non sollicité
mais référencé
et respectueux.
ANNEXE 3
L'heuristique
sans phrase de
l'image...
Disparues
les multiples figures
visibles du peuple?

Celle du 24 avril 2013
en France hantera
longtemps les mémoire
sauf à être dépassée si
la souveraineté du
fantasme oligarchique
s'obstinait !

mais
celle de l'esplanade des
Invalides le 26 mai
2013, signifie l'entrée
en résistance adjugée
une Fête de la
fédération venue de
TOUTE LA FRANCE (La Débacle des bobos
mondialisés de
Libération, selon son
propre titre)

Une
masse sombre de 1
million
et
demi de parisiens
derrière l'Etat
socialiste et les
caciques de l'occident
avec de rares drapeaux
de la République, (La
Croix.com.) le 11
janvier 2015 à Paris
l
11
janvier 2015, une autre
modalité de la métonymie
multitudinaire du peuple
dans laquelle la part
indéniable et,
effectivement
"spectaculaire", au sens
de Guy Debord, de
l'émotion spontanée et
de l'engagement lucide
se balance d'un
encerclement radical par
l'unanimité
récupératrice du pouvoir
politique et des media.
|
|
Evenements
Colloque
(Appel à communiquer)
Nantes
Le 8° Eté du Lestamp
La
normalité
-Vous avez dit normal ?
-Comme c'est normal !
se déroulera les 27, 28, 29 juin
2013
Un
slogan
au journal de TF1 fait de
normal le mot élu de l’année
2012 sur les scènes mêmes qui
l’en avaient banni. Si la vie
normale est l’aspiration de ceux
qu’elle fuit, l’idée d’une
normalité des actes, idéaux,
désirs est étrangère au discours
admis, une faute de goût. Que
signifie ce décalage, par
quelles idéologies l’anormalité
se fait norme, la conformité,
normalité ?
Que disent encore, la sociologie
hantée par les valeurs et
l’évaluation, du tranchant
statistique pour dire l’anormal
et le normal, sinon la crise,
l’ethnologie si la normalité de
l’autre mue en relativisme
mondain, les dites
sciences du relativisme
absolu du « construit social »
courant à la normalisation
d’Etat en tout « genre » ? A
l’abrupt de la normalité
s’éprouvent, l’aporie du no
limit en lien aux
oligarchies séparées du commun,
la tyrannie d’un empire du
bien fin de l’histoire en la
mondialisation.
La normalité, la
normativité, la
norme,
l'anormalité,
l'anomie, la
crise, la
pathologie...
des clés
généralistes
pour les
social
scientists,
philosophes,
juristes que cet
appel mène à
Nantes 27, 28 29
juin 2013 ?
Pour des
interventions de
vingt à vingt cinq
minutes, débat non
compris, les
propositions en
moins de mille
signes seront à
adresser avant le 7
juin, à
joelle.deniot@wanadoo.fr
et
jacky.reault@wanadoo.fr
pour
réponse avant le 3
juin 2013.
Consultez l'appel à communiquer
Evenements
LIRE AUSSI,
Retour
des
peuples ou
massification planétaire
?
Mai 2011 :
3 mai 2011
Un
ex(?) roi à New-York
?
juillet 2011
Cliquer pour atteindre
ce texte.
Juin 2011, Dix ans après
les Twins towers deux
icones vivantes des
sociétés de la
mondialisation
engendrées par la même
scène encore centrale,
New-York, re
problématisent les
élections
présidentielles
françaises de 2012.
Une
planète entière prise en
otage d'une imposition
médiatique
obscènessionnelle de
l'icône héroïsée d'une
hyperbourgeoisie
mondialisante, dont
l'ombre semble pétrifier
les post-hommes
politiques et
intellectuels
français, alors que
leurs homologues
américains dont ils
aiment tant se gausser,
se montrent beaucoup
plus - finalement-
libres.
(Le Monde
11 juillet 2011) (
Les
développement de ces
remarques faites à chaud
depuis mai 2011 ont été
transférés sur le
fichier autonomisé à
cliquer sur la colonne
gauche de l'index (d'ici
cliquer sur l'entête):
New-York 2011 l'autre
pays du mensonge
déconcertant
?)
Dernières
publications de J. Réault
Eros
et Liberté, Trois essais de sociologie
et d'histoire.
Paris Le Manuscrit
2014
avec J Deniot...
Cliquer
sur les images
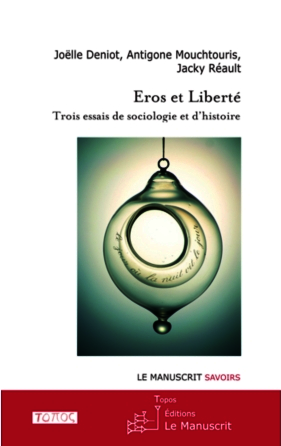

J. R., A Nantes à
l'Université de 1968 à 2008,
De Nicos Poulantzsas à Cornelius Castoriadis,
deux
ponctuations grecques grecques
d'un itinéraire
sociologique
en France à Nantes (1968-2009).
in A Mouchtouris, P Christias,
Actualité de
la pensée grecque.Paris Le Manuscrit 2014

10°
ETE DU
LESTAMP
30
JUIN 1°
JUILET
2
Juillet
a nantes
LE MAL
Aux
LIMITEs
des
sciences
sociales
__________

Pour
soumettre
un
projet
de com.:
joelle.deniot@wanadoo.fr
et
jacky.reault@wanadoo.fr

|
Droits de
reproduction et de
diffusion réservés ©
LESTAMP - 2005
Dépôt Légal
Bibliothèque Nationale
de France
N°20050127-4889
|

