Photo J. Réault Juillet 2003
copyright
Ultime
Chantier naval de Nantes après
le refoulement
ouvrier. S'estompant
dans l'histoire, la
classe
ouvrière ouvre une page
blanche- Que faire de "la
classe"
du Lersco (JR 2005), refoulés de
la ville (Nantes) par la
bourgeoisie "culturelle",
périphérisés, les ouvriers
empaysée s'auto-émancipent comme
peuple
par de nouvelles mobilisations
privatives d'abord typique de
la
prolétarisation inachevée
(vr
aussi
l'article
Prolétarisation...
du Colloque Lersco de 1992
in
www.lestamp.com
)
mais aussi collectives, de
mondes et milieux
populaires hétérogènes
localisés, mouvement chasseur,
révoltes d'usines aux
délocalisations, et
inséparablement de nation, nœuds
de la crise politique de la
représentation depuis 1984.
Sur Nantes, Jacky
Réault L'excès-la-ville
; cliquer articles
in
www.lestamp.com
_______________
PRELUDE
(2009-2010)
à
Les
ouvriers
de
la
classe
au
peuple
Résumé des thèses avancées sur
l'usage théorique et historique
possible des mots Classe(s)
Classe Ouvrière Peuple Milieux
populaires.
Jacky
REAULT
Mai-septembre 2009
Après
la "classe
ouvrière" historique,
dont, dans un ultime texte
énigmatique que nous avons édité
pour débattre, sur ce site en
juin 2005)Jean-Paul Molinari
s'était évertué, sur l'étrange
commande de Michel Verret, à
pérenniser l'appellation devenue
anachronique, les
ouvriers
réels affranchis d’une séculaire
et discriminatoire condition(note
in fine),
vivant au sein de formes
de vie socialement variées,
participent des cultures et
des
mobilisations
privatives
d'abord (primum
vivere)
mais collectives
aussi et
toujours plus par la
manifestation quand le concert
redevient national), des milieux
populaires territorialisés de la
France une et diversité
(Braudel).
Mobilisations...
,..
pour d'abord leurs formes de
vie, le
chez soi
(Bachelard et J Réault Amiens
H-P, 5 décembre 2008) de leur
prolétarisation conjurée dans les
emboitements de territoires
inégalement appropriables, valant
mieux que l'en soi d'une
réduction économiste de leur
identité ; le pour soi
de
leur conscience s'étant
libéré de l'indexation à un
parti politique les liant aux
murs d'une usine de surcroît
devenue aussi milieu
populaire de facto
différencié. (J R 1989)
- ...pour et
dans la société salariale
(M Aglietta, A. Brender)
française délaissée par leurs
ex-représentants prétendant
depuis 1983-4 (le tournant
mitterrandien de l’indexation du
franc au mark donc à échéance de
l'asservissement de la France à
l’appareil européen de la
mondialisation) priver ce
peuple
ré advenu de sa souveraineté
politique donc de la garantie d'Etat
de l'indexation de la croissance
au progrès social, de la
normalisation du rapport
salarial, par la Loi et le
contrat, tout cela dénoncé comme
défense corporative d'avantages
acquis, puis comme
ethnocentrisme nationaliste
voire
pire(1)...
- ...au sein d'un
peuple
social
trop abandonné à sa défensive
localiste, la seule qu'il peut
s'approprier face à la
mondialisation, par
l'obsolescence des
confédérations syndicales
et leur défection dans la
résistance antimondialiste, -
sauf lors de ses cycliques
mobilisations sauvages (?)
inscrites dans le temps long de
l'histoire nationale-,
périphérisé occultés
politiquement disqualifiés dans
l'identité négative à
l'instar des rurbains, des
ruraux, du mouvement chasseur
des grèves perdues de
délocalisation, ils sont
toujours là, personnes,
familles, lignages, voisinages,
grand et petits pays. Ils sont
virtuellement plus forts d'être
(re ?) devenus et plus
radicalement travailleurs libres
(JR 2003), et normalement
peuple
dans toutes ses harmoniques,
et relativement stabilisés
quoique subissant, depuis
1983-1984, comme tout le
salariat et la société même,
pour autant qu'elle est
abandonnée à la mondialisation,
de nouvelles formes de
prolétarisation, un peu plus
cependant quand vient la grande
crise. (2008-9). Cependant elle
engendre aussi en France des
mobilisations défensives
radicalisées, intégrant la
rationalité spéculative des
managers du capitalisme
financier en impliquant la
publicité des media pour
négocier des primes compensant
au plus près possible leurs
licenciements boursiers et délocalisateurs, fut-ce au prix
de prise en gage de
cadres, de produits, d'outils de
travail voire d'usines.
Modernité d'une antique action
directe populaire au sein de
milieux solidaires localisés
(Jean Nicolas, La rébellion
française. Seuil 2002) et
toujours désormais contre un
capital étranger et mondialisé
se mettant en deçà donc du seuil
de la common decency
(Orwell).
Quand elle n'est pas portée par
de vivants sujets de l'histoire
supports d'un mythe fort,
porteur
d’idéaux offerts à l’ensemble de
la société,
la
"classe"
n'est qu'un fétiche
de l'intellectualisme
scholastique
et/ ou le verbalisme
transférentiel des nostalgiques
du marxisme stalinien ou
trotskiste.
Si l'on peut
penser sans doute
heuristiquement comme
classes, l'hyperbourgeoisie (D.
Duclos) mondiale, ainsi que les
classes parlantes et ou
culturelles qui la relaient
contre leurs peuples dans les
grandes villes de l'archipel de
la mondialisation,
les
sujets historiques de la
résistance du temps de la
mondialisation
(JR,
2004), sont des peuples, non des
classes :
peuple
politique
(nation) (Ramsès Janvier 2008),
peuples (tissus populaires)
immédiats des milieux
historiques d'habiter, de
travail, d'aires
d'emploi, (modalités du
peuple
social),
vaste
peuple
sociétal
du socle
culturel commun de mémoire et de
langue, menacé par
l'acculturation centrale
programmée (Bastide), et
l'injonction d'identité négative
(E. Todd) ensembles de peuples
au sein d'aires historiques de
civilisations (F. Braudel),
(exemple le retour politique des
peuples
latino-américains). Tous sont à
inscrire dans les rapports
sociaux de l'accumulation
primitive continue (Meillassoux)
plus ou moins nationalement
valorisable mais surtout de
l'accumulation générale du
capital financiarisé pour la
valorisation de l'inégalité du
monde -- à partir d'un centre
(Braudel), là où git la
contradiction principale
donc la première clé
d'intelligibilité.
L'ancienne
dynamique de
classe
ouvrière
(sans doute plus auto-dissoute
par la libre ré identification
ouvrière et la conquête,
d'ampleur civilisationnelle de
la vie privée, que broyée par
une mondialisation
abusivement fétichisée)
peut-elle cependant
rejouer, plus ou moins
sur-jouée, autour de mémoires
localisées encore vives mais
surtout quand la mémoire de
l'efficacité nationale pratique
revient amorcée par un évènement
fort ou un moment de cycle ?
Qu'en est-il par exemple de la
révolte des licenciés d'usines
en 2009, du resurgissement d'un
esprit offensif lors des
mobilisations nationales du
printemps finalement étouffées
par les confédérations ? Ainsi
dans l'aire d'emploi de
Saint-Nazaire (cf.
Les
ouvriers
de Saint-Nazaire ou la double
vie),
et chose étrange avec une
majorité de jeunes gens disparus
depuis si longtemps des
mobilisations collectives ?
Certes c'est le contexte de
résurgence d'un vaste
peuple
social, sociétal mais surtout
d'extension nationale dans les
manifestations de fin janvier et
du 19 mars, que peuvent exister
ces résurgences plus ou moins
"ouvrières", voire
"prolétariennes" (jeunes
chômeurs) voire dans des
réminiscences d'une culture de
luttes de classes dont l'E Todd
d'Après la démocratie, Seuil
2008)rêve le retour face à
l'ethnicisation
mondialiste(2008, op.cit.) que N
Sarkozy hésite cependant à
instituer au pays de l'Egalité
républicaine. La crise
générale du monde risque de
multiplier ce genre de rejeu et
d'interférences aussi bien
qu'induire des formes totalement
inédites à la fois régressives
et/ou inventives. L'histoire
bouscule souvent les sinistres
fata de l'évolution, ce vieux
machin du 19° récupéré comme
idéologie de la mondialisation
comme de la vacuité sociologiste
pas seulement tourainienne. Si
les rapports sociaux de la
mondialisation imposent
tendanciellement
l'hégémonie du
peuple
national , c'est à dire
politique (voir la
constitutionnalisation de son
intérêt national par l'Allemagne
de 2009 tournant le dos au
Monopoly fou de l'Europe
fédérale des régions, c'est à
dire des ethnies irréductibles),
(ou d'alliances transnationales
circonstanciées) dans
toute mobilisation pertinente,
il faut se garder de toute
prophétie ; l'histoire, à
l'inverse de la zoologique
"évolution", asile de l'ignorance
sociologique comme du
libéralisme ou de l'ex
progressisme sur ce point
convergents (Claude Michéa,
Impasse Adam Smith,
Climats 2002), exclut tout
destin adjugé.
Entre survivances et résiliances
D'une
part les
appareils politiques et
syndicaux de représentation
populaire voire (post, néo ?)
ouvrière, n'ont pas disparu
quoique pour l'essentiel
désubstantialisés. .
Jusqu'aux ex partis
ouvriers,
moins le PS irréversiblement
rendu obsolescent par sa
collaboration active au dépeçage
de la société salariale
française, qu'un PCF, certes
nanifié mais relayé par une
nouvelle extrême gauche, confuse
et brouillonne mais dont la
somme arithmétique (12 à 13 %)
n'est pas si loin des formations
très intégrées à l'ordre
financier mondial (Verts Ecologie, PS), lors des
élections européennes de
Juin 2009, où la multitude du
peuple
s'est délibérément abstenu. Les
confédérations syndicales
devenues sauf exceptions
régionales, minoritaires n'en
gardent pas moins la capacité à
se dilater et de faire encore
figure lorsque l'ampleur des
mobilisations d'entreprise ou de
rue les contraint à accueillir
l'échelle et le sens national
régulièrement réactivés.
Présence ouvrière et transfert
historique de mémoires
de classe dans les
mouvements populaires de plus ou
moins résistance à la
mondialisation en France
1995,
2003, 2010 constituent les
marqueurs de cette capacité à
renationaliser les résistances
populaires en usant de la forme
sociale instaurée par la
conjonction du mouvement ouvrier
historique et de la société
salariale, le syndicalisme
confédéré qui continue d'être
résultante d'une centralisation
parisienne forte de ses centres
de décision et des initiatives
de ses syndicats de base très
autonomes gardant de facto une
culture certes édulcorée mais
par sur les principes de
l'anarcho-syndicalisme plutôt
que du syndicalisme
révolutionnaire. Même si ce sont
les positions acquises
sanctuarisées dans la fonction
publique et surtout , pour le
secteur marchand ou marchandisé,
les services publics, qui
constituent les bastions de ces
mouvements, on ne peut pas
ignorer que ce sont le
producteurs plus ou moins
directs (énergie, transports,
poste) qui constituent le fer de
lance.
A
l'automne 2010, même les media
par ailleurs quasi monopolisés
par le pouvoir financier doivent
laisser à voir ces collectifs
populaires à forte tonalité
ouvrière et technicienne, aptes
à tenir des positions d'une
guérilla qu'on pourrait dire "de
classe", par les nuits les
commandos de blocages des routes
et des accès, les braséros
fraternels. Le caractère
national est alors manifeste il
est donc politique et fait
intervenir de vastes entités qui
se dé-virtualisent dans ces
actions directes, et qui
rappellent les concepts de
détermination d'une classe
sociale mais si vaste et
s'étendant si loin dans le
salariat dont la majorité semble
appuyer depuis 1995 ces grèves
par procuration (sanctionnées
par les sondages révélateurs des
solidarités) que c'est bien le
concept de peuple,
inséparablement social national
et sociétal (Réault 2009) qui
s'impose, mais la culture de
classe y resurgit plus ou
moins rejouée et les ouvriers et
leurs héritiers techniciens y
donnent un moment l'essentiel de
la tonalité.
Nous avions dans
un moment historique
intermédiaire (1992, Colloque,
1995, publication) avancé le
concept à moyenne portée de
Mondes ouvriers(3). D'autres ont avancé la formule
de
peuple-classe.
Pourquoi pas si
on n'oublie par le caractère à
la fois indissolublement
politique et national. Mais la
formule nous paraît ambigüe et
nostalgique. Seul le
premier concept laisse dans la
mondialisation et sur fond
d'obsolescence historique
irréversible de l'ex-classe
ouvrière , la possibilité d'une
ouverture et d'un avenir et pour
le présent une capacité à garder
vivante ce qui reste la forme
conquise du 20° siècle et
notamment des Trente Glorieuses,
la société salariale d'un Etat
nation,
forme de constitution conquise,
et forme de résistance, à la
fois pratique et instituée des
peuples désouverainisés dans la
mondialisation et notamment dans
la prison de nations sous
tendancielle hégémonie allemande
que semble devenir l'Europe. Le
mouvement réel dans son
ensemble, dans son extension
nationale n'est plus et ne sera
plus ouvrier mais les
collectifs autonomes de la
guérilla quotidienne qui
tiennent les positions sur le
territoire, et dans leurs
traditions propres (Marseille
Saint-Nazaire, Amiens etc...)
dans les intervalles des
grandes manifestations
populaires touchant certes
l'ensemble de la société mais
toujours suspendues entre
la protestation expressive et la
messe d'enterrement, restent
comme des microcosme vivants
d'une force sociale ouvrière qui
n'a donc pas disparu de la
société n'a plus d'expression
que localisée, mais constitue
une composante stratégique de la
résistance populaire nationale.
Une "politique du
peuple" dans les écosystèmes
sociaux de reproduction ?
Mais en dehors de ces grands
évènements cycliques, qui
constituent une singularité
structurelle de l'histoire de
France, le récitatif de la
conjoncture sociale Braudel) de
temps long
est bien
cette culture d' action
directe
qui a resurgi de façon si
pugnace dans la résistance
ouvrière à la grande crise du
capitalisme financier
mondialisateur dès 2009,
sous formes de de blocages
d'usine voire de menaces de
sabotages, et surtout de
séquestration de cadres à qui
l'on impute les licenciements
multiples qu'engendrent la
cynique gestion financière de la
crise. Mais elle n'avait jamais
cessé d'exister hors des moments
de paroxysme, et plus
modestement (donc
structurellement) pour
augmenter le pouvoir de marché
des salariés dans une
négociation réaliste. Cycles de
mobilisation nationale
résultante de mobilisations
autonomes dans une conjoncture
plus vaste, ou simples
résistances localisées tout ne
nous ramène-t'il pas à la
grammaire historique de temps
long d'une
politique du
peuple
(Roger Dupuis Fayard 2002), dont
nous avons perçu la vitalité
souterraine jusque,
scandaleusement, dans la
victoire de Nicolas Sarkozy (JR
Mai 2010)voire aux jacqueries
tout autant et plus qu'à la
coutume ouvrière du 20° siècle
dominante au niveau national
dans les confédérations de
syndicats salariés ? Et c'est
peut-être plus une invention
rationnelle qu'une régression.
Jusqu'aux abstentions massives
de juin 2009 qui ne
puissent être pensées comme
action directe, activement
politique (après le déni du Non
à la constitutionnalisation
européenne du libéralisme et
l'imposition tyrannique du
traité de Lisbonne), formant
lien entre la
politique du
peuple
spontanée dans sa tradition
réflexive multiséculaire, la
politique de scène nationale
toujours plus désymbolisée
et l'Etat nécrosé et humilié
(l'obscène injonction d'août
2009 du remboursement
rétrospectif de ses aides aux
paysans) par l'appareil
européen.
Il n'en reste pas moins que ce
sont des
ouvriers
bien vivants singularisés dans
des milieux et des mémoires
spatialisées au sein d'écosystèmes
sociaux populaires de
reproduction
(J R
LERSCO NANTES,1989), qui
resurgissent ainsi, avec leurs
conjointes employées et leurs
lignages populaires pluriels,
certes fugacement, devant ces
écrans d'infamie qui les ont
refoulés depuis un quart de
siècle. Si pour les media
financiarisés
le réel
est //toujours plus //reporté à
une date ultérieure, - selon la
géniale formule de Philippe Muray de juin 2002 lors du
sociodrame grotesque de
manifestations contre le
suffrage populaire, Le Figaro)-,
n'est-ce pas toujours le
processus réel qui l'emporte sur
le temps long ?
L'œil du
cyclope sera -t-il percé par la
métis populaire et le bras
ouvrier d'Odysseus l'homme au
mille tour ? C'est de nouveau
l'usine (désormais directement
branchée sur la mondialisation
et sa crise et donc
radicalement désenclavée et
précarisée). Mais pas l'usine
fétichisée du marxisme. C'est
comme condensation d'un milieu
territoire et dans son tissu
social, qu'elle engendre
de fragiles mais robustes
sujets-forces sociales qui
semblent susciter dans une vaste
opinion populaire commune et
majoritaire du
peuple
sociétal
plus de
sympathique approbation que de
rejet. Ne font-ils pas rejouer
ce millénaire de révoltes
cycliques (Jean Nicolas, La
rébellion française, Seuil 2002)
qui constituent un des axes
identitaires de ce que les
partis de gouvernement depuis
1984, les classes parlantes
(le
pitoyable crachat d'historiens
de scène sur l'histoire de
France le 24 octobre dans
Le Monde au coeur même du
mouvement national qu'ils
vivaient sans doute les yeux
crevés) et l'appareil européen
se sont tant ingéniés à vouloir
désymboliser depuis 1984, La
France. Mais la
disparition obstinée des usines,
matrices d'organisation et de
direction, n'est-il pas le
processus dominant
et de facto,
la véritable catastrophe. Sans
retour ?
Jacky
Réault
Lestamp
et
Habiter-PIPS EA 4287 UPJV,
5
décembre 2008 Amiens, extrait de
Retour réflexif sur les
itinéraires de recherche) revu
13 mars 2009 et le 14 aout 2009
____________________
TROIS NOTES
APPENDICES CRITIQUES A PRELUDE
(CONDITION
OUVRIERE 2000
CONDITION POPULAIRE 2011,
Sté"phane Beaud)
(note 1 de 3 )
Voire pire....
y
compris très précocement par M
Verret (Où va la culture
ouvrière Sociologie du travail
1989 -I- et notamment
l'étonnante préface, véritable
symptôme d'anthropologie
régressive, au si Bel ordinaire
de Joëlle Deniot, la seule
ethnographie de la vie privée
ouvrière réalisée à la fois
par son auteur et son
appartenance d'origine). Si nous
lui devons pourtant la
clarté de certains concepts
analytiques avancés du temps des
fondations de sa période
nantaise au Lersco, dans son
passage des périphéries de la
"Basse Louise", (comme il
fantasme, par un prodigieux
lapsus, la Basse Loire dans son
oraison funèbre à J. P. Molinari
dans l'Humanité d'octobre 2004),
au centre parisien, id est le
"haut du haut," ne devint tout à
la fois, hiérarchiste radical
hanté par la seule verticalité
imaginaire des "stratifications"
sociales absolutisées,
mondialiste, européiste.
Faute de "classe
ouvrière" à diriger "de haut"
vers une Union soviétique, (sa
grande fascination biographique
à ses propres dires à
Bessin et A Madec 2005,
(Paysages d'un sociologue de la
culture ouvrière ), il inscrit
ses actions et ses œuvres dans
une triple défection : - à
l'égard du premier Lersco et de
ses travailleurs intellectuels
associés dont nous fumes, - à
l'égard de son primat
philosophique matérialiste
verbalement revendiqué du réel
sur sa connaissance et désormais
inversé, - à l'égard surtout des
devenus les derniers de la
classe,
les
ouvrier réellement vivant, qui
par leurs enfants reproduisent
encore un tiers de la nation et
face à la trahison de leurs
anciens représentants,
continuent de fortement peser
sur une vie politique dont le
spectacle est inversé par les
tenants des scènes, en prenant
le parti du retrait furieux
(abstention, vote Front national
cote CPNT, vote extrême gauche,
vote non à l'Europe des
oligarchies, d'où leur ancien
sociologue biographique les
disqualifie ou les relègue dans
une imaginaire "condition", dans
l'insulte suprême de la
bien-pensance bobo
cuisinée en l'occurrence par
Nicole Notat, "la
classe
raciste". , ou enfin dérive
stalinienne s'il en est dans le
refus théorique et
pratique d'une vie privée
ouvrière ou populaire. Cet
interdit de la vie privée a été
réitéré, toujours aussi
méprisant en 2005( Busson-Madec
Art. cit.) , vingt cinq ans
après qu'il nous eut disqualifié
et refusé un texte qui
s'essayait à sociologiser cette
hérésie marxiste, comme une
positive conquête réussie
d'accéder à la protection des
formes de vie et modes d'habiter
à l'égard de l'intrusion d'Etat
comme du contrôle social de
voisinage niveleur de
comportements. ( J R Essais et
Erreurs, La privatisation un
acquis et une borne?.
Lersco-CNRS Université de
Nantes, 1978-1979), annoté par
M. Verret. Nous n'en avons pas
moins développé une
problématique non rééducatrice
de la privatisation (et de la
déprivatisation) dans un
cours de longue durée sur la
sociologie des formes de vie.
Mais c'était tout un pan de la
thèse qui devenait interdit
alors qu'il dessinait la vaste
perspective d'une
déprolétarisation, concept
finalement interdit lui aussi.
Nous ne nous en sommes rendu
compte que trop tard. Dès 1989,
(Les formes de vie
ouvrière...LERSCO Nantes),°
nous synthétisons notre
vision dans le concept de
mobilisations privatives,
d'égale dignité anthropologique
et sociétale à nos yeux que les
mobilisations collectives,
quoique désormais principales et
au moins autant qu'elles ,
libératrices.
(Note 2/3)
Retour, assistantialo-médiéval,
d'une
"condition" ouvrière,
puis en rajoutAnt en 2011
une gluante
"condition populaire" !
Le
stupéfiant et anachronique
retour de ce vocable de notables
d'Ancien Régime (St Beaud)
"condition ouvrière" redoublés
par ceux qu'il est
tentant
désigner comme les nouvelles
dames patronnesses de la
sociologie disciplinaire d'un
"haut" se penchant pour
voir un "bas" (M. Verret),
et un "fragile", (O. Schwartz,
A. Collowald",
le redoublement de ce
syntagme assistantiel dans
l'expression absurde de
"condition populaire" avancée
plus récemment par 0 Schwartzl (Peux-t-on
parler des classes populaires,
in La vie des idées 2011),
l'invention plus ancienne et non
moins méprisante par Stéphane
Beaud, dans Le Monde) d'une "classe
paria," d'une grossière
ambivalence, sont-ils rien
d'autre qu'une tentative
politique et idéologique
de ligotage historique, en détail
des ouvriers
anachroniquement désolidarisés
du socle "populaire" (ici du
peuple social),
lui-même dissout dans les dénis
et les mépris de l'antipeuplisme
pour un peuple (social politique
sociétal) devenu politiquement
incorrect de pouvoir rappeler
dans la mondialisation qui
désubstantialise la
démocratie qu'il reste le seul
légitime souverain.
Les sociologues participent au
premier rang à cet effacement
euromondialisateur.
Serons nous qualifiés de
populistes si nous remarquons
qu'aucun n'a jamais eu de
rapport
direct
et de relation durable et
personnelle avec des vivants
contemporains de la vie
populaire et ouvrière. alors
qu'ils se proclament et sont
encensés par la discipline comme
les papes de la question.
Pour ne
plus pouvoir se couler dans les
catégories recuites de la
sociologie d'Etat des années 50,
revues par les dispositifs
différentialistes (concept d'E.
Todd, P. A . Taguieff) de la 2°
gauche des années 80, enseignée
comme un catéchisme immuable et
désamorcé, les mondes populaires
et ouvriers (qui n'auraient plus
de conscience d'appartenance
selon Schwartz parce qu'ils ont
"perdu" la classe ouvrière) sont
n fine -punisde ne pas
disparaître. corps et bien
. On leur invente pourtant
toutes les cages à
évanouissement historique
nécessaires, les exclus, les
plus d émunis, les banlieues,
les électeurs populistes (exclus
de facto de la communauté
nationale), etc.. Pour se faire
la décomposition de la deuxième
gauche a notamment engendré
l'œuvre antipeupliste,
dérisoirement diffusée à partir
du Collège de France, de Pierre
Rosanvallon, la décomposition du
marxisme stalinien a engendré
cette anti-anthropologie
d'apartheid, le regard
d'un haut sur un bas
(infra)
Les media
et sondeurs plus sobres se
contentent en général de leurs
brutales CSP+ (plus) versus CSP-
(moins) mais peuvent aussi
basculer dans le regard
misérabiliste méprisant et
discriminant adjugeant une ainsi
nommée
classe
modeste retrouvant le vieux
fantasme bourgeois du pauvre
soumis. La dite Science
politique enfin,
domestiquée depuis si longtemps,
disqualifie les mal votants ou
non votants d'un, à leurs yeux,
survivant, suffrage universel,
pour désymboliser un
peuple
décrété "analphabète" pour
refuser sa dissolution dans le
maelström euro-mondialisateur en
protestant par l'abstention ou
le vote tribunicien contre le
déni radical de leurs intérêts
et de leur conscience nationale
(Sur ce point lire l'invention
si pertinente de "la classe
culturelle" par l'Emmanuel Todd
de
L'illusion économique
Gallimard 1998, liant
historiquement avec justesse
conscience de
classe et
conscience nationale, avec Marx
et contre le marxisme. C'était
certes avant qu'il ne fasse un
pas de clerc un peu confus
en désymbolisant radicalement
certes à juste titre
La
Gauche
se survivant tout en rêvant plus
loin son existence
miraculeusement rétablie y
compris pour exonérer les bobos
des centres villes, aliénés à
toutes les modes mondialistes
dans les mœurs et le novlang, et
noyau idéologique du mépris
actif antipeupliste dans
son
Après la
démocratie,
Gallimard 2008) où il continue
cependant toujours, rare
exception, de s'exposer à
penser.
(Note 3 de 3)
Le
concept élaboré et appliqué à
des recherches exposées, de "Mondes
ouvriers",
pour nous complémentaire et non
alternatif à
classe
ouvrière
est l'objet d'une communication
de J Réault dès le Colloque
International du LERSCO, Crises
et métamorphoses ouvrières
en 1992, éditée en 1995
(infra). À
l'époque c'est dans une certaine
solitude que cette formulation
était possible et le milieu
disciplinaire n'était pas
empressé à reprendre. Le Lestamp
Université de Nantes
entérine la conceptualisation
plus générale, à la fois plus
modeste et plus
complexe, de
Milieux
Populaires,
sans effroi pour sa lisibilité en
certains sens communs, suscitant
l'agressivité des snobs du
jargon et des mandarins de
l'orthodoxie para-marxiste. On
ne sera pas mais on pourrait
être plus précis. Désormais
(2013)Mondes ouvriers
serait à tout le monde et vient
d'être curieusement
approprié par un autre auteur
sous le titre
à prétention
généralisante, De la classe
ouvrière aux mondes ouvriers
? D’une part ce concept à
moyenne portée ne nous paraît
pas à la hauteur d’une
alternative à l’immense sujet
historique que fut
« classe ouvrière »,
d’autre part
le
concept vraiment alternatif nous
paraît toujours plus (d’où le
titre de cet article) du
registre du
populaire que nous dénotons
pour simplifier « au peuple »
depuis au moins
notre article de Norois
(1995) sur la CGT
nazairienne.
L'article de
Encyclopedia
Universalis oublie de
rendre à César... et nous semble
historiquement outrepassé, alors
que l'œuvre de son auteur Julian Mishi
longtemps originale
et inventive, avant de
jouer à se fondre dans l'idéologie bourdivinesque de la
"domination"(Nantes
2013), a puisé
explicitement à plusieurs
reprises, dans les écrits de J
Réault en des temps
initiaux. Les références
respectives dans les deux œuvres
montraient une estime
réciproque. On espère une
rectification lorsque l'occasion
se
présentera sans
imaginer recourir aux hyènes de
la délation professionnelle qui
assiègent le monde universitaire
en quête de lynchage
politiquement orienté pour
"plagiats". (Voir dans ce
site
Appel à
signature çà suffit !)
|
Le retour d'un
"bas" dans la sociologie
savant
Sur ce terrible fantasme
si violent d'une
polarisation de
l'humanité entre un haut
et un bas on renvoie à
l'exergue joyeuse et
désabusée /
Ci-contre/que
Denis Duclos avait faite
à son texte le plus
radical et inventif et
depuis bizarrement
oublié, "Naissance de l'hyperbourgeoisie."

...sur une
aquarelle de Anne
Réault,
Irruption de
l'âne aux yeux rouges
"La
vie n'a d'autre sens que
l'allégresse du réel
s'opposant au néant,
nous dit le philosophe
Clément Rosset. Mais
nous autres, humains,
supportons mal la joie
spinozienne, et nous
nous empressons de
fabriquer un sens pour
tous : tel celui du haut
et du bas. L'histoire
comme fiction semble
être une lutte pour
inventer un haut d'où
l'on puisse surplomber
les autres, comme s'ils
étaient en bas; et,
s'ils n'y croient pas,
les y obliger"
Clément
Rosset,
Le Réel et
son double, Minuit,
Paris,
1976)Cité
par Denis Duclos,
Naissance de l’hyperbourgeoisie.
Le Monde diplomatique
Août 1998
|
 |
Jacky
Réault
Les
ouvrier
nazairiens ou la double
vie
in Ecomusée de
Saint-Nazaire,
Saint-Nazaire et la
construction navale
1993
|
Autres ouvrages cités

Jacky
REAULT, Mondes ouvriers et
peuples horizontaux
in
DENIOT
DUTHEIL Métamorphoses
ouvrières
L'HARMATTAN 1994
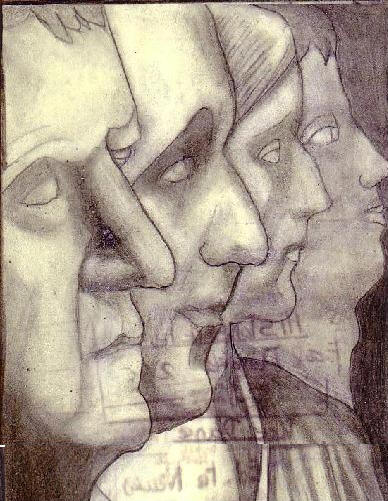 Dessin
original de Anne Réault,
copyright 2006 Dessin
original de Anne Réault,
copyright 2006
Les ouvriers de
la classe-masse
prolétarienne puis productive du
stalinisme candidate pour
l'appareil de "son" Parti à la
dite dictature du prolétariat,
au peuple
de personnes
pluriel et souverain,
au moment où la classe politico(-médiatique
et financière
euro-mondialisée détruit la
souveraineté de la France.
____________________________________________________________
Les ouvriers
de la classe au peuple
Après l'émancipation !
Avertissement d'édition
2009
Outre
l'essai
axiomatique en
forme de
manifeste qui
précède, on
trouvera deux
articles dans ce
dossier.
Nous présentons
dans ce dossier,
outre
l'explicitation
axiomatique du
prélude de Jacky
Réault, deux
textes : d'abord
(désormais
en pj PDF in
fine)
l'édition (juin
2005*)
d'un important
article posthume Ou
en est la classe
ouvrière ? de
notre ancien
collègue et
membre éminent
de temps long de
deux des trois
laboratoires
dont nous
procédons à
Nantes, Jean-Paul
Molinari,
introduit par
l'essai à la
fois réactif
continu puis
tendanciellement
généralisant
qu'il nous (Jacky
Réault) a
inspiré depuis
lors. L'édition
de l'article du
24 juin 2003 ne
nous a paru
représenter une
sorte d'hommage
véritablement vivant,
- rendu
nécessaire par
la défection
de l’institution
universitaire
pétrifiée où il
avait œuvré
trente deux ans
malgré plusieurs
engagements
publics-,
qu'accompagné
d'une réflexion
neuve, réactive
et débatteuse à
la hauteur de
son goût des
pensées fortes
et au risque,
que nous
continuons de
considérer comme
moteur de tout progrès du
savoir, du
combat d'idées*.
D'où l'intitulé
de cette
première
introduction
critique Que
faire de la "classe"
du Lersco ?,
en référence
l'ancien
laboratoire
(1971-1995) dont
il procédait et
qui s'était
précisément
emblématisé par
ce concept. Ce
texte nous
l'avons
récemment étoffé
à l'écoute des
métamorphoses
radicalisées du
monde social par
ce qui nous
semble être la
grande crise
systémique du
capitalisme
financier alias
la
mondialisation
version Guy Bois
ou la
globalisation
version Emmanuel
Todd.
C'est ainsi que
ce qui fut sur
le site de sa
première édition
en juin 2005 (Pour
un lieu commun
des sciences
sociales),
une simple et
courte
introduction au
texte de
Jean-Paul
Molinari, s'est
transformé par
l'entrainement
intellectuel
d'une
interactivité
publique en un
essai
transversal
sur le devenir devenu problématique
des ouvriers qui
ne constituent
plus une entité
sociétale
puisqu'ils ont
victorieusement
aboli, ce qui
était une
condition
discriminante, à
côté de la
société et qui
n'existent
concrètement en
cette année 2009
que dans des
collectifs
ouvriers
rebelles,
d'essence populaires dans
croyons nous
l'acception
séculaire du
terme dégagée
par Jean Nicolas
et Roger Dupuy
et élaborée
sociologiquement
par nous mêmes
dans notre
ouvrage de 1989
sur les écosystèmes
sociaux de
reproduction
populaire,
et notre article
sur les "peuples
horizontaux"
publié dans
J Deniot Crise
et métamorphose
ouvrière
(L'Harmattan
1995). Désormais,
comme tout le
monde les
ouvriers
participent
de ce bricolage
entre perdurance
et métamorphoses
au sein des sociétés
de la
mondialisation et
plus modalement
dans des milieux
populaires
hétérogènes et
localisés qui
constituent la
marqueterie
française sur le
palimpseste
des grandes
partages
anthropologiques
de la France
labourés depuis
le 18° siècle
par l'histoire
du
développement.
Quant à la
validité
heuristique du
concept de classe envisagée
de et dans la
société
d'où nous
parlons, la
France, elle ne
peut s'adjuger
qu'ici et
maintenant sous
réserve de
penser ensemble
les nouveaux
procès
structurants (ou
déstructurant)
et la fluidifié
des formes
engendrées dans
une conjoncture
historique
ouverte. On
s'arrêtera
d'abord un
instant sur
cette précision
qui dans le
contexte de la
mondialisation
des sociétés
sinon des
savoirs
hégémoniques est
tout sauf un
détail. Les
rapports sociaux
de la
mondialisation
passent d'abord
par les
situations
géopolitiques
inscrivant les
sociétés,
économies,
civilisations, selon
la trilogie
braudélienne
trop refoulée
des Annales d'avant
leur banalisante
sociologisation, dans...
les
centres, périphéries, centrages et décentrages de
l'économie-monde plutôt
que le système
monde plus
édulcoré d'une
géographie
cédant souvent à
l'évolutionnisme.
Point n'était
besoin à un
historien
s'inspirant de
Fernand Braudel,
d'attendre
l'article
célèbre qui
marque la
publication
annuelle de
données
géopolitiques et
économiques,
Ramsès, au seuil
de l'année 2008,
celle de la
grande crise
systémique*, et
que Le
Monde avait
annoncé comme le retour
des nations,
pour savoir que
l'antinationisme (P
A Taguieff, E
Todd)
politique et
théorique déjà
absurde appliqué
aux
premières
économies-mondes
d'extension
planétaires dès
les 16° et 17°
siècles,
s'avérait
gnoséologiquement
d'une rare
sottise du temps
de la
mondialisation
précisément
broyeuse de
peuple pour
autant que
ceux-ci ne lui
résistent pas.
Ce contradictoire,
processus
politique de
prédation
spécifique des
nations
implique
précisément de
penser les
résistances
relatives dans
les quelles
elles profilent
précisément la
possibilité,
cybernétiquement
nécessaire d'une
polarisation antisystémique
centrée ou
polycentrée. On
laisse aux social
scientists mondialisés
de France,
effectivement
mondialement
uniques en leur
genre dans la
dénégation de
leur
appartenance
nationale, leur
tabou de ce mot
emblème d'un
sujet historique
millénaire plus
résistant que
leur soumission
au vent du centre,
pourtant
déclinant. A
parcourir
l'actualité
sociale du
premier semestre
de l'année 2009,
la rébellion
française, selon
la belle
expression de
Jean Nicolas,
n'est pas près
de s'éteindre
quoiqu'elle
passe
aujourd'hui,
comme depuis
mille ans par
des révoltes
modestes
localisées
isolées et
pourtant
inextinguibles
et le plus
souvent
victorieuses sur
leurs objectifs
réalistes
d'obtenir le
maximum d'argent
des financiers
faillis qui en
les licenciant
tendent à
désindustrialiser
la France.
Le
présupposé
anthropologique
social et
politique d’un peuple singulier,
Nous avons
intitulé l'essai
complété et
remanié en 2009
Les ouvriers de
la classe au
peuple,
en référence à
l'approche
trinitaire que
nous proposons
ailleurs (peuple
politique,
peuple social
peuple sociétal.).
Le peuple
national est on
le verra le
présent absent
de son texte
marqué par
l'obligation
d'identité
négative
nationale que la
séparation de la
gauche, y
compris
intellectuelle,
et du peuple a
induit. C'est
pourtant dans le
fil radicalement
déterminé de la
trilogie de
Michel Verret,
l'Ouvrier français, que
JPM a produit
cet article sur
une
"classe
ouvrière" mais
dont le titre a
abandonné la
spécification
nationale alors
que c'est bien
des ouvriers en
France en 2003
dont il traite,
ouvriers
particulièrement
attachés, à
l'encontre de
leurs
ex-représentants,
à la
souveraineté
nationale de la
France ; on
reviendra sur
ces proximités
et sur cet
écart. Nommer la
France,
l'Allemagne,
etc. c'est du
point de vue des
sciences
sociales que
nous voulons
rendre de
nouveau
interférentes et
complémentaristes,
et sous un seul
mot affirmer
trois
spécifications.
D'abord celle de
la langue
commune, celle
la même où nous
écrivons, notre
principal
vecteur
d'expression et
de diffusion et
pour qui ce
signifiant relie
une multitude de
chaînes
dénotatives et
connotatives de
sens et d'émotions
également
constitutifs
d'une
connaissance
sociale qu'il
est absurde de
vouloir
absolument contre, et
non en
interaction
critique mais
respectueuse
avec, le (s)
sens commun(s).
C'est ensuite
une
spécification
générique, pour
en analyser les
structurations
internes et
externes
(position dans
la
mondialisation
et dans les
rapports de
civilisations) de
tous faits
sociaux quels
qu'en soient les
contextes, on
doit les traiter
et les situer
dans la formation
sociale où,
combinés
singulièrement,
ils font société et
cadrent l'espace
du politique,
via l'État ,entre
représentation
plus ou moins
pacifiée de forces
sociales et souveraineté. Le
genre société n'en
déplaise à A
Touraine, a
toujours une
robuste
nécessité
anthropologique,
version P.
Legendre),
historique,
sociologique
même, et plus
encore dans la
crise de dé(?)
mondialisation -
Juillet 2007-
2---- ?-. Enfin
cette
spécification
est singulière,
ce qui est un
autre horizon
des sciences
sociales refoulé
par un
sociologisme
refusant de
penser la
singularité, les
structures de
temps long les
mémoires
transmises,
l'histoire d'un
pays-dans-le-monde.
La prise en
compte des
totalités
sociales
organiques
singularisées,
virtuellement sujets d'histoire,
n'est-elle pas
entre l'héritage
anthropologique
et le meilleur
du Marx appliqué
au concret
réel (celui
du 18
Brumaire
par exemple)
l'exigence
absolue de tout
discours
de science
sociale
affrontant
l'empirie d'une population territorialisée.
Avec la France
on considère
donc une société
nationale au
proche bord de
ce qui reste le
centre de
l'économie-monde,
quoique dans une
subordination
mouvante, avec
les fortes
sédimentations
internes et
externes de son
ex empire
colonial.
Qu'elle soit
principalement
structurée, - du
point de vue des forces
sociales (Nikos
Poulantzas) tendant
à condenser
toutes les
structures dans
un rapport au
politique-, en plus
ou moins classes
sociales à
la fois
organiques et
subjectives, est
affaire de
(problématique
de) sociologie
contemporaine
appliquée aux
moments de
cycles mondiaux
et à la
conjoncture
historique.
Cette
structuration et
cette éventuelle action
déclarée,
quoique à
l'interférence
de la
conjonction des
modes de
production et
d'échange sous
l'hégémonie du
capital
financier(rapports
sociaux de
production (exploitation
?) et
d'accumulation (prolétarisation)
avec les
rapports sociaux
de
mondialisation, centre et
périphéries,
centrage et décentrage est
irréductible à
la seule
économie même
différenciée
dans les trois
niveaux
braudéliens, vie
matérielle affrontant
l'organicité de
la nature, jeux
de l'échange (marchés), temps
du monde du
capital
mondialisé.
Encore faut-il
considérer aussi
en interne, les
centrages et
périphérisation
croisant
l'antique
partition ville
-campagne revue
et complexifiée
(le rurbain)
par la
mondialisation.
On verra à ce
dernier propos
-socio-spatial
-, qu'une fois
de plus le
sociologisme
abstrait ou même
le marxisme
recuit et latent
qu'imposait à
JPM, sa commande
parisienne ont
occulté la diversité (Braudel
encore) des
sociétalités et
aires
civilisationnelles
internes à ce
pays, alors
qu'il avait
exprimé dans sa
vie de
chercheurs son
ancrage
biographique et
intellectuel au
sein de ce que
nous qualifions
de sociétés
de l'Ouest
français, et
pratiqué, jusque
dans sa thèse,
nombre de nos
travaux
personnels au
sein du Lersco
puis du Lestamp,
précisément sur
les décalages
historiques de l'accumulation
primitive
continue du
capital (Cl.
Meillassoux),
imposant de
penser les
unités ouvrières
concrètes
(ménages
familles
lignages), leurs
combinaisons en
milieux
populaires, et
l'usine dans sa
concrétude à
l'instar des
Batignolles de
J. Deniot. Sauf
dans cette épure
des rapports
sociaux d'avant
la grande
séparation
historique de
1983-4, nos
travaux avaient
bien mis en
évidence que
plus qu’en
"classe"
discrétisée et
autonomisable (et
en dehors de
moments
exceptionnels)
c'était dans les
agrégats de degrés
et formes de
prolétarisation et
au sein
d'écosystèmes
populaires de
reproduction,
dans les espaces
temps singuliers
de milieux, que
les ouvriers
développaient
leur vie sociale
privée et même
collective. La
recherche d'une
intelligibilité
singulière (anthropo-historique)
d'emboitements
d'unités
pertinentes
réellement
(spatialement)
quoique
relativement,
découpées dans
le continuum
social voire
mondial et dans
le mouvement du temps
du monde, est
tout pour le
moins désormais
plus requise que
celle de
généralités
latentes
(sociologiques
?) appliquée à
des structures
de
classifications
fixes que
requiert seule
la paresse
sociologique
instituée en
scholastique.
C'est en quelque
sorte une
science
compréhensive et
objective
d'universalité
concrète,
toujours
subordonnée à
l'espace temps
de conjonctures
au sein d'une
histoire, que
nous
revendiquons
dans ce site, lieu
commun des
sciences
sociales.
Qui a dit que
parmi celles-ci
les sociologues
étaient les plus
ignorants de
leur propre
société ? Et par
définition
puisque la
singularité
subjectivable
est leur tabou !
Ce n'est pas
irrémédiable à
condition qu'ils
sortent de
constructions
artificielles
abstraites
closes ou pire
dans
l'homogénéité
mortifère du champ. Comment
donc parler des
ouvriers en
France, lieu
commun référent
bien vivant de
notre échange
intellectuel
avec JPM, comme
avec tout
lecteur, et non
"objet"
constructible de
sociologie disciplinée,
sans profiler
par quelques
grands traits de
quoi donc dans
quoi, sans
oublierd'où, on
parle. Avec la
France il s'agit
encore en effet
en juin 2003
comme en janvier
2009 à l'entrée
dans la crise
des crises, de
la sixième ou
septième
puissance
économique du
monde ( La Chine
vient seulement
de passer
devant) support
de groupes
industriels
d'échelle
mondiale qui
localisent
encore, dans le
territoire
français un
tiers de son
salariat ; plus
surement encore
c'est le seul
État européen et
même européen,
où le vouloir
vivre illustré
démographiquement
et à forte
composante
ouvrière- est
porté et exprimé
à la fois par un
taux de
fécondité viable
. L'histoire de
ce pays - pour
faire vite en
concrétisant
l'essentiel : Ancien
Régime,
Révolution,
Mouvement
ouvrier,
civilisation
républicaine,
revival
résistant et
gaullien,
soumission
euro-mondialiste
des "partis de
gouvernement"-,
que ses élites
de scène tendent
à confiner dans
l'identité
négative,
reste
contradictoirement
référentielle
pour l'immense
majorité de son
peuple, ouvriers
compris et qui
le font savoir
politiquement,
et référentiel,
pas seulement
par la
francophonie,
pour des
multitudes
parfois
antipodiques
entre l'Europe
de l'est et
l'Amérique
latine. Ce pays
et ce peuple
furent
considérés comme
le plus politisés
(selon Marx
qui conjuguait
dans ce
jugement, révolution (donc
souveraineté du
peuple) et mouvement
ouvrier),
jusqu'à ce que
son
intelligentsia,
ex marxiste et
désormais
solidaire des
media
mondialisés,
ridiculise,
selon elle, ce
propos. Cela se
passait
d'ailleurs, - et
ce n'est
certainement
pour ce dont il
est question
ici, ni un
hasard ni un
détail -, dans
le temps où elle
inversait (1984, Vive
la crise )
son regard sur
les mondes
ouvriers passant
pour elle, du
statut
sociétalement
unifié de classe mythique
de la révolution
fétichisée, à
une inexistence
d'agrégats
nostalgiques
amers pensant et
votant mal et
trahissant, s'il
fallait résumer
leur naïf
propos, le
primat de
leurs constructions
"objectives" à
vrai dire plus scholastiques
que sociologiques
sur leur réalité
historique
incarnée de
personnes
vivante, de
familles bien
liées, de
territoires
vécus. La classe
ouvrière,
cette forme
historique
disparue, n'est
un non-être
contemporain que
pour les
idéologues
(souvent des
sociologues),
pas pour les
ouvriers
contemporains
dont l'être
social et les
possibilités de
faire force
sociales s'est
redistribue
ailleurs dans
des les
ensembles
populaires d'une
société
(singulière) de
la
mondialisation.
Bref le fil du
propos et des
interactions
critiques avec
le texte de JPM,
imposa
corollairement
de se situer
aussi sur les
grands concepts
unifiant dont
les ouvriers
avaient été,
selon la
conception
théorique que
l'on se donne,
les
auteurs, les supports ou
l'illustration : classe
ouvrière et
en deçà,
problématique de classes
sociales et
description,
ici et maintenant de classes supposées existantes.
Une telle
réflexion en
chaîne se
confrontait
nécessairement,
outre au texte
si surdéterminé
de JPM, avec qui
l'échange est
ici principal, à
ses références
bibliographiques
devenues dans
leur exposition,
œcuméniques et
consensuelles,
(signe évident
chez lui de
lassitude
biographique
et/ou
d'impératifs
politiques), à
l'égard des
sociologies
majoritairement
dépréciatives et
ethnocentrées (classes
parlantes grand-urbaines)
qui se sont
avancées dans la discipline,
comme
spécialistes
contemporaines
des ouvriers,
après le
tournant
historique de
1983-1984, à
l'exception de
l'ultime œuvre Le
décor ouvrier de
Joëlle Deniot,
la seule
contribution
authentique à la
connaissance de
la privatisation
ouvrière comme
conquête
civilisationnelle.
Ces sociologies
à prétention off,
apparent progrès
sur l'illusion
de la
co-immanence
dans les
sociologies
précédentes "engagées", rompaient
en fait surtout
le pacte
solidaire qui
liait
modalement, du
temps de
l'ethnologie
même d’avant la
décolonisation, l'intrus "observateur"
et ce qui était
toujours d'une
certaine façon
métonymique ou
réelle, le
"peuple"
observé. Un des
intérêts de
l'article de JPM
est de se situer
comme dans un
lieu géométrique
exposé entre
d’anciens et de
nouveaux regards
dans un certain
écartèlement
donc, sinon,
comme nous l’a
involontairement
suggéré un de
ces regards le
plus violent,
d'une situation undercontrol.
Si pour aller
plus loin on
considère en
épistémologue
qu'il existe un
référent réel
plus ou moins
également inversé
et occulté par
l'idéologie de
chacun de ces
regards
sociologiques,
et pourtant
éventuellement
éprouvé dans
l'expérience,
notamment dans
la sienne,
la position de
l'auteur
étudié
ressortit, quant
à l'analyse, de
la
triangulation
douloureuse du tripalium, cet
engin de torture
entre trois
pieux à
l'origine du mot
travail. JPM ne
doit-il pas
écrire sous le
contrôle des
trois puissances
instituées de la
sociologie
ouvrière vue par
des bourgeois
radicalement
antipopulaires (
Michel Verret,
Stéphane Beaud,
Olivier
Schwartz) sous
l'égide du plus
stalinien
d'entre eux
définitivement
immobilisé dans
ce que l'on peut
qualifier
d'exacerbation
de son contre-transfert.
On va donc
considérer dans
tous les sens du
terme ce travail,
tourment(s), et
dépense de force
humaine dans la
transformation
productive de
conditions
déjà données.
En réalité comme
toujours en
sociologie, il
s'agit d'un
bricolage dans
une certaine
langue -plus ou
moins de
bois plus
ou moins de
vie-, d’un
patchwork cousu
main -de
"faits" en
l'occurrence la
combinaison de
noms (ouvriers
PCS,) et de
nombres
chiffrés, qui
plus est
modalement liés
par l'État ou
des appareils
politiques, - et
de textes déjà
existants eux
mêmes tissus
cousus mains
etc. Mais ce
propos de rappel
à une modestie
relativement
relativiste ne
va-t-il être
exécuté par les
locuteurs
labellisés de la novlang disciplinaire,
faciles à
confondre
parfois avec le
comique
troupier,
d'écrits
sociologiques d'avant
la
professionnalisation
? (J
R janvier 2009)
__________________
* L'article
de J P Molinari
publié sur ce
site dès juin
2005, a en
septembre 2005
été également
intégré à un
livre de
Emmanuelle
Dutertre,
Jean-Bernard
Ouedrago,
François-Xavier
Trivière, Exercices
sociologiques
autour de Roger
Cornu.
L'Harmattan
septembre 2005.
Roger Cornu
fut une dizaine
d'années membre
du Lersco. Il
figure dans ce
livre sans autre
commentaire.
Sous réserve
d'inventaire
exhaustif c'est
le même que
celui que nous
avions déjà
édité. Roger
Cornu a
également été un
critique
radical, quoique
sur d'autres
bases théoriques
et politiques
que nous,
de la
"sociologie de
la classe ouvrière"
bureaucratique
et un polémiste
caustique contre
son initiateur.
** Ramsès
2008 ifri,
Thierry de
Montbrial,
Philippe Moreau
Defarges.
***Le
Lestamp avait en
son temps honoré
le départ
en retraite de
Jean-Paul
Molinari
par la
publication d'un
recueil de
mélanges,
Libre prétexte. Nantes
Lestamp décembre
2001, disponible
aux adresses
mails de ce
site.
joelle.deniot@wanadoo.fr
_______________________________
En suite et
développement de
Que faire de la
classe
ouvrière du
Lersco ?
(Liminaire
(Mai 2005) à
l’édition
posthume de J P
Molinari,
Où en est la
classe
ouvrière.
Nantes Lestamp
Juin 2003…)
Voir la PJ
PDF in fine.
Les
ouvriers
de la
classe
au
peuple
Après
l'émancipation,
Jacky
Réault
- Octobre 2008
Mars 2009
Des
mots pour le
dire
Non dans l'éther
d'une théorie
abstraite
mais des mots
datés
.
De la
classe
ouvrière
aux
ouvriers
en milieux
populaires
mondes
ouvriers
de 1992*) :
genèses des
idées, histoires
de chercheurs et
de laboratoires
dans histoire de
la France et du
monde
*Anachroniquement
repris dans l'Enclycopedia
Universalis des
années 2010, par
J Mishi, qui
plus est
sans référence à
nos travaux
connus de lui et
utilisés..
"Où
en est la
classe
ouvrière ?", Un
fort texte,
livré
ci-dessous, in
extenso, après
cet essai, fut
donné par
Jean-Paul
Molinari, en
deux moments, au
Lestamp par la
dédicace
nominale de
tapuscrits à
plusieurs de ses
membres. C'est
sa dernière
version qui est
ici présentée et
qu'il avait
remise
personnellement
aux participants
du dernier
séminaire du
Lestamp auquel
il participa le
28 juin 2003,
chez l'ancien
dirigeant de la
CGT, Georges
Prampart à
Racapé au sud de
Nantes, trois
mois avant sa
disparition.
Nous publierons
les documents
photographiques
qui ont illustré
cette journée.
Ultime œuvre
majeure
ce copieux
article ou
plutôt ce
véritable essai,
où l'apparent
empirisme d'une
sociographie se
coule dans une
sociologie très
théorique,
s’inscrit
radicalement
dans une
filiation
manifeste et
remarquablement
insistante de la
part d'un
universitaire
plus que
chevronné, et
même
institutionnellement
retraité, à
l'égard de
Michel Verret
qui fut
l'inventeur et
longtemps le
propagandiste,
d'une
Sociologie de la
Classe
Ouvrière
dont le Lersco
(1971-1994), son
Laboratoire
d'Etudes et de
Recherches
Sociologiques,
aurait dû à ses
yeux être d'une
certaine façon
pendant plus de
vingt ans comme
la grande
fabrique. Il le
fut largement,
mais son
développement
effectif
s'avéra
cependant plus
sectorisée et
l'axe ouvrier
lui même dut
s''intégrer, dès
les années 80,
et à notre
initiative, dans
un sous-ensemble
intitulé milieux
populaires
localisés, où
l'histoire, la
géographie,
l'ethnologie
côtoyaient les
approches
sociologiques,
selon une charte
qui mettait déjà
en œuvre sans
l'exprimer
explicitement,
la pensée
manifeste que le
nouveau Lestamp
alternatif
diffusa très
radicalement dès
notre
introduction-manifeste
lors du Colloque
Les sociétés de
la
mondialisation
:." Pour un lieu
commun des
sciences
sociales"(3
décembre 2004
Nantes). C'est
du Lersco en
mutation
accompagnant l'à
jamais relative
mondialisation
du monde,
que procéda
d'abord le
premier Lestamp-
ea Université de
Nantes, en 1995
intégrant le mot
commun et
scientifiquement
transversal de
milieu(x).Il
avait déjà
avancé, on l'a
dit, par nous au
sein du Lersco,
et précisément
dans le fil
d'une certaine
usure théorique
et de la
scission
intellectuelle
relative déjà
pré dessinée
donc, de son axe
principal -
entre post-classe-ouvriéristes
et tenants d'un
élargissement
aux milieux
populaires
concrets dans
leur
hétérogénéité
sociale, leurs
cultures
territorialisées
en
écosystèmes
de reproduction
populaire (JR
1989) et donc
leurs
espaces-temps.
Dire d'entrée
ici pour la
clarté des
choses que J. P.
Molinari,
quoique ayant
intégré dans sa
thèse L'adhésion
ouvrière au
communisme, des
spatialisations
régionales
partiellement
traitées dans
l'esprit de ces
milieux
historiques que
nous avions
introduit dès
1977 (La
prolétarisation
inachevée, les
salariés de
l'aire d'emploi
de
Saint-Nazaire,
Lersco-CNRS),
était le
défenseur
verbalement
radical du
primat théorique
d'un concept et
d'un existant "classe
ouvrière" et que
nous (jr) étions
porteurs, par
formation,
historien et
géographe, et
par réflexion de
temps long,
de cette science
sociale
transdisciplinaire
dont les
totalités
concrètes
expérimentées
dans des espaces
réels
résistants,
modéraient
l'idéologisation
possible puisque
qu'irréductibles
à tout sens de
l'histoire,
nouveau fatum
toujours mort et
toujours exhumé
par une
oligarchie
d'intellectuels
adossée à des
néo-partis et
des post-Etats.
Cette
complexification
entre classes et
milieux
n'impliqua pas
d'entrée
d'entériner si
tôt et si
radicalement que
lui, « la
péremption du
concept de
classe
ouvrière »
avancée en ces
termes dès les
années 80 par
d'Alain Bertho
étudiant la
transformation
de la banlieue
rouge en
banlieue. Si a
posteriori et de
par l'analyse
historique nous
datons désormais
le basculement
aux années
1983-1984 c'est
subjectivement
(pour nous comme
personne et pour
la majorité de
la société)
l'effondrement
moral de la
Gauche déclenché
dès 1983-4, mais
immédiatement
neutralisé par
le lancement
mitterrandien du
Front National,
qui submergea
finalement tout
en 1993, et
comme un coup de
pied au fond de
la piscine
mouvement social
d'un type
nouveau, à la
fois populaire
et national
selon l'analyse
devenue
classique
d'Emmanuel Todd,
de l'automne
1995 qui profila
déjà la nouvelle
grille d'analyse
politique et
sociétale du
monde des
sociétés
centrales
quoique
subordonnées à
la
mondialisation
américaine par
l'appareil d'Etat
dit Europe.
C’est dans cette
période que
s'élabore un
corpus
conceptuel
d’ajustement
problématique
très libres
auxquels
participèrent
activement, en
dehors de J
Réault, Claude
Leneveu et
Joëlle Deniot et
qu'eut lieu la
gestation
théorique.
D'abord
fragmentairement
et sans unité
dans le Lestamp
EA de
l’Université de
Nantes, encore
plombé par
l'immobilisme
des regards
anciens
(marxisme et
féminisme d'Etat),
puis très
librement et
systématiquement
à partir de 2004
dans le libre
Lestamp-Association,
société savante
alternative,
notamment
éditrice du site
Pour un Lieu
commun des
sciences
sociales.
1983-1984,
1992, la
scansion
politique et
intellectuelle,
1993, la
scansion globale
: l’autre
année terrible
L'orwellienne
année 1984,
suite en France
et achèvement de
la grande
rupture des
partis désormais
ex ouvriers
Parti communiste
Parti
socialiste,
abandonnant par
leur
asservissement
au mark allemand
malthusien, la
souveraineté de
l'Etat national
français sujet
historique
présupposé
(Marx, Todd) de
la
classe ouvrière
historique en
France dans
l'entité
institutionnelle
conquise de la
société
salariale,
constitue la
première césure.
Tendanciellement
il n'y a plus de
sujet historique
face à la
mondialisation
inaugurée par la
réaction
thatchérienne et
reaganienne à la
fin de cycle de
1974. La même
année Joëlle
Deniot publie ce
qui restera la
seule
monographie
d'usine
ethno-sociologique,
où la fin de
cycle du
volontarisme
communiste a
fait perdurer
jusqu'au
désespoir une
culture ouvrière
prolétarienne
cependant
accrochée aux
métiers,
La coopération
ouvrière à
l'usine des
Batignolles et
Jacky Réault
Ouvriers de
l'ouest où la
mise en espace
des formes de
vie et de
mobilisation
ouvrières révèle
l'irréductible
polarisation
entre les
ouvriers de
première
révolution
industrielle, essentiellement
de l'est de (la
fameuse et
pertinente ligne
de l'histoire du
développement), Saint-Malo-Genève
et dans quelques
îles urbaines à
l'ouest,
prolétariens
étatistes
baignant dans
leur culture
singulière
dépecée par la
désindustrialisation
prédatrice et
les
prolétaires
inachevés
engendrés par
les Trente
Glorieuses sur
les sociétés de
la
dépaysannisation
tardive. Ce
partage plus
large que les
univers
strictement
usiniers
constitue de par
la reproduction
élargie de ses
effets dans les
conjonctures
successives de
la
mondialisation
et de la
désouverainisation,
constitue la
différenciation
principale des
milieux
populaires
spatialisés ou
s'inscrivent les
formes de vie
des peuples
travailleurs
dans la
substitution
d'un Etat social
à celui de
société
salariale. En
2007 ( J Réault
2007, 2010) il
dessine la
principale ligne
de partage
politique de
l'élection de
toutes les
réminiscences.
La fin de
l'Union
soviétique
(1989-1991) mais
surtout sa désymbolisation
anticipée dès
les années 70
par l'invention
d'emblée
mondialisée de
société du
Goulag, poursuit
son cours
parallèlement.
Il a sa logique
propre, son
interférence
contribue au
défaitisme des
derniers carrés
communistes
historiques des
ouvriers
prolétariens
politisés, mais
il n'est pas
central sauf à
penser, ce qui
n'est pas
totalement dénué
d'heuristique
que c'est
l'obsolescence
réelle du mythe
communiste et
soviétique qui a
permis la
transformation
du procès
capitaliste de
mondialisation
en politiques
subjectivées et
la réémergence
d'un lieu
central de la
mise au pas des
sociétés et des
travailleurs.
Le
thème délirant d'un
retour des
classes
en serait
totalement
ridiculisée si
les sociologues
qui l'évoquent
avaient gardé la
moindre
sensibilité
historique.
S'il faut, après
l'obsolescence
des sociétés
nationales de
classes,
désigner un
concept
englobant pour
donner l'optimum
d'intelligibilité
relative aux
nébuleuses
sociales (Réault
1984) qui
dans une
conjoncture
donnée peuvent
certes devenir
ponctuellement
forces sociales
(Poulantzas) au
sein d'ensembles
spatialisés
lâches
d'attributs
populaires
larges,
interférences
des trois
acceptions du
peuple, plus
communs
que clivés, on
ne peut
qu'avancer qu'il
s'agit de
positions
de
prolétarisation
dans les
processus
d'accumulation
du capital des
sociétés de la
mondialisation.
(J Réault 2004)
de plus en plus
surdéterminées
par des
défensives
identitaristes,
"culturelles"
(?) sous couvert
de mémoires
historiques re
construites, ,
ethnicisées par
le regard devenu
hégémonique du
primitivisme
allemand étayé
sur une
rechute du
différentialisme
américain,(E
Todd 1995).
La forme de vie
en est plus que
la position dans
les rapports de
production
l'unité réelle,
cette aporie
réelle de l'individuus
divisible.
Elle est dans
des rapports
variés aux
lignages aux
voisinages et à
l'Etat, la base
principale non
seulement
d'attributs
passifs comme
l'étaient ceux
de la propriété
dans la
problématique de
classes, et
d'abord ceux des
possessions et
des liens
d'entretien
mutuel, mais des
mobilisations
privatives
interférant dans
la primatie de
leurs
perspectives,
avec les
mobilisations
collectives
qui perdurent
erratiquement
sans
sujet
central, et les
mobilisations
nationales
sauvagement
désymbolisées
par l'invention
oligarchique du
populisme.
Avec ces
dernières, dont
la
contre-offensive
serait la seule
possibilité
d'une résurgence
des cultures de
classe, - Que
réserve la crise
planétaire du
capitalisme
mondialisateur
qui a fait
irruption à
partir du centre
américain en
2007 ?
La scansion
intermédiaire la
plus
spectaculaire de
cette mutation,
dans la réalité
sociétale et
politique avant
de l'être dans
note conscience
sociologique
exprimant dans
l'immédiateté
contemporaine
l'obsolescence
morale achevée
de la
classe
ouvrière
avait été
l'année terrible
de 1993,
économiquement
la pire du 20°
siècle, la
manifestation la
plus radicale du
style social de
la
mondialisation
dans les
sociétés
centrales au
moins jusqu'en
2009 à partir de
la quelle
tous les records
de l'histoire
universelle
seront
d'évidence
battus.
Profitant de la
dépression
consécutive à la
première Guerre
du golfe,
hystérisée en
Europe
par le
déflationisme
vieux rentier
d'une Allemagne
oliganthropique,
scellé dans le
Traité de
Maastricht, les
dirigeants des
groupes
financiers
mondialisés
demandent à
leurs cadres
encore nationaux
de s'éprouver
dans - en
globish dans le
texte comme il
faut désormais
dire, '- le
downsizing
(exercice de
réduction
drastique des
effectifs, droit
d'entrée des
cadres
dirigeants dans
l'oligarchie des
managers
d'échelle
mondialisée
selon Denis
Duclos) et -le
reengeenering
(exercice de
dislocation de
la division du
travail devenant
"organisation",
pour briser les
coopérations
salariales et
surtout
ouvrières
(Joëlle Deniot
1983, Anthropos)
et les
groupements
traditionnels
des
travailleurs).
Les collectifs
usiniers réduits
et démoralisés
par dix ans de
fermetures
d'usines et
d'écrémage par
les préretraites
socialistes de
leurs militants
chevronnés,
désormais sans
représentation
politique fiable
(- le PCF ne
s'adresse plus à
la
classe
ouvrière,
ni même aux
ouvriers
mais "aux gens",
le PS a tout
livré à l'Europe
multiplicatrice
de
mondialisation)-,
furent
traités souvent
sauvagement par
des
licenciements
aussi massifs
que cyniquement
ignorés par un
pouvoir
socialiste
partagé entre un
irréversible
effondrement
intellectuel et
moral de
parti de
gouvernement
euromondialisé
et l'abandon de
la souveraineté
monétaire et
économique par
l'intégration
européenne du
mark
déflationniste
et de la
croissance
interdite,
principales
clauses du
Traité de
Maastricht.
Cette fois ci la
crise se résolut
par l'innovation
historique
radicale (à ce
degré là) d'une
révolte
politique
exprimée dans de
massifs votes à
droite et à la
dite extrême
droite du Front
National, suivi
du symbolique
suicide le 1°
mai de Pierre
Bérégovoy, et
non dans une
ultime flambée
de
définitivement
feus les partis
ouvriers.
Dès 1992, le
vote Non
au referendum de
Maastricht,
essentiellement
ouvrier paysan
et sudiste (sur
l'aire
électorale
séculaire,
désormais
partagée avec le
Front National
le CPNT, de la
gauche
historique
abolie, sur la
petite propriété
paysanne libre
et liée à la
dynamique des
villes depuis
l'empire
romain), qui
avait failli
l'emporter à
quelques
milliers de voix
près, avait
marqué les
nouvelles
frontières de la
résistance à la
contradiction
principale des
nouveaux
rapports sociaux
mondialisés.
Toute analyse
politique et
sociétale qui
n'intégrait pas
ce nouveau front
s'avérerait
définitivement
un leurre. Des
leurres, il en
vint beaucoup,
de l'imbécile
"fin" du
travail, par
celle du
salariat, en
passant par
l'économie
immatérielle et
le village
mondial des
fantasmatiques
et réelles
à la fois TIC.
Certes une
révolution
schumpétérienne
dans la
technologie et
dans le contrôle
social des
multitudes, mais
rien qui dessine
l'ombre d'un
dépassement par
des rapports
sociaux
"supérieurs".
1992, du point
de vue de
l'histoire des
collectifs de
chercheurs
engagés sur les
grandes
mutations des
mondes
ouvriers
et populaires, c
'est
l'année même du
dernier
grand colloque
international du
Lersco que nous
avions conçu et
co-organisé J
Réault, JP
Molinari Joëlle
Deniot, Roger
Cornu.
L'intitulé,
Crises et
métamorphoses
ouvrières
(Université de
Nantes-Lersco,
édité à
l'Harmattan à
l'initiative de
J Deniot
assistée par C
Dutheil). en
avait été plutôt
lucide quoique
ayant reculé
devant le
constat plus
radicalisé de la
fin d'une
identité
collective et
d'un mythe,
les deux faces
de tout grand
sujet de
l'histoire, un
concept
historiciste
peut-être, aux
yeux d'une
critique
marxiste mais
devenu dans la
chosification
générale du
monde par la
mondialisation,
la
mercantilisation
et... le
sociologisme, un
concept réactif
d'une grande
urgence
anthropologique
autant
qu'intellectuelle.
Une autre fin
suivit de peu,
celle du Lersco
lui-même. Certes
son concept
était mort, et
probablement
mort-né mais ses
dizaines de
membres
constituaient
encore une force
inventive
vigoureuse. Ce
ne fut pas mort
naturelle mais
mobilisation
active ou
passive de ses
anciens
directeurs
désormais alliés
entre eux et
avec ce qui se
manifestait
désormais, à
l'Université et
au CNRS dans
tous les
domaines
(pouvoir argent
postes,
recherchés
exclusivement)
comme le clan
bourdivin. Cette
alliance se
manifesta
à Nantes à
l'égard du
Lersco et
s'obstina contre
ses héritiers
fondant le
Lestamp EA de
l'Université de
Nantes jusqu'en
2004, comme un
vulgaire et
brutal dépeçage
accompagné de
multiples
spoliations et
se couronna dans
le bouquet final
d'un blâme
universitaire à
sa directrice
qui avait osé
rompre la loi du
silence
habituelle sur
ce genre
d'agissements.
Michel Verret
voulait garder
un monopole
personnel du
propos sur les
ouvriers
dans les
sciences
sociales et lui
qui n'avait de
sa vie mené la
moindre enquête
personnellement
fit tout pour
que la nouvelle
directrice
auteur de la
seule grande
enquête usinière
devenue thèse,
et d'une thèse
d'Etat également
ouvrière, perde
tout pouvoir et
moyens sur
l'héritage
sociologique
nantais qui
amorça une longe
décadence et une
inextinguible
guerre civile.
Exit le
Laboratoire
d'Etudes et de
Recherches
Sociologiques
sur la
Classe
Ouvrière.
De la fin du
Lersco était
malgré tout
surgi
ce Lestamp
(1995-2004)
autour de cette
nouvelle
directrice,
Joëlle Deniot,
dont l'œuvre
fournissait le
lien manifeste
entre les
cultures de
recherche qui
s'étaient
succédées sans
d'ailleurs
s'abolir, de
l'usine à la
chanson
française en
passant par le
décor ouvrier ;
sa modalité
propre de lieu
commun des
sciences
sociales
agrégeait à la
sociologie,
l'anthropologie,
la philosophie,
l'histoire et
l'expérience de
l'art. Sans
expliciter
d'entrée quelque
rupture radicale
(d'ailleurs
contradictoire
avec la
complexité
historique et
inégale des
métamorphoses
sociales et
notamment
ouvrières),
cette fondation
intégrait, sur
fond désormais
explicitement
perçu de
mondialisation
(J Deniot, JC
Leneveu J
Réault), le
programme
possible d'une
ré interrogation
historique et
anthropologique
du concept de
classe
et d'abord de ce
collectif
sociétal et
politique
inséparablement
réel et
mythique,
indigène et
accaparé par des
appareils de
pouvoir et/ou de
savoir, encore
dit dans les
Universités
sinon dans la
société,
classe ouvrière.
Sa centralité
très
obsessionnelle
chez le
fondateur du
Lersco, était
certes
définitivement
abolie pour la
majorité des
membres du
nouveau
laboratoire
(mais certes non
pour JP Molinari,
fidèle
expression de M
Verret), comme
pour la majorité
des
observateurs
mais elle
continua de se
reproduire dans
la société par
le simple effet
de volant de la
répétition
scolaire figé en
scholastique par
l'institutionnalisation
d'un agrégat de
commodité dit
Sciences
Economiques et
Sociales,
originairement
confiné dans
l'enseignement
secondaire mais
qui par une de
ces inversions
historiques dont
la période est
féconde en vint
à devenir une
force sociale
pesant sur la
recherche
universitaire
elle-même. Pour
le Lestamp, il
s'agissait
désormais
d'explorer dans
un cadre
théorique ouvert
d'une sociologie
pensée comme
ensemble des
connaissances
que l'on puisse
complémentairement
collecter sur
les sociétés
dans leurs
espace-temps (et
non comme la
discipline
homogène avide
de systèmes
théoriques
achevés et se
réfugiant dans
le vide
méthodologiste
radicalisant sa
clôture
exclusive), des
univers
redéfinis en
concepts plus
souples et plus
pérennes à la
fois, fortement
dénotés en
extension comme
en compréhension
dans le sigle
identifiant des
Transformations
et
Acculturations
des Milieux
Populaires (J
Réault),
même si
l'institutionnalisation
autoritaire des
carrières
obligeant, le
nouveau
laboratoire
était toujours
affiché
Sociologique.
L'éternisation
de formes telle
qu'une classe
ouvrière, sous
prétexte de
maintien bien
réel de rapports
de production
capitalistes,
laissait la
place à une
dynamique des
métamorphoses
centrée sur les
acculturations
tandis que le
concept de
milieu, marginal
dans le Lersco
devenait le
marqueur d'une
ambition à
moyenne portée,
- quoique
essentiel
garde-fou contre
une nouvelle
idéologisation,
sans qu'ait pu
être réglée
radicalement ni
la question de
la perdurance de
classes, ni
l'explicitation
et donc la
réélaboration
théorique si
nécessaire du
populaire
dont la
polysémie,
prétexte à son
abolition,
impliquait un
travail
théorique neuf
adapté à ce
moment de
radicalisation
du rapport de la
mondialisation
avec les
sociétés, les
peuples, les
cultures, et
jusqu'à la
conception de la
personne. Malgré
la pertinence de
son travail de
re
problématisation,
la valeur et
l'expérience
d'un noyau de
chercheurs de
maturité autour
de J Deniot, le
Lestamp resta un
agrégat
relativement
indéfini,
tiraillé entre
les ambitions
parisiennes d'un
normalien qui
s'empressa de
déserte, la
clôture
problématique
d'un groupe
féministe, et le
double jeu du
relai de
l'ancien
directeur du
LERSCO qui avait
dès 1999 décidé
sa disparition
et qui en 2003
frappa le grand
coup de la mise
au mur de la
directrice du
Lestamp, puisque
la qualité du
travail fait
dans le premier
quadriennat
avait induit
malgré lui une
évaluation
favorable au
renouvellement.
Olivier Schwartz
réintégra les
cercles
parisiens du
pouvoir
disciplinaire en
ayant
abusivement
monopolisé la
notion devenue
sous son regard
paternaliste,
d'ailleurs très
indirect, de vie
privée ouvrière
qu'avait
pourtant révélée
à la fois
savamment et de
l 'intérieur, et
sans aucune
idéologisation
l'ethnographie
de Joëlle Deniot
que Michel
Verret
contraignit à
publier
sous le vocable,
réducteur de
Décor. Cependant
si Olivier
Schwartz resta
l'homme d'une
seule œuvre (Le
monde privé des
ouvriers),
entre
ethnographie
indirecte et
condescendance
directe de plus
en plus
misérabiliste en
convergence avec
M Verret et S
Beaud, Joëlle
Deniot entamait
une troisième
œuvre sur la
chanson
populaire, via
la chanson
réaliste dont
l'emblème lui
fut substitué et
maints contenus
pillés par une
comparse qui
prit à Grenoble
grâce à ce haut
fait, le nom et
les fonctions
universitaires
d'Alain Pessin,
le théoricien
éternisé d'un
opportun "mythe
du peuple". J
Deniot sut une
nouvelle fois
conjurer ce
complot et
élaborant dans
le Lestamp
alternatif, et à
partir d'une
ethnographie
compréhensive et
transdisciplinaire
du populaire,
une nouvelle
anthropologie de
l'art sans et
même contre la
besogneuse et
stérile
sociologie de
l'art, trop
souvent modalité
universitaire de
la mort (au sens
d'assassinat) de
l'art même.
La conscience de
cette ligne
claire et de ce
programme ne put
vraiment
s'exprimer que
huit ans plus
tard dans la
fondation dès
juillet 2004,
d'un laboratoire
alternatif, le
Lestamp
association,
après la
liquidation plus
violente encore
de l'EA
Université de
Nantes et la
fuite éperdue et
bienvenue de qui
n'imaginait pas
de penser
exister agir
sans tutelle
institutionnelle,
politique ou
sectaire. Sans
argent sans
pouvoir
institutionnel,
dans des
situations
d'interdit
professionnel à
diriger des
thèses dans le
fil de l'ultime
décret Lang sur
les Masters
radicalisé par
un usage très
Ouest profond de
la
décentralisation,
le Lestamp
association
épuré de ses
poids morts et
libéré de toute
dépendance
devint avec
l'alliance
intellectuelle
de Jacky Réault
et de Joëlle
Deniot, que
rejoignirent
Pierre Cam, et
de plus loin
Bruno Lefebvre,
le champ libre
et fécond d'une
nouvelle donne
théorique (et le
support de deux
mastères quoique
institutionnellement
et par complot
tout fut fait
pour saboter).
Cette culture de
laboratoire
était à fois
héritière de la
partie restée
vive de
l'histoire
antérieure
depuis l'origine
(les totalités
concrètes
d'espaces-temps
populaires,
replacées dans
l'emboitement
mondial - y
compris
national- des
contextes, et de
la féconde
activité de J
Deniot,
convergeant dans
le refus
corollaire des
découpages
spécialisés de
la sociologie
disciplinaire),
Une
anthropologie
historique
plurielle des
milieux
populaires)
fut totalement
ré élaborée à
l'expérience de
la Nouvelle
époque. La
mondialisation
envisagée comme
broyeuse de
sociétés et de
classes et comme
machine folle dé
dédifférenciation
des cultures
nations et
civilisations
voire des sexes
et des âges et
qu'il faut bien
enfin nommer
désormais (nous
l'avions déjà
mise avec la
conclusion de J
Réault, Ouvriers
de l'Ouest, au
centre de nos
analyses des
transformations
ouvrières dès
1983) ne se
trouve jusqu'à
l'acmé
épouvantable
du 11 septembre
2001 que des
adversaire
radicalement
inaptes à
devenir une
force
antisystémique
alternative
malgré la base
populaire dans
la première
périphérie de
l'islamisme
radical (Burgat)
et la résistance
active mais
occultée (par le
vote frontiste
et
l'abstention),
des peuples
centraux.
Certes, des
composantes
possibles d'un
nouveau
mouvement social
et politique
assez
consciemment
orienté autour
de cette
contradiction
principale (la
mondialisation
et non le seul
rapport
salarial), avait
surgi, en France
même, mais en
ordre dispersé
et sans
convergence
possible, de la
révolte rurale
emblématisée dès
1984 par le
mouvement
chasseur (étudié
sous cet angle
dans la
communication de
J Réault en 2002
au Lestamp), de
la quasi
victoire, en
France dès 1992,
du Non à
l'Europe passeur
de la
mondialisation,
de la révolte du
peuple encore
stabilisé de
l'automne 1995,
mais il fallut
attendre les
années 2000 pour
qu'un lien entre
des expressions
politiques
pertinentes
(2002, 2005) et
différentes
modalités
d'expression du
populaire et
d'un peuple,
devint manifeste
sans cependant
pouvoir
stabiliser
politiquement
des victoires
telles le Non au
dépeçage des
nations
européennes en
avril 2005.
C'est dans ce
contexte, ainsi
rapidement
brossé, que les
travaux des
chercheurs du
Lestamp-Association
durent situer
leurs travaux en
investissant
leur expérience
des
mobilisations
populaires plus
sur la culture
les formes de
vie et les
défensives de
l'emploi
salarié, que sur
un sujet
collectif éclaté
après
l'évanouissement
historique, et
nous le disons
désormais
clairement,
finalement
heureux,
de la classe
ouvrière. Privés
d'appareils de
représentation
dans l'Etat et
dans la
mondialisation,
les ouvriers
n'avaient
désormais que
faire de leur
mythe
collectiviste
étatique et
rédempteur de
l'humanité. Leur
âge positif
comme composante
de toutes les
modalités du
peuple
(politique
social sociétal),
s'était inauguré
au moment même
où leurs
représentants
les trahissait
dans l'antipeuplisme
et l'idéologie
de l'identité
nationale
négative. Pour
reprendre une de
leurs plus
inusables
formules
historiques
antérieure, ils
savent depuis
longtemps qu'ils
ne peuvent
compter que sur
eux mêmes pour
s'émanciper dans
la vie séparée,
d'une
civilisationnelle
modernité, et
dans la vie
publique au sein
de leurs
immédiates ou
plus distantes
appartenances
populaires. A
l'exception des
grands
mouvements
sociaux tels
celui de 1995,
et surtout de
leurs votes
conséquents mais
éclatés, aucune
expression
politique
unifiée n'a pu
encore surgir
de la nouvelle
résistance, à
l'exception de
l'exceptionnelle
victoire du Non
au referendum
européen de
2005, et surtout
abstraction
faite de leur
obstination
électorale
multiforme qui
atteint en juin
2009 dans les 60
% d'abstention à
la comédie de
l'élection à un
"parlement
européen" où ne
s'agitent depuis
longtemps, avec
des
pouvoirs
totalement
délégués à
l'oligarchie
financière de la
"commission",
que les
serviteurs de
cette
oligarchie.
Des forces
antisystémiques
semblent au
niveau mondial
surgir
aujourd'hui avec
les grandes
nations-quasi-civilisations
dans la crise
systémique
mondiale
manifeste dès
l'été 2008.
Mais,
contrairement à
la situation
issue des
grandes
révolutions du
18° au 20°
siècle, aucune
des puissances
qui ainsi
surgissent ne
peut se
présenter,
jusqu'à présent,
avec un discours
universalisable
apte à fédérer
les multitudes
de dépossédés
qui vont surgir
dans les
différentes
sociétés, de la
crise qui court
avec une
sidérante
rapidité, quelle
que soit
l'importance
historique,
toujours sans
relai stabilisé
des
révoltes
populaires,
électorales et
pacifiques, des
Présidentielles
françaises
d'avril 2002 et
surtout des
non à l'Europe
mondialisée de
2005 en Hollande
et en France.
Les observateurs
les plus
compromis dans
la pensée unique
inaugurée vers
1984,
verrouillée
apparemment en
1992 (Traité de
Maastricht) mais
déjà bousculée
en France à
l'automne 1995,
ne peuvent
cependant plus
échapper au
questionnement
problématique
d'un retour des
peuples,
déjà théorisée
aussi avec une
brillante
anticipation par
Emmanuel Todd
dès l'automne
1994, mais qui
en reste à
exprimer des
modes de révolte
voire de
résistance
plutôt qu'un
mode de
résolution de la
crise engagée,
crise de la
mondialisation,
crise du carcan
bureaucratique
et financier
qu'est l'Europe,
mais crise plus
générale aussi
des horizons
civilisationnels
et politiques
d'un dépassement
par le haut.
Nouvelle époque,
nouveaux
concepts
nécessaires,
mais pour le
Lestamp
continué, ils
s'intègrent dans
le fil de ses
propres et
anciennes
élaborations que
certaines
autorités
institutionnelles
- jusqu'à un
président
d'Université qui
engagea contre J
Deniot une
procédure de
blâme, lui
renvoyaient
comme
"passéistes" et
qui pourraient
s'avérer comme
les plus
radicalement
éclairantes des
mobilisations
réactives au
processus
contemporain. Le
Lestamp n'a t-il
pas réintégré
autour des
peuples et du
populaire
considérés comme
des objets
théorico-historiques
à jamais
problématiques,
hors de toute
dogmatisation, à
la fois le
mouvement
(processus et
surtout histoire
vivante
continuée
notamment des
salariats, des
paysanneries et
peuples ruraux,
des nations et
des langues
nationales au
sein de la
mondialisation)
et les socles
anthropologiques
fondamentaux de
la raison
humaine et d'une
humanisation
différenciée,
pensée comme
système de
défense face à
la crise
violente
toujours
latente,
immanents aux
formes de vie
populaires,
considérées
comme
mobilisations
viables et
cultures
activement
performatives.
Mais ce
populaire du
Lestamp, ne
se réduit
pas au
fractionnement
d'ainsi nommées
classes
populaires
(unifiés par le
rapport au
travail et à la
famille ?), en
un mot au peuple
social, au sein
duquel se sont
fondus les
ouvriers, et
irréductible à
l'anachronisme
méprisant d'une
plèbe. Ce
peuple social
est approché en
sociologie trop
classiquement
comme
l'agrégation
supposée simple
des catégories
modales de
travailleurs
actifs ou
retraités, du
salariat
(ouvriers
employés), de la
petite
production
(paysans,
artisans),
encore y faut-il
ajouter les
dénotations
situées soit
d'une pensée
stratifiante de
hiérarchisation
soit d'une
simple topique
héritière du
mouvement
révolutionnaire
français où le
Tiers-état était
le socle
nourricier, - le
mouvement
ouvrier se dira
dans ce fil
expression des
"producteurs",
non le bas. Dans
la sociologie de
la culture
émanant de
Bourdieu et
Passeron, le
mot fut une
commodité pour
masquer à
l'origine la
pensée
violemment
stratifiante qui
se
problématisait
dans la trilogie
si réductrice,
du supérieur du
moyen et du
populaire... Ouf
on a évité la
crudité anglaise
du lower.
Lorsque les
intellectuels se
séparèrent du
peuple, dans les
années 80 tout
se radicalisa de
nouveau dans une
sociologie se
prétendant
encore "de
gauche", alors
qu'elle s'était
presque
intégralement
asservis aux
"dispositifs" de
dénormalisation
de l'emploi, de
l'instauration
assistantielle
d'un apartheid
d'assistés et de
dispensés du
travail, qu'elle
se contenta de
légitimer et
d'illustrer avec
le
bas
de Verret relayé
par Schwartz et
Collowald, la
nouvelle
condition
ouvrière de
S Beau, et les
grotesques
dominés
de Bourdieu et
de ses
lamentables
épigones. (voir
les notes du
Prélude)
Il reste que ce
populaire du
mode majoritaire
de la société se
définit à
l'interférence
de l'empaysement
la
territorialisation
est première),
du travail (les
travailleurs) et
de la culture.
L'apport propre
du Lestamp
association
(alternatif) ,
par élaboration
sur ce point
dès les années
90 (par
convergence
des réflexions
ou des travaux
explicites de
Joëlle Deniot,
Jacky Réault
voire Pierre
Cam, se définit
sur la nécessité
de ne jamais
quitter l'interférence
toujours
problématique et
pourtant
essentielle du
peuple social et
du peuple
politique
(Populus
dit la tradition
juridique)
au lieu de les
opposer
scolastiquement
pour mieux les
déconsidérer
comme
"populistes", ou
les reléguer par
un véritable
racisme de
classe doublé
d'une
disqualification
de la démocratie
même, comme un
bas, d'inculture
scolaire,
de mauvaises
conceptions de
la vie, et de
mauvais votes.
Le peuple nation
et le peuple
social ont
également été
l'objet de l'antipeuplisme
des années
80-90, qui
accompagne tant
la
mondialisation
que la
"construction"
oligarchique de
l'Europe. Dans
les années 2000,
Le Lestamp
développe,
essentiellement
Jacky Réault
relayé par
Joëlle Deniot,
un troisième
terme qui
s'est élaboré
autour d'une
conception
autant
épistémologique
que sociétale du
commun[4],
ce
concept dénotant
aussi bien un
mode d'existence
beaucoup plus
large du peuple
et du populaire
(le peuple
sociétal, toute
la société en
tant que culture
congruente et
identifiante, à
l'exception donc
des oligarchies
et appareils
séparées
solidaires de la
mondialisation
appréhendée
comme processus
et stratégie
centrale (Guy
Bois), qu'une
exigence
spécifique de
recherche et de
pensée. Le
travail réflexif
se fit et se
fait, - peut-on
dire ? - sur les
mots de la tribu
(Mallarmé).
Lieux communs
des sciences
sociales, avions
nous programmé
dans
l'introduction
au Colloque Les
sociétés de la
mondialisation
de décembre 2004
à Nantes) sans
"rupture" avec
la connaissance
ordinaire,
-interférence
assumée avec un
autre résistant
qu'importe qu'il
soit d'une autre
rive, M
Maffesoli- dans
le refus des
machineries
logomachiques de
terreurs
théoriques dont
la reproduction
mimétique et
catéchistique de
l'héritage
bourdivin
manifeste aux
dépens des
étudiants mais
aussi de la
validité de la
sociologie dans
son ensemble,
les plus
affligeants
effets. Le
besoin le plus
crucial dans
cette
concomitance de
l'accélération
de l'histoire et
des mutations
sociétales, et
de la crise
théorique et
gnoséologiques
des sciences
sociales était
organiquement,
d'abord de
redéfinir
l'ensemble des
rapports
sociaux, ce
concept à sauver
de Marx, à
l'exclusion
de tout retour à
la théorie
générale
connaissable
d'un nouveau
matérialisme
historique
ensuite de
profiler
d'éventuels
nouveaux
collectifs
pertinents,
classes ou non
classes ou
simples forces
sociales à
géométrie
variable au
regard d'un État
délabré et d'une
politique molle,
entre nébuleuses
plus ou moins
agrégées,
groupes et
réseaux et dans
leurs contextes
nationaux,
régionaux
(européen) et
mondial. Le
besoin théorique
de reconstruire
sur
l'obsolescente
intellectuelle
lente mais
continue de la
sociologie
universitaire
s'imposait
d'autant plus
que la scission
revendiquée par
les dites
nouvelles élites
(Christopher
Lasch, Emmanuel
Todd) - à vrai
dire nous
préférons
restituer
l'opposition
fondatrice du
grec ancien qui
dit oligarchie-
, à l'égard du
populaire dans
tous ses états,
dessinait comme
on l'a déjà
évoqué plus
haut, entre
société et
politique, et
jusque dans
l'expérience
commune des
referendums de
1992 et de 2005
et du mouvement
social de 1995,
de nouveaux
clivages
pertinents
[5]
à éprouver sans
fin sur la seule
aune
scientifique qui
vaille sur la
longue durée, la
réfutabilité.
_____________________________________________
........Ces
rappels minimaux
de l'histoire de
plusieurs unités
de recherche au
sein de
l'histoire
générale du
monde (Braudel),
que nous
pourrons ré
évoquer plus
succinctement
dans la suite de
ce propos,
aideront à
formuler ce qui
constitue pour
nous le
principal
faisceau d'
interrogations
que nous suggère
le texte de
Jean-Paul
Molinari -
indépendamment
de ses contenus
manifestes qu'il
n'est pas besoin
d'introduire ici
exhaustivement
pour qu'ils se
défendent
d'eux-mêmes. Le
lecteur à ce
point de
l'exposé peut
selon son
intérêt se
brancher sur
"Où en est la
classe
ouvrière", pour
y collecter un
riche corpus
empirique à
désintriquer de
la cuirasse
anachronique de
la classe, où
continuer ce
texte dont le
propos plus
abstrait,
quoique
largement indexé
à celui de JPM,
présente la
cohérence propre
de sa critique
historique et
théorique autour
des concepts qui
en condensent
les enjeux mais
toujours dans la
référence à la
France réelle,
société (plus ou
moins) de, mais
radicalement
dans, les
sociétés de la
mondialisation
du capitalisme
historique. Pour
ne pas alourdir
la lecture nous
avons reporté
certains exposés
définitoires ou
historiques dans
un certain
nombre de notes
consistantes
dont la lecture
constitue un
troisième étage
de réflexivité,
cette nécessité
dont nous
essayons de
diffuser
l'exigence très
actuelle, sur
fond de crise
des sciences
sociales, au
sein d'un second
laboratoire
instituant
explicitement
une
interdisciplinarité
en réseau
spatialisé,
Habiter-Pips de
l'Université de
Picardie Jules
Verne (Voir
journée d'étude
du 10 décembre
2008 sur le site
sociologie.cultures).
Le
double bind de
La
classe
et du
Bas,
sur fond
d'interdit du
peuple
S'il
fallait d'une
seule formule
cavalière
résumer les
interrogations
que suscite ce
texte à la fois
typique et
singulier ce
serait celle,
paradoxale, de
la
savante
actualisation
(2003) d'un
anachronisme :
la résurrection
verbale de cette
unité sociale
radicalement
unique dans
l'histoire qui
s'était
affirmée, (ou en
tout cas dont
une fraction
plus ou moins
large et les
représentants
institués,
s'étaient
affirmés..) face
à la société et/
ou face à
l'État, comme
classe ouvrière
En France entre
1831 (révolte
des canuts) ou
Juin 1848
(insurrection
ouvrière
parisienne) et
1968 pour le
commencement de
la fin et 1984
pour la fin de
la fin ; les
dates étant ici
des marqueurs
forts et non des
couperets.
On ne veut
évidemment pas
ici débattre de
tous les avatars
de cette
appellation
historique de
leurs enjeux
politiques d'une
périodisation de
sa courbe
historique, mais
seulement aider
à contextualiser
un texte qui
pourrait sembler
se réduire au
temps par
définition
éternisé d'un
mythe alors
qu'il est aussi
passeur de
larges faisceaux
de connaissances
exactes,
rarement réunies
dans un article
de sociologie
quoique
finalement assez
loin de
l'impossible
ambition de son
titre.
Que signifie en
2002, 2003, à
l'égard d'une
"classe
ouvrière",
reconnue par
ailleurs et dans
le même propos,
comme
éclatée
ou plus
radicalement
historiquement
abolie, ce
retour tardif du
disciple à la
réaffirmation
verbale d'une
vision de
nouveau
unitaire, autonomisée
et
conceptuellement
univoque des
multiples
milieux ouvriers
réels mais
presque toujours
mêlés en milieux
populaires à
large spectre,
plus divers que
jamais, comme il
le montre
d'ailleurs dans
le prisme de ses
critères
catégoriels,
mais divers sous
bien plus de
points de vue
qu'il n'en
évoque ? Vingt
deux ans se sont
écoulés depuis
la fondation du
Lersco qui
s'était certes
auto-identifié
avec un mélange
de superbe et
d'inconscience,
à l'instigation
de son
fondateur, comme
son sociologue
collectif alors
que la classe
ouvrière
historique se
situait en
France pourtant
déjà dans la
phase finale de
son cycle
symbolique
affectif et
politique, en un
mot (qui
contrairement au
sot usage qu'en
fait le
sociologisme,
est indicateur
d'unité
vivante),
mythique. Il y
avait par
ailleurs bien
quatorze ans que
Michel Verret
lui-même avait
quasiment
renvoyé dans le
registre du rêve
(Où va la
culture ouvrière
française ?-
1989 et
C-O 1995)
(certes ouvert)
le devenir
politique et
même
démographique,
d'une classe
ouvrière
française
désormais
indexée à toutes
les modalités
d'une "fin": fin
de classe, fin
d'époque ? (Où
va la classe
ouvrière
française 1989
et 1992,
republiée in
Chevilles
ouvrières
(C.O.),
L'Atelier,
1995). Là
réside le
premier faisceau
de paradoxes,
assorti de cet
abandon par JPM
de la
qualification
nationale (?)
principale
référence
pourtant du
populaire, ce
refoulé ; il y
en a un second,
beaucoup plus
discrètement
manifesté dans
le texte
puisqu'il s'agit
d'une
contradiction
théorique donc
de facto pour
JPM,
personnelle,
majeure. Michel
Verret fondant
le Lersco en
1971 avec une
équipe nantaise
dans la capitale
d'une alors
Basse Loire
encore très
industrielle et
très ouvrière,
s'était posé
dans les
sciences
sociales comme
le héraut sans
rival ( en tout
cas il fit tout
pour cela et par
tous moyens)
d'une étude
scientifique de
la classe
ouvrière
inscrite sur la
défense et
illustration
d'une
problématique
des classes
sociales indexée
aux écrits
économiques de
Marx, et
sublimée pour
tout lecteur
cultivé par la
fonction sinon
mission
historique du
prolétariat
quoique M.
Verret n'alla
jamais très au
delà de
l'indexation
purement
économique de sa
définition
distinctive,
alors qu'il
vécut longtemps
au milieu du
continent de
l'ouest français
des ouvriers
possédants aux
forts et stables
lignages
largement liés
aux paysans,
artisans ou
professions
intermédiaires
et profondément
chez eux dans
leurs
territoires
historiques y
compris ruraux.
De la
dictature du
prolétariat
largement
empruntée aux
Questions du
léninisme,
à l'éthologie
humaine du "bas"
et des
"dominés"...
Depuis le milieu
des années 80,
peu au prou
après l'année
orwellienne de
1984, et en
tout cas dès sa
migration
parisienne MV en
vient très
rapidement, par
dépit politique
ou par mouvement
naturel de sa
pensée profonde,
à mettre cette
problématique
historique de
classes, en
concurrence dans
ses écrits et
propos, (voire
presque à lui
préférer, dans
nombre de textes
publiés dans
Chevilles
Ouvrières
recueil de 1995,
L'Atelier ), la
redoutable
polarisation
binaire du haut
et du bas, qui
s'avéra
logiquement dans
la suite de ses
expressions
désormais
parisiennes,
grosse d'une
dévalorisation
active assez
stupéfiante des
ouvriers réels
accusés si l'on
peut dire, de
mal tourner ;
jusqu'à devenir
"la classe
raciste", de la
réédition du
Travail ouvrier
.
Dans l'article
que JPM
avait consacré
dans le
Mouvement social
à La
sociologie de la
classe ouvrière
de Michel
Verret, il
relève
clairement cette
glissade, en
tout cas dans le
registre de la
culture, de la
classe ouvrière
au bas.
D'évidence il en
est troublé mais
n'ose en
manifester aucun
commentaire.
Certes on peut
trouver
antérieurement
au milieu des
années 80, un
chainon
transitoire
entre le Verret
de la classe et
le Verret du
bas, cette
obsession de ne
vouloir décrire
l'ouvrier que
dans la
passivité d'un
entrepris, - que
relève aussi
Roland
Pfefferkorn -,
littéralement
fait marchandise
dans le rapport
salarial
(pourquoi lui et
pas les autres
salariés ?) et
s'affairant dans
sa "définition
distinctive"
seulement sur la
matière et sur
les choses,
indexation aux
choses qui le
hante et que
l'on retrouve
dans l'entretien
accordé à Annick
Madec en 2005 :
tu es un
peu (beaucoup)
chose toi même
(non) lecteur !
L'ouvrier de
Verret, qu'il
n'imagine jamais
exister hors de
son appartenance
de classe et de
son indexation à
la production,
(contrairement
au travailleur
libre de Marx
d'entrée
appréhendé comme
"personnalité
vivante") n'est
actif que dans
"les luttes", ce
syntagme quelque
peu usé du
verbalisme
trotsko-léniniste, qui
présupposent
toujours
l'incorporation
à un collectif ;
autant dire
qu'il n'a pas de
vie séparée
adéquate à son
concept, si elle
n'est pas
déductible de sa
définition
distinctive dans
la sujétion
salariale et
l'assujettissement
machinal. Ce que
nous avons
qualifié de
mobilisations
privatives
(JR Lersco 1989
et 1994)
notamment
inscrites dans
des milieux
populaires
territorialisées...
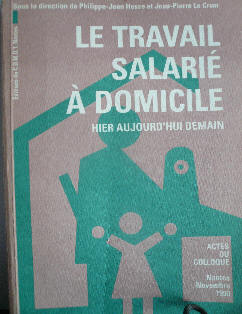 |
Jacky
Réault
Le
travail salarié à
domicile en France : une
affaire de femmes et de
milieux populaires
pluriels.
Etude
écosystémique
statistique et
cartographique |
....
des
écosystèmes
sociaux de
reproduction
( J R Lersco
Cnrs 1989)
évidemment
transversaux aux
plus ou moins
post-classes
sociales,
ou d'hétérogènes
peuples
horizontaux
dessinés par des
genres de vie et
cultures
territorialisées
et inscrits dans
de singuliers
espaces temps
n'a pas cours
dans son
marxisme
finalement
si sensible en
sa phase finale
à la pensée
radicalement
stratifiante de
la sociologie
anglo-américaines
devenue
composante
idéologique
principale de
l'esprit de la
mondialisation
comme de
l'idéologie
bourdivine pure
expresion de sa
rampante logique
d'apartheid, sur
horizon de
désouverainisation
des peuples
désymbolisés. Il
tend à réduire,
dans le fil même
de cet esprit,
le feuilletage
un peu rigolo et
souvent
inoffensif des
stratifications
sociales prises
à la lettre
upper lower
classes etc., à
l'hystérisation
brutale du
binaire : le
haut le bas, à
la quelle nous
avons tous
touché par
schématisme
scholastique
quand elle fut
légitimée par
MV, mais qui
éclairée par
quinze
supplémentaires
années de
mondialisation
est devenue
insupportable.
Dans ses
œuvres tardives
influencées par
la décomposition
du droit du
travail sous
hégémonie de
l'OCDE et plus
trivialement par
les
sous-cultures
pseudo-scientifiques
des "sciences
économiques et
sociales" (SES),
ce catéchisme
idéologique
scholastique, de
ses nouveaux
alliés
parisiens) il va
jusqu'à
qualifier le
salarié de
dépendant (en
contradiction
radicale avec
Marx qui
connaissant le
sens historique
fort, des liens
de dépendance)
et finit parfois
par sombrer dans
la mécanique
méprisante du
dominé
retrouvant dans
cette régression
éthologique de
la sociologie,
un rival devenu
de façon
posthume, mais
en tout cas dans
les alliances
institutionnelles
avec les
épigones, un
compère, P.
Bourdieu.
...jusqu'à
l'antipeuplisme
enrobant les
ouvriers réels.
Ce
retournement qui
n'est donc pas
complètement une
inversion
n'exclut pas le
maintien
parallèle et
selon les
interlocuteurs,
de l'ancien
langage, mais
pour un regard
d'historien, il
s'inscrit
clairement dans
un propos de
dévalorisation
globale des
cultures, des
votes, des
mouvements, des
identifications,
populaires, en
un mot dans l'antipeuplisme
qui, comme l'ont
fortement montré
les travaux
d'Emmanuel Todd,
de Pierre André
Taguieff,
fut l'idéologie
nécessaire à
l'abandon
rampant de la
souveraineté du
peuple et de la
référence à la
nation de 1789
par les classes
parlantes
mondialisées
des grandes
ville, tenants
de l'État
(Poulantzas) et
des appareils
idéologiques
d'État (un
possible concept
transférable de
ce qui peut-être
reste l'apport
althussérien ?)
Cette rupture
eut d'entrée
comme corollaire
longtemps
inexprimée et
désormais
manifeste une
conception
tendanciellement
oligarchique de
la politique qui
trouva
d'ailleurs comme
son refuge
naturel dans la
dite
construction
européenne et la
disqualification
aussi cynique
que systématique
de tous les
votes non
conformes aux
vues des
appareils
dirigeants. De
la grande classe
ouvrière
libératrice de
l'humanité à un
bas de la
société de plus
en plus douteux
et défait quelle
pirouette et
quelle
ingratitude.
Comme l'avait
écrit lui même
Michel Verret à
propos des
étudiants de Mai
68 rendus à ses
yeux totalement
transparents par
la conjonction
également
redoutable du
marxisme et de
la sociologie
(Mai étudiant ou
les
substitutions,
La Pensée 1969)
: On ne brule
bien que ce que
l'on a adoré.
Les œuvres trop
tardives n'ont
sans doute plus
le temps de se
tourmenter de
leurs
contradictions,
la classe, le
haut, le bas.
Drôle de science
: deux épigones
périphériques en
mal
d'inspiration
ajoutèrent
récemment sans
rire -
impossible il et
elle, étaient
deux, l'homme de
la vie privée et
la femme du
populisme, - le
"fragile» ! En
gros la caisse
marquée le
camion de
déménagement,
sommet
d'objectivation
qui fait
bizarrement
penser à la
mutation de
l'œuvre en pièce
dans le dit art
contemporain. On
trouve désormais
chez le maître à
la fois la
terrible
sociologie
radicalement
verticale qui
semble issue du
Métropolies, de
Fritz Lang, et
celle aussi des
media de masse
et des
oligarchies
mondialistes
(Élites versus
populisme, comme
il convient de
dire pour
masquer la
véritable
opposition
peuples/oligarchies)
et parallèlement
la
substantialisation
et la
fétichisation
théorique de ce
que Marx
lui-même n'était
pas vraiment
parvenu à
définir
abstraitement
(voir
l'avortement
quasi
psychiatrique du
chapitre
correspondant du
Capital), une
classe sociale
absolutisée que
révèle ce
vocable
strictement
idiosyncrasique,
appliquée à la
seule
classe
ouvrière, La
classe
!.
L'impossible
synthèse et
euphémisation de
cette dérive du
fondateur du
Lersco par JPM
et sa résolution
classiste
et classique par le
verbe et la
statistique.

L'intellectuel
stalinien ?
Chat saisissant
un oiseau -
Picasso.
JPM
dans cet ultime
texte de
commande a donc
dû sans pouvoir
l'expliciter,
affronter ce
double double
bind
anachronique et
théorique. Il
résout la
première
contradiction
par une pratique
commune dans le
milieu quand il
est interdit de
problématiser
les
problématiques,
collecter des
données et des
références sur
un territoire
défini à
l'avance par
l'autorité de
référence, quel
qu'il soit : le
métier de prof
qui a un
programme
hétéronome en
quelque sorte.
La seconde il ne
peut l'exprimer
frontalement et
la contourne par
le haut, si l'on
peut dire. Il
est lui issu du
peuple,
instinctivement
populaire.
Malgré plusieurs
demandes de MV,
il est vrai
contredites par
ses alliés
locaux, il ne
quitta pas le
Lestamp pour le
laboratoire
concurrent fondé
pour le
détruire. Malgré
une longue
discipline dans
les appareils
communistes (il
y a une
antinomie entre
peuple et
bureaucratie,
entre peuple et
État, et c'est
une des
définitions
pertinents du
peuple que de
l'affirmer
simplement), il
ne pouvait
s'inscrire dans
la méprisante
pensée du bas
issue des
métamorphoses du
maître. Il
ne pouvait que
très peu
partager, - on
le lira sur ce
plan là plus
opportuniste car
il doit négocier
sa légitimité
avec les
puissances
disciplinaires
de l'ENS ou du
CNRS qui
monopolisent le
propos ouvrier
sociologisé
actuel (entre
les gardiens de
prison des
ouvriers déchus
de de la classe
ouvrière
disparue,
Olivier Schwartz
et Stéphane
Beaud parachuté
à Nantes même
pour détruire
l'autre
tradition de
sociologie
ouvrière, celle
de Joëlle Deniot
et de Jacky
Réault), toutes
les modalités du
misérabilisme
qui ont fleuri
dans
l'université en
mondialisation
accélérée dans
l'œil du cyclone
nantais de la
décentralisation
prédatrice. Il
reste résistant
aux logomachies
de la
précarité ou
de l'exclusion
essentialisées,
qu'il avait tant
dû combattre
comme enseignant
contre une
doxa locale
fortement marqué
par le
confusionnisme
assistantiel de
la
deuxième gauche
participant au
pouvoir de 1981
à 1984, et
exerçant le
pouvoir de 1988
à 1991. On le
lit plus obligé
de faire place
aux nouveaux
misérabilismes à
prétention
théorisée mais
finalement plus
médiocrement
malveillant et
méprisant du
Retour sur la
condition
ouvrière ou
du glissement de
la vie privée
des ouvriers,
déjà indigénisés
avec
condescendance,
à un
positionnement
entre
le bas
et le
fragile
Certes c'est le
maintien verbal
anachronique
d'une unité
imaginaire qui
lui est imposée
dans la commande
de cet article
qui fait
mécaniquement
apparaître de
facto toutes
variations et
métamorphoses
réelles dans le
prisme de la
destruction
décadente et/ou
souffrante,
mais, cette
latence logique
des prémisses,
il la ressent
; et s'il n'en
rajoute pas ou
peu, il ne peut
la dépasser sans
se taire.
A ce point de
l'analyse nous
intégrons la
seule citation
que nous faisons
de ce texte de
libre et
parallèle théorisation
indexée à un
autre texte mais
référée à un
réel. Elle
s'inscrit dans
les ultimes
développements
du propos de JPM
et condense
toutes ses
contradictions.
La première est
manifeste. Il
doit trouver
une nouvelle
classe ouvrière
quand même et
assez
contemporaine et
sans prononcer
le mot de
mondialisation,
le commode,
syncrétique et
anachronique
libéralisme
du
post-militantisme
gauchiste fera
l'affaire.
"La
nouvelle classe
ouvrière du «
libéralisme »,
fait
l'expérience
lente et
contrastée-
vieille patience
ouvrière -d'un
nouvel âge,
pièce inédite
qu'elle doit
jouer avec de
nouveaux acteurs
historiques qui
partagent avec
elle la
souffrance en
France."
La
deuxième
contradiction
n'est pas de
même nature elle
est, pensons
nous
radicalement
existentielle
donc intégrant
aussi les
contradictions
théoriques
vécues comme
telles et qui
plus est
hétéronomes. Au
terme de
l'article il
semble donc,
contrairement à
ce que nous
avons développé
plus haut, être
happé encore
plus loin du
misérabilisme
sociologique
projeté sur les
mondes ouvriers
actuels, dans
une sorte de cri
doloriste liant
la classe
éternisée dans
l'esprit des
sociologues
d'école, et souffrance
en France, -
le syntagme
choisi en ce
moment de
facto
doublement
testamentaire
est par ailleurs
le titre d'un
ouvrage
estimable voire
qui fut
nécessaire en un
moment et dans
le désert
qu'était devenu
la sociologie du
travail. Il nous
semble
cependant, si
l'on nous permet
ici une
interprétation
plus
personnelle,
qu'il manifeste
là non un
basculement
problématique
régressif -même
par rapport à
son économisme
marxiste
tardif-, mais un
véritable
désespoir
personnel ainsi
projeté, ce
désespoir est
d'abord
conscience de la
partie absurde
de sa feuille de
route comme on
le développe
dans tout cet
article, mais
aussi celui de
sa propre vie
qui approche de
son terme. Il
serait
évidemment
indécent de ne
pas rappeler, au
nom de ce tabou
de la présence
de sujets
humains dans les
sciences
sociales que
trois mois plus
tard il
disparaissait.
Revenons
cependant et
définitivement à
un propos borné
à la réflexion
idéelle sur les
idées et les
factualités de
son texte au
sein des
sciences
sociales
plurielles et à
géométrie souple
où nous situons
dans ce propos
: Toute impasse
historique ou
biographique
éprouve le
besoin d'un
refuge
imaginaire ou
tout simplement
verbal, son
entrée dans le
propos sera dans
cette
contradiction
qui le taraudera
jusqu'au bout
sans qu'il ose
la résoudre une
classe ouvrière
éternisée (c'est
le présupposé
logique absolu
du propos) et
pourtant défaite
qu'il n'ose et
ne peut sans
abolir tout son
travail
reconnaître
comme disparue
et totalement
inadéquate au
traitement qu'il
lui impose
post mortem.
On le sent plus
que mal à l'aise
dans cette
aporie mais il
la résout
théoriquement
dans les
postulats
théoriques
fondateurs et
déjà réducteurs
alors, du
Lersco, définis
par Michel
Verret qui,
pour mieux la
sociologiser,
(acharnement
sociologiste,
forme
contemporaine de
la thanatopraxie
?) avait réduit
la classe
ouvrière,
d'entrée à ses
caractères et
déterminants
"économiques"
supposés
univoquement
indexés par les
critères
statistiques de
l'État français
alias l'Insee,
une catégorie,
travers normal
d'une
philosophie
sociale,
mais devenue
plus proche de
l'impératif
kantien (je
maintiendrai)
que des robustes
abstractions
d'Aristote.
L'ainsi nommée
classe ouvrière
de 2003 et de
cet essai c'est
donc
essentiellement
tout ce qui a pu
être collecté
dans cet agrégat
administratif,
largement
construit
c'est à dire
artefactuel et
c'est ainsi
qu'il peut se
réfugier lui
aussi dans ce
blockhaus verbal
inexpugnable qui
se moque de
l'histoire
réelle ; on peut
toujours
bureaucratiquement
faire l'ensemble
des dénommés
ouvriers dans
les recensements
de la
population. Et
ce sanctuaire
c'est pour lui
comme pour M.
Verret cet
hologramme
transcendantal, La
classe, par
la quelle il
avait déjà
introduit son
article sur
La sociologie de
la classe
ouvrière de
Michel Verret
dans la revue Le
Mouvement
social.
Décidément le
syntagme le plus
marqueur et
quasi exclusif
de
l'interférence
biographique
intellectuelle
et personnelle
de ces deux
universitaires
communistes qui
même défroqués
ne purent jamais
se défaire de
l'âpre goût des
vérités
apodictiques
d'un
matérialisme
historique
réduit à une
scholastique. On
peut cependant
peut-être plus
largement y
chercher, et il
y faudrait les
concepts de
l'ethnopsychanalyse,
un des symptômes
de la crise
intellectuelle
et culturelle
des héritiers de
la dogmatisation
étatique de Marx
à laquelle
contribuèrent à
la fois le
marxisme
stalinien,
condensé dans
Les questions du
léninisme de
Joseph Staline
où s'inscrit
biographiquement
la formation et
l'action
idéologique de
M. Verret au
sein du
mouvement
communisme et,
plus bénins pour
l'histoire
humaine, la
paresse
théorique et le
besoin d'alibi
immobiliste de
la
social-démocratie,
et finalement le
dogmatisme
sectaire des
héritiers de
Pierre Bourdieu.
Qui se souvient
encore de cet
antihumanisme
théorique,
pointe extrême
du délire
chosifiant du
structuralisme
stalinisé, que
Michel Verret
présenta, en
lisant le texte
de Louis
Althusser, au
Comité central
d'Argenteuil de
196x.
?,
et qu’il
redoubla à sa
façon dans les
essais intitulés
Théorie et
politique,
seul livre que
consentirent de
publier les
éditions
sociales,
émanation
directe de la
direction du
PCF, indépendant
de l'affligeant
factum de guerre
froide intitulé
Les marxistes et
a religion.
Quels sens et
quelles
fonctions de
cette ré
affiliation dans
un des casiers
de l'institution
disciplinaire de
la sociologie du
21° Siècle ?
Au delà de cette
collecte dans
les tiroirs
robustes d'un
meuble d'époque,
et plus
profondément de
quel propos
nouveau ou
ancien,
scientifique,
idéologique,
politique,
personnel...
a-t-il pu s'agir
en 2003 dans ce
rapport du
maître qui avait
de toujours
balisé le champ
du possible et
du disciple de
long cours qui
n'en était pas
moins un savant
professeur ? On
se bornera ici à
quelques
élémentaires et
objectivables questions
; d'autres
seraient ici
peut-être
indiscrètes et
les
questionneurs
impénitents qui
y chercheraient
des enjeux plus
publics peuvent
en induire
beaucoup du
texte
radicalement
inouï - une mise
au bûcher
explicite- que
le maître donna
aux éditeurs des
Mélanges offerts
lors du départ
en retraite du
disciple en
décembre 2001 -.
A un premier
degré de
repérage dans la
conjoncture des
sciences
sociales de ce
moment on peut
expliciter une
première série
de questions :
- A la décharge
de J P Molinari
il écrit dans le
contexte d'un
petit monde de
(pas toujours
ex-)
intellectuels
staliniens mal
reconverti qui
tente un revival
des vieilles
lunes pour
valoriser les
fonds de tiroir
d'une formation
actuelle mal
actualisée ?
A-t-on affaire
avec cet essai à
cet étonnant
retour des
classes
qui s'affirme
alors dans un
petit milieu (
et pour un court
moment que
s'empresse de
renier
l'éditeur, P
Bouffartigue,
voire infra) qui
ne parvient pas
à trouver de
boussoles neuves
pour les
nouvelles
navigations
qu'impose le
monde
révolutionné par
30 ans de
mondialisation
?. N'est-ce pas
le titre
d'un livre à La
Dispute, - queue
de comète des ex
Éditions
Sociales
support de la
post-orthodoxie
marxiste recuite
du PCF-, où
figura la
dernière
contribution
éditée de JPM ?
Dans ce livre
qui constitue,
si son article
est totalement
le sien, son
ultime
engagement
public, figurent
essentiellement
des (plus ou
moins) (post
néo quasi para
?) marxistes,
- étonnant
identifiant qui
redevient à la
même époque un
des marqueurs
intellectuels
fondamentaux de
M. Verret dans
les échanges
oraux. "Deux
marxistes nous
ont quitté (JPM
et CL), petits
deuils
évidemment" ! -
en l'occurrence
surtout des ex
communistes,
alors que dans
la fin de sa vie
professionnelle
JP Molinari
s'était souvent
porté allié, et
d'ailleurs
contre ses
propres
camarades de
laboratoire, des
épigones de P.
Bourdieu ex
rivaux en
exclusivisme et
intolérance
intellectuelle
sinon en
inventivité
sociologique. -
Au delà de la
proximité
naturelle
d'anciens
combats, doit-on
analyser ce
revival
verbal
dans une
logique
institutionnaliste
et politique
visant à
constituer une
force de réseau
au sein de la
sociologie
disciplinaire
désormais
écartelée en
clans de
reproduction et
de pouvoir ?
Quoiqu'il en
soit l'homme qui
l'accueille ne
s'embarrassera
pas de fidélité.
La pression du
maître
s'est-elle
désymbolisée ?
En tout cas
moins d'un an
après
nous voyons Paul
Bouffartigue,
l'auteur-éditeur
de l'inénarrable
Retour des
classes (La
Dispute) où fut
publié le texte
remanié de J P
Molinari sous ce
vocable de Musée
social
nostalgique,
inverser la
vapeur reprendre
l'essentiel de
nos thèses (en y
ajoutant la
bouille
écolo-féministe
obligée et
qualifiée sans
rire de "niveau
supérieur" et
occultant
l'essentiel, l'hyperbourgeoisie
mondiale et ses
relais
post-nationaux)
dans Luttes des
classes sans
classes publié
dans la Revue de
grand public
étudiant,
Sciences
Humaines (2005,
via le site
Web), sans nous
citer, ce n'est
pas trop grave,
les écrits
(1984, 1989,
2004, 2005)
restent malgré
leur diffusion
restreinte par
le milieu où
l'orthodoxie
règne. Mais
qu'en est-il de
l'incohérence
intellectuelle
de sa propre
trahison. Nous
restons
stupéfaits,
moins pour nous
et l'ensemble du
Lestamp mais
pour le sens
civilisationnel
de cette marque
de débandade de
la raison
universitaire ou
simplement
intellectuelle,
quand, sur le
mode stalinien
bien connu la
thèse antérieure
assénée par un
ouvrage
collectif, (dont
les auteurs et
pas seulement
l'éditeur sont
ainsi en bloc
ridiculisés),
est purement
passée à la
trappe sans
autre forme de
justification.
Belle figure
d'intellectuel
postmoderne sans
doute ou plus
crument
décivilisateur.
Quant ) JPM, il
n'était plus là
pour rectifier
le tir à
supposer qu'il
l'eut accepté,
tant sa fixation
sur la "classe"
s'inscrivait au
plus profond de
son pathétique
asservissement à
l'esprit d'un
autre homme
supermomificateur
mondial du
fétiche.
-S'agirait-il,
plus
modestement de
la dernière de
ces
programmations
exhaustives que
M. Verret,
puisque c'est de
lui qu'il
s'agit,
distribuait sans
fin au Lersco
disparu et aux
étudiants pour
parfaire dans
une
obsessionnelle
exhaustivité
perpétuelle le
monument d'une
œuvre pourtant
si datée, la
sienne, qu’il se
serait agi
d’actualiser
numériquement
sinon
théoriquement ?
N'avait-il pas
précocement pour
remplir ce
programme
bureaucratique
fait passer,
directement ou
indirectement,
des thèses de
"discrimination
positive" dont
le texte
n'aurait pas
alors (les temps
ont changé) et
même peut-être
aujourd'hui,
passé le cap
d'un jury de
maîtrise, entre
les
mathématiques la
vieillesse
et surtout le
meuble...ouvrier,
un peu comme il
a monté beaucoup
plus tard une
HDR bidon et
plagiaire sur la
Chanson réaliste
pour placer la
radicale nullité
d'une vague
disciple,
récemment
remariée à un de
ses amis de la
bonne
bourgeoisie
grenobloise ?
N''est-ce pas
une exigence de
temps long sa
biographie
intellectuelle,
(inscrite dans
une culture de
Gosplan,
ignorant la
sanction de tout
marché
intellectuel
dans une
institution
disciplinaire
under control,
selon
l'expressions
d'un
porte-parole
dans une lettre
anonyme balancée
pour
déconsidérer
Jacky Réault qui
continuait avec
Joëlle Deniot,
le Lestamp
contre la mise à
mort verretienne)
dont l'urgence
narcissique
reste entière
alors que
l'effort requis
commence à le
rebuter, d'où la
délégation de
faire poursuivre
la biographie de
sa classe
ouvrière
immobilisée en
1990, post
mortem. Le
sujet du post
mortem, (trois
possibles),
restant pour
nous indéterminé
? Nul ne sait
absolument sinon
désormais le
commanditaire,
le pourquoi
latent de cette
demande. Ce que
nous a dit (au
Lestamp), J P
Molinari c'est
qu'il avait
effectivement
répondu à une
commande
explicite de
Michel
Verret, en deux
temps ou plutôt
en deux
mouvements
asservis,
d'abord de
relire Marx
( pour quelle
réassurance ou
en fonction de
quel doute ?) et
de produire un
bilan actualisé
de La classe
qui d'une
certaine façon
prolongerait et
achèvera, -
si l'on peut
dire -
L'Ouvrier
français, la
trilogie trop
datée de
L'espace
(1979), Le
travail
(1982) ouvriers
et de la
culture ouvrière
(1987)
abstraction
faite des
compilations
d'articles
abordant in
fine et à sa
façon assez
équivoque (entre
fascination et
dénonciation) la
mondialisation
(Chevilles
ouvrières,
l'Atelier).
C'est dans des
rééditions
purement
reproductives du
corps du livre à
l'exception de
certaines
préfaces (1999)
que le regard du
bas sourd
sous la fiction
maintenue de la
connivence avec
La classe la
seule vraie,
pour lui,
imaginaire mais
adéquate à son
concept,
celle de la
théorie, trahie
par d'incapables
figurants,
opposée à la
réalité d'une
rejet dégouté
des personnes
réelles et
vivantes qui se
trouvaient la
composer. C'est,
empêtré dans ces
fils assez
emmêlés dont
l'acteur n'est
pas l'auteur, un
auteur fasciné,
à ses propres
dires par les
marionnettes que
doit s’engager
ce lourd travail
de collecte et
qu'est rédigé
l'essai
théorico-sociographique
qui suit, au
prix d'un effort
inouï et alors
qu'il est hanté,
- comment ne pas
le dire ici tant
ce texte
d'apparente
tranquillité
théorique, le
trahirait
lui-même - par
le désir de
mourir. Quel
gage si
absolument
indispensable
devait il donc
donner pour
trouver une
telle force à
contre-vie et
quelle réception
en a t il eu qui
ne l'a pas
retenu de passer
à l'acte ? Tout
lecteur un peu
instruit des
ouvrages de
référence y lira
non seulement,
ce qui n'a en
soi rien
d'étonnant sinon
l'inertie
étonnante, la
stricte
tradition du
Lersco des
premiers âges et
l'habituel
référencement
dans les
ouvrages qui ont
été à divers
titres et à
divers moments
de proches ou
d'alliés. C'est
la règle du
milieu. Ce
qui devient plus
incroyable,
c'est chez cet
éminent
professeur des
Universités
ayant accompli
une œuvre et
désormais en
respectable
statut de
retraité, un
texte ou
fourmillent, en
reproductions
littérales, les
formulations
verretiennes des
années 60, 70. J
P Molinari était
un véritable
universitaire
savamment rompu
à ce qui reste
toujours une
aventure
intellectuelle,
frayer et glaner
l'inédit et
l'imprévu dans
le monde des
livres, ce quasi
mimétisme
n'est-il pas
le massif
symptôme d'un
tourment où la
vraie vie et les
identifications
idéologiques
contrôlées sont
organiquement
intriqués. Le
résultat fut si
littéralement
formellement
homologue aux
classiques de
facto datés,
(et dans la
mondialisation
le temps a pris
le galop) de son
maître. Et
pourtant, ce
dernier, à notre
connaissance,
n'en a jamais
explicitement et
publiquement
manifesté aucun
signe de
réception
particulier
quoique,
commanditaire il
en ait été aussi
et très peu de
temps avant la
disparition de
Jean-Paul
Molinari, le
récipiendaire.
Ce sont deux
hérétiques,
Roger Cornu et
Jacky Réault qui
séparément
prirent
l'initiative de
l'éditer.
Triple écarts ?
Écarts au modèle
Écarts au réel
Écart à
soi-même ?
Et
pourtant qu'elle
fidélité au
prisme théorique
ou idéologique
qui unifie
systématiquement
les ouvrages
sociologiques de
Michel Verret
(et qui se
condensent dans
une des ultimes
expressions du
maître,
l'interview de
2005 à A Madec,
pour Vacarmes) ,
à plusieurs
lourds écarts
près. Le premier
est peut-être le
plus étonnant,
si le titre de
l'article est
mimé des titres
verrétiens sa
littéralité est
empruntée, et
c'est pour nous
un vrai mystère,
au plus farouche
ennemi de son
laboratoire le
Lersco puis le
Lestamp, un des
auteurs de la
scission qui fut
menée avec une
véritable
sauvagerie,
jusqu'à la
tentative
d'épuration
totale après le
décès de JPM.
Qui plus est
c'est à lui
qu'est adressée
la première note
de référence. Il
est vrai que JPM
avait demandé en
vain sa propre
adhésion au
laboratoire
concurrent ( Le
Cens) et subi
l'humiliation du
véto de cette
même personne.
Ultime gage mais
donné à qui au
Cens à JNR ou à
Verret ou au
Cens sur ordre
de Verret ?
Le second écart
par rapport à
l'œuvre modèle
du maître est
qu'il n'est pas
du tout question
dans l'article
de JPM, de
la
culture - un
interdit ou
plutôt un
impossible -, le
dernier et le
plus conceptuel,
quasi
philosophique
ouvrage de la
trilogie
verretienne et
qu'il résume
dans ses
postulats
binaires finaux,
du haut et du
bas et d'une
"culture
prolétaire"
autonomisable,
-pourquoi pas
?-, mais
scandaleusement
tirée vers la
pègre
sous-prolétarienne,
comme expression
de la première,
voire de la
troisième
"figure"
ouvrière (Où
va la culture
ouvrière
française ?
o. c.) . S'il
intègre un peu
plus, ce qui
était resté plus
discret chez le
modèle, un
propos sur des
syndicats et de
la politique,
c'est dans des
bornes si
étroites et
entendues qui ne
mettent pas en
cause les
anciens
postulats
séculaires d'un
lien organique
entre classe
ouvrière et
seulement
certaines
organisations se
réclamant d'une
labellisation
d'un autre âge.
Et pourtant le
politique
(enseigné et
édité) avait été
la part
personnelle
sinon exclusive
de J P Molinari
dans
l'organisation
du travail du
Lersco quoique
sa thèse ne la
traite que par
un biais
finalisé très
induit par son
directeur, l'adhésion
ouvrière au
communisme,
unique boussole
légitime de "la
classe",
unique dirigeant
absolu de ses
"luttes.
Mais ce qui
reste malgré
tout d'actions
ouvrières
identifiables
comme telles et
qu'il évoque ce
qui ne signifie
pas actions
de classes est a
priori
disqualifié ou
traité en
survivances
dégradées.
Pas de
classes sans
rapport à l'État
(nation) et
sans le maintien
d'une centralité
problématique
dans l'ensemble
sociétal, -ce
fut le courage
d'Emmanuel Todd
de le rappeler
avant et après
le grand
mouvement de
réveil national
et social de
l'automne
2005-, et pas de
classes
désormais sans
rapport au
centre
(politique) du
monde et donc
désormais
mécaniquement
subordonné à la
défense des
peuples contre
leur
condamnation à
mort, ce dont
nous traitons
ailleurs : les
rapports sociaux
de la
mondialisation
font du côté des
résistances
intervenir non
des classes mais
des peuples,
dans toutes
leurs modalités
d'existence. La
présence
ouvrière
effective, pour
autant qu'elle
soit
politiquement et
socialement
isolable
(l'usine
résistante aux
délocalisations
et aux
licenciements
boursiers,
ne se réduit pas
aux ouvriers),
se situe
éventuellement
bien ailleurs,
et décidément
plus dans des
tissus
populaires et
territorialisés,
ou des complexes
salariés, et
évidemment au
sein de
vouloir-vivre
nationaux, que
dans les
organisations
patentées
survivantes de
l'époque
classique du
mouvement
ouvrier, qui au
mieux suivent en
se
désolidarisant
de l'action
directe
politiquement
incorrecte, au
pire feignent
d'unifier les
flammes
convergentes
pour mieux les
éteindre en bloc
(1° semestre de
2009). Là où il
faut la chercher
c'est entre
l'abstentionnisme
(JPM avait
joliment écrit
sur ce point)
actif, si l'on
peut dire, - et
cela est bien vu
- mais rien
n'est dit par
exemple de ce
prodigieux
mouvement ruralo-chasseur
du CPNT, à
dominante
ouvrière mais
invisibilisée
comme rurale
(double
périphérisation
!) Quant au
long vote
(1984-2007)
parfois
relativement
majoritaire pour
le Front
national, quant
aux
asyndicalismes
voire
antisydicalismes
de toute
configuration,
et toute une
diversité des
pratiques
résistantes et
ou révoltées qui
captent au sein
de milieux
complexes, la
grande majorité
de 'la classe"
réduite à la
catégorie
opérationnelle
mais toujours
mêlée à d'autres
catégories, il
sont
radicalement mis
hors propos ; la
réalité
s'avérant en
l'occurrence
selon une
expression
hégélianisante
éminemment
significative de
l'oligarchisme
théorique du
maître,
inadéquate à son
concept. Un
titre de JPM
manifestement
d'évidence on
oserait presque
avancer, une
nostalgie
bolchevique,
celle de la
(vieille) Garde.
C'est là que
l'illusion est
la plus
déréaliste
évidemment,
jusque dans le
contenu du
paragraphe. De
vieille garde
qui ne saurait
être que celle
"du prolétariat
organisé en
classe
politiquement
dirigeante", il
n'y a plus
trace. Pas même
dans les restes
de verbalisme
trotskyste. Que
l'essentiel des
mobilisations
privatives ou
collectives des
ouvriers réels,
dans leurs
formes de vie,
leur travail,
leur
associativité
nouvelle ayant
déserté les
partis et
presque les
syndicats, se
situe dans des
complexes
populaires
spatialisés dont
la culture
unifiante de
temps long
constitue le
principe
unificateur et
la référence
anthropologique,
dans les mondes
ruraux et
périurbains,
tout cela
n'entre pas dans
les grilles de
La classe
réduite à la
CSP. Cette mise
entre parenthèse
de toute cette
contribution à
l'œuvre du
Lersco que nous
avions
développée et
qu'il avait
largement
butinée (dans
des doubles
parfois
littéraux tel
son article sur
La
prolétarisation
nazairienne pour
les Cahiers de
l'OCSC) jusque
dans sa thèse,
se trouve ici
comme frappé
d'interdit.
Ce miroir tardif
trop ou pas
assez fidèle -
mais à quoi ?-
n'aurait-il pas
été finalement
mal venu ? Dans
le texte de La
Dispute ne
conclut-il pas,
se référant à MV
dans une ultime
et ahurissante
chute, et comme
s'il s'agissait
de la découverte
du siècle, que
Les ouvriers
pensent,
expression dont
Michel Verret
se vante d'être
l'auteur.
Dans ce texte
ici édité, ce
n'est d'évidence
pas de cette
illumination
ultime mais
surtout
grotesque, qu'il
s'agit, mais,
pour reprendre
un des vocables
classiques du
premier Lersco,
d'une partie des
seules
"conditions
matérielles
d'existence", et
des modes
canoniques de
représentation,
approchés à vrai
dire presque
exclusivement
par le
chiffre -
cette obsession
des sciences
sociales
bureaucratiques
comme des
demandes
médiatiques -
d'État et de
bureau. La
formule par
ailleurs assez
opaque et par
trop peu
interrogée du
temps même du
Lersco, ne vaut
d'ailleurs que
sous réserve de
ne pas trop
s'inquiéter sur
ce qui en
constitue, à nos
yeux, à égalité
avec le
travail
(et désormais
scindé par les
politiques de la
mondialisation),
l'emploi, le
premier socle,
les formes de
vie. La famille
ayant été
sous-traitée par
MV lui-même,
bien loin des
problématiques
ouvrières et du
temps même du
Lersco, à un
vicomte mondain,
et n'ayant été
réintroduite que
par nos travaux
sur les formes
de vie
territorialisées
irréductibles à
l'idéologie
classiste,
on comprendra,
non sans
étonnement
cependant,
l'absence dans
le texte de JPM
de tout ce que
sous-tendent
les formes de
vie : lignages,
alliances,
parentés,
communautés,
familles,
groupes
domestiques,
vicinalités,
territorialisations,
réseaux, en un
mot la vie dans
tous ses états.
La classe
perpétuée par
JPM dans le
désir de
MV n'est-elle
pas
nécessairement
sans famille.
De Marx à Hector
Malot ! C'est
que dans cette
empoisonnante réalité
qui prétend
résister à l'objet
construit, il
n'y quasi
empiriquement
plus de "famille
ouvrière» :
seulement des
unités milieux,
de facto
populaires
(concept
repoussé),
ouvrier-employée,
ouvrière-paysan,
ouvrier-institutrice
etc. ; encore ne
tient on pas
compte ici de la
présence
d'étudiants à
avenirs assez
divers dans
grand nombre de
ces familles.
Exit
donc cette
irritante
réalité. En
revanche, et à
l'actif de
JPM, il
s'abstient de
suivre, sauf
quelques
normales marques
de désarroi, le
contre-transfert
Verretien passé
aux aveux. Il
laisse au maître
le propos commun
avec la
post-intelligentsia
parisienne, non
seulement sur la
classe fantôme,
coupable
d'inconsistance
historique mais
sur ces ouvriers
qui pensent mal,
seraient devenue
à leurs yeux,
racistes. Il
est vrai que JPM
ne pouvait
radicalement pas
s'envelopper
dans le manteau
chic de la
bien-pensance
intello-urbaine
vertueuse et
dénonciatrice;
il connaissait,
lui
existentiellement et
avait pratiqué
beaucoup
d'ouvriers
réels, - latents
dans ce texte,
même si leur
présence réelle
est refoulée -
et pouvait en
parler
autrement que ce
qu'on pouvait en
apprendre - dans
les livres de
référence de MV
eux-mêmes
exclusivement
livresques,
faits d'ouvrages
de sciences
sociales, du
corpus massif de
la statistique
d'État collectée
pour lui par
Paul Nugues et
Joseph Creusen,
et nourris des
écrits
conventionnels
de partis
communistes et
des œuvres
culturelles de
l'ex
socialisme réel.
Cet ensemble à
l'exclusion de
tout terrain
vivant,
constituait le
seul viatique de
chercheur de
Michel Verret,
auquel il faut
ajouter, et à
son honneur, une
culture
littéraire
revendiquée
comme composante
légitime de
l'écriture
sociologique.
Heureusement
pour lui et pour
nous tous, à
l'époque où il
écrivait, on ne
faisait pas - y
compris à son
instigation avec
d'autres
mandarins
lyncheurs et
jaloux -, des
pétitions de
chasse aux
sorcières contre
les sociologues
décrétés "sans
terrain" ou,
pire, trop
pourvus d'idées
(et baptisés de
ce fait
essayistes)
Cela se passe un
peu plus tard, à
l'heure d'une
professionnalisation,
- selon
l'expression
vaguement
ridicule de bon
nombre des chefs
de clan de
l'actuelle
discipline
instituée, - qui
réduit la
connaissance
sociale permise
à la
reproduction des
dogmatiques
closes et à la
fétichisation de
la
méthodologie
cette grammaire
du vide.
Entre
littéralité
fidélité, voire
prise de liberté
entre l'auteur,
le commanditaire
et la vulgate du
Lersco de 1972,
on laisse chacun
s'armer à son
gré d'exégèses
en spirales,
pour nous borner
à quelques
remarques :
Après l'exergue
de l'inévitable
citation de MV,
où l'on ne
bizarrement lit
déjà que
déréliction pour
une unité
sociale dont la
nomination et
l'agrégation,
tout au long du
texte postule
pourtant sans
fin le
présupposé du
lien, le titre
renvoie quasi
mécaniquement à
des articles de
M Verret :
Où en est la
culture ouvrière
aujourd'hui ?,
paru dans
Sociologie du
travail, 1989-1,
comme à trois
autres titres
utilisant le
même trope d'une
interrogation de
finalité en
mouvement
excluant toute
problématisation
sur son
transhistorique
"objet".
Il n'est
jusqu'aux
formules même de
la conclusion
qui ne renvoient
mimétiquement à
des œuvres
anciennes de MV,
telle la forme
rhétorique
largement factice
de l'appel au
lecteur. Quand
aux nombres de
références au
maître on en
abandonne le
comptage et le
chiffre au
lecteur
décidément
professionnalisé
ou jouant à
l'être.
En deçà d'un
fétichisme de la
CSP PCS 6,
..le leurre objectiviste
de la
classe ouvrière en soi ?
|
Quant au fond qu'est-ce que le
lecteur actuel peut y trouver.
Beaucoup. Il présente sur les
données accessibles les plus
récentes alors, cet idéal d'une
somme de sociographie
statistique et bibliographique
déjà mise en en œuvre de façon
impressionnante et de surcroît
en très singulière stylisation
(chercher sinon réussir, à bien
écrire est devenu un autre
interdit de notre époque
sociologique et d'abord des
petits clans qui monopolisent
l'édition patentée), dans le
triptyque de l'Ouvrier
français complété
Chevilles ouvrières. Tout
cela n'est encore possible au
troisième millénaire que parce
que la distribution s'effectue,
on l'a noté plus haut, dans
l'évidence que la classe en
soi, définie par la position
dans les seuls rapports
sociaux de production, du
Marx hégélianisant dont on
aurait oublié le pour soi,
est supposé valider ; ce qui
n'apparaîtra à tout lecteur
exigeant ni marxiste ni même
marxien. On peut exprimer ce
parti pris de façon finalement
très simple et familière
puisque banalisée par l'école
depuis un demi siècle. C'est
celui de la fiabilité théorique
maintenue de l'agrégat d'État et
de manuels scolaires, - la bible
des dites SES (Sciences
économiques et sociales)
pourrait-on dire, - et
finalement peu modifié depuis
1954 quand fut enfin éclaircie
la polarisation à son
compte/salarié) et 1962
(quand la qualification
ouvrière est enfin définie)
qu'est la catégorie dite
socioprofessionnelle qui tend à
devenir, malgré certaines
commodités descriptives de
certaines pratiques, le
pont-aux-ânes de la sociologie
qui ne pense plus ce qui
pourrait devenir - si un sursaut
ne se décide pas vite alors que
ce sont les vagues épuratrices
qui resurgissent sans fin-, une
pure et simple tautologie.
Il est utile ici de repérer
particulièrement une double
fonction, étatique et sociétale
d'une part, et
statistique d'autre part, dans
l'usage routinisé de la CSP
(1954-1982), devenue (pourquoi
cette inversion des positions de
Profession et de catégorie?) la
PCS , depuis 1982 année où les
contremaîtres furent arrachés à
l'ensemble ouvrier en même temps
qu'étaient abolie en son sein la
perception des manœuvres, -par
euphémisation ?- et de
l'ensemble des mineurs marins et
pêcheurs, comme par anticipation
d'une épuration européenne,
celle là bien réelle, à l'égard
de secteurs entiers de
l'économie nationale.. Elle
constitue un des plus
spectaculaires fétiches
scolaires et médiatiques,
momifié donnant toute réponse
avant d'avoir formulé la
moindre question. La réduire à
la modestie serait de première
urgence pour former des
sociologues restant affamés de
connaître les véritables
processus (plutôt que
structures) opérants de la
société actuelle. Que nous
occulte telle, pour aller au
plus lourdement problématique au
sein du réel sinon l'historicité
continue des sociétés dans la
mondialisation, le
positionnement dans les
espaces-temps du monde
(relativement) mondialisé,
les variations transversales aux
classes des effets de
l'accumulation du capital (prolétarisation),
les mobilisations, privatives
individuelles ou collectives,
séparées ou politiques, ancrées
pour l'essentiel dans des tissus
populaires singularisés.
La première fonction, étatique
et sociétale de cette
nomenclature, évidemment
toujours précieuse, renvoie
(renvoyait) aux normalisations
(contractuelles et étatiques) de
la société salariale (M.
Aglietta, A Brender Calmann-Lévy
1984) et à ce qui en subsiste
après vingt cinq ans de
consensus politiques des grands
partis libéralisés pour la
réduire. La seconde fonction,
statistique, (compter des grands
nombres dans des nomenclatures
univoques pour les rendre
appropriables par la pensée et
pour les grandes fonctions
sociétales), est à la fois
plus réaliste et dépourvue de
toute poésie (les grandes
ponctions fiscales ou autres et
les redistributions) et pourtant
plus métaphysique, permettant
l'apparence de la fameuse
requête d'exactitude,
-obsession du maître-
alias le nombre et ses chiffres,
marqueur principal commun aux
postmarxistes et aux bourdivins,
de la science, au sein de
ce qu'ils appellent sans rire,
dans une inlassable incantation,
"la sociologie comme science".
Sous le vocable déjà
anachronique et tendant à un
usage emphatique, de classe
ouvrière mais désormais
réduit à l'en soi qui
constituait la commande de MV,
il ne faut finalement s'attendre
à trouver rien d'autre que l'a
priori nominaliste de la
CSP-PCS6 parlée dans le langage
plus technique que savant d'un
vague marxisme administratif,
très analogue à celui qui
régnait si lourdement dans les
ainsi nommés pays de l'ex
"socialisme réel". Cette classe
ouvrière réduite aux acquêts
théoriques comme on l'a déjà
évoqué du marxisme stalinien
plus ou moins pérenne et à ceux
de feu la social-démocratie du
20° siècle, a cependant de quoi
étonner un historien ou
simplement un citoyen lambda
quelque peu réflexif mais
également un lecteur de Marx,
cet inventeur impénitent malgré
sa tentation de l'immobilisation
de la théorie pour lui donner
les allures d'une science
instituée. Nikos Poulantzas,
reprenant une analytique devenue
classique, qualifiait justement
d'économisme ce
réductionnisme théorique ; c'est
fort juste mais nous semble-t-il
insuffisant, en tout cas pour
son usage stalinien et post
stalinien, comme dans la forme
abâtardie, scolaire et pourtant
fanatique qu'en diffusent les
affiliés du bourdivinisme
; quant à la
social-démocratie elle
justifiait son réformisme et son
recul devant la révolution telle
que profilée par les léninistes,
puisqu'il suffisait finalement
de laisser faire le processus
réel qui était supposé, à
l'époque des croyances
progressistes, aller dans le bon
sens (de l'histoire), celui
de la socialisation des moyens
de production. Mais dans
un cadre totalitaire qu'il soit
théorique et/ou étatique, on ne
peut éviter d'interroger les
fonctions de cette réduction de
l'identité ouvrière au seul
travail pensé d'ailleurs de
façon réductrice comme condition
matérielle de l'existence mais à
partir d'indicateurs
désincarnés. Cet économisme
fonde la légitimité de
l'objectivation, ce fétiche
verbal de la sociologie ossifiée
dont la principale fonction est
de donner à celui qui parle les
autres hommes à leur place, la
possibilité de les considérer
réellement comme des choses ;
la formule, espérons
le, purement posturale de
Durkheim mutant en jugement de
réalité et en légitimité de tous
les terrorismes théoriques et
politiques. Procès sans sujet
écrivit à propos de l'histoire
humaine Louis Althusser, le
maître du maître. De fait nul
n'a mieux que ce philosophe
conséquent, exprimé, dans
l'innocence, il est vrai, de sa
propre aliénation mentale, la
vérité latente des présupposés
d'une des errances
principales de la sociologie
relais en l'occurrence du
marxisme stalinisé. L'économisme
intégré à un pouvoir ou
simplement à une pensée
totalitaire est un des modes
pseudo scientifiques principaux
de dénier l'existence des
sujets ce tabou désormais de
la connaissance sociologique,
qu'ils soient individus
personnalisés ou sujets de
l'histoire.
Dans les cadres de
l'économisme et/ou d'ailleurs du
sociologisme qui lui doit
beaucoup, il n'y a strictement
rien d'inattendu dans l'exposé
dit scientifique, -et un
grand nombre des thèses
actuelles n'ont de ce point de
vue désormais de thèses que le
nom- tout est déjà donné dans la
nomenclature éternisée et dans
la clôture du champ. La
science véritable n'est-elle
pas, a contrario, une
frontière mobile et inquiète à
jamais questionnant, en
l'occurrence tout ce qui est
désormais à peu près éradiqué
des institutions disciplinaires
de la sociologie d'État. L'heure
de la classe pour soi ne
saurait jamais sonner pour les
pensées de la reproduction,
rebelles à toute singularité
spontanée du mouvement social
échappant à l'avant-garde
organisée porteuse de la
théorie. Qu'importe que
celle-ci (le marxisme d'État)
ait sombré depuis longtemps avec
son État fantoche et meurtrier,
on trouvera encore aujourd'hui
des prophètes se pensant comme
vigies dans les millénaires, ou
comme temples de la vraie gnose,
qui continuent de penser écrire
et agir comme s'ils en étaient
les sanctuaires quasi vivants.
Le travail de JPM, pour
ce qui le concerne semble
transmettre, pour qui veut en
faire une lecture symptômale,
plus d'inquiétude que de
certitude
Probe ouvrier de la
sociologie ouvrière
- et nous disons cela sans
ironie- ...du Lersco, d'avant du
Lestamp, il ne peut être réduit
au propos strictement obligé
qu'il était supposé tenir dans
la gageure impossible d'exprimer
à la fois la déréliction
historique de la classe ouvrière
et sa pérennité conceptuelle,
projet délirant et réalisation
hétéronome qui plus est sans la
gratification finale ; on a vu
dans quelle contradiction
l'avait ligoté la commande de M.
Verret et dans cette nécessité
insurmontable il fait ce qu'il
peut faire de mieux, son travail
de lecteur insatiable,
d'ordonnateur, de synthétiseur
pédagogique et de référencement
en un mot son travail de
professeur, mais pas de
chercheur, (et on ne reviendra
pas sur ce qui rendait cela
impossible) ; mais ce travail là
il le fait parfaitement, et on
n'ira pas jusqu'à dire que c'est
devenue dans la profession une
rareté. Il entre souverainement
dans l’ouvrage par le mot
Ouvrier, dont il propose
rapidement la fameuse
définition distinctive (?) -
étonnante précision, de quoi que
fallait-il donc se distinguer ?-
qui constitue le noyau dur,
quasiment la pierre noire de
l'objectivisme verretien, ce
dont à ses yeux et dans doute
son œuvre tout découle, le
bas comme la classe,
la culture, la conscience,
jamais nommée puisque supposée
résultante de la position
dans les rapports de production
(classe en soi) éclairée par la
juste théorie des intellectuels
marxistes, ou sinon invalide, et
en tout cas certainement pas, la
personne comme forme
individuelle humanisée
d'existence. Cette définition
distinctive trouve jusqu'à
nos jours les données chiffrées
plus ou moins cycliquement -
L'Europe impose son nivellement
productiviste de la
connaissance- abondées et
actualisées par les
administrations du comptage
d'État et utilisées par l'école
les media et le quasi sciences
sociales, comme catégories
transcendantales univoques. A
peu près tout ce qui se
distribue dans ces taxinomies
(?) se retrouve dans ce
texte, ainsi que ce qui peut
s'indexer cavalièrement comme
certaines données politiques,
mais rien d'autre. Chercher
ailleurs, en l'occurrence hors
de l'État, d’autres pratiques de
la vie, n'était pas au
programme, faute de temps ou par
ce que la définition
distinctive ne permettait
pas d'y collecter des données
homogénéisables.
Cet essai entérine donc
apparemment sans mégoter,
ce qui, de ces ouvriers dont
l'agrégat est dit "classe
ouvrière", peut-être pensé quand
même dans ce vocable organique à
vocation totalisante et qui
garde de ce fait une fécondité
virtuelle au moins marginale,
même s'il fonctionne ici, sans
cultures et sans milieux
concrets donc complexes,
économiquement, politiquement en
un mot socialement impurs,
de vie... Était-ce la stricte
commande de Verret qui ne
voulait pérenniser que
l'univoque transparence vide
économiste, de la classe en
soi, tout le reste
irréductible à la théorie, ne
devait pas encombrer le propos
sinon pour dénoncer, ce qui est
très peu fait. Est-ce simplement
un état intermédiaire ?
Lorsqu'il nous distribua son
papier rien d'indiqua dans ses
paroles, pas plus que dans con
texte qu'il ne le considérait
pas comme achevé sous
éventuelles réserves de
corrections mineures, ou
majeures, sans doutes espérées
de M. Verret et qui ne seraient
pas venues malgré une ultime
entrevue entre les deux hommes
au cours de l'été peu de temps
avant son passage à l'acte. Ce
qui nous est donné et ce nous
diffusons se présente à
l'encontre de son titre hors
sujet comme une morphologie
sociale, chère à MV
admirateur de Maurice Halbwachs,
- le plus "matérialiste" des
durkheimiens -, arrimée à un
économisme tempéré cependant par
l'idée plus historique de
la déréliction d'une histoire
fourvoyée échappant à ses
penseurs patentés, qui dans la
mer tempétueuse de la
mondialisation se chercheraient
quelque navire transhistorique
dans la nostalgie de l'idée d'un
port sinon d'une destination
alors que son concept seul
n'indique plus, comme par
surcroît, avec le premier
prolétariat et la mythographie
du Manifeste communiste, une
mission. Le mot plus modeste,
mais ce n'est pas une critique,
de "redéploiement" avancé dans
l'article confié parallèlement à
La Dispute (mais quand et par
qui ?) indexé (malgré lui ?) à
la fantasmagorie d'un (éternel)
retour des (mêmes)
classes, ne suffit pas pour
trancher sur le fond de sa
pensée en termes plus
prospectifs. En tout cas on
dispose avec cet essai si
densément chiffré, d'un travail
systématique de collecte
critique raisonnée et
synthétisée selon ces prémisses
et d'un savant instrument de
transmission de connaissances
qui affronte, mais sans vraiment
le briser, ce qui est devenu
l'interdit des totalisations
concrètes, problématique
anthropologique, ethnographique
et historique. L'utopie
théorique nécessaire mais
toujours à réinterroger d'une
totalisation possible de
l'expérience sociale humaine,
constitua pour une partie de
ceux qui furent mêlés à
l'aventure initiale, dont nous
sommes, le meilleur de
l'ambition trop vite dite
sociologique du Lersco ;
sous réserve cependant de ne pas
oublier que cette vision
concrète et ouverte de la
connaissance des sociétés était
dès l'origine, écartelée entre
un sociologisme qui détruisait
l'ambition gnoséologique
radicale de Marx, et un marxisme
qui idéologisait plus ou moins
radicalement les résultats
anticipés.
Les inventions et les
diversités des "ouvriers
recomposés" - à l'instar des
familles.- en milieux populaires
ont besoin de sociologues qui ne
soient pas plus qu'eux
nostalgiques de feue "La classe"
mais qui aient la décence de ne
pas les disqualifier parce
qu'ils n'ont plus rien à voir
avec les fantasmes d’une classe
éternisée par certains bien
vivants idéologues, se disant
sociologues.
A supposer que ce vocable
ait encore un sens en
dehors de mobilisations
partielles et situées,
la classe ouvrière nous a
semblé dans ce remake très
professionnel, doublement
absente : absente et
méta-absente ; pourtant
nous pensons que le mode de
pensée en acte refusant la
chirurgie mortifère des
champs homogènes, et les
disciplines découpées en
tiroirs, et qui tentent
d'indexer pour une heuristique
ouverte sous réserve de
réfutation, des pratiques
hétérogènes les unes aux autres
sans préjuger de causalités a
priori, restait et reste
nécessaire et fécond, après la
disparition, en tout cas dans la
plupart des sociétés du monde,
des grandes entités purement
ouvrières, nationales ou
internationales hypostasiées à
partir d'une vision chirurgicale
des rapports de production
opérationnalisés par le lien
entre des chiffres et une
abstraction.. Pour rester dans
le cadre français d'après le
tournant de 1984, on comprend le
refuge des pensées
bureaucratiquement classistes
dans la classe en soi de
la statistique économique.
Comment en effet intégrer
dans un néo marxisme de la
chaire que les deux votes les
plus ouvriers de la
politique, sont le CPNT des
ruraux et le Front National des
banlieues et de la France de la
grande industrie du 20° siècle,
des périphérisés en
quelque sorte, à l'instar de la
structure mondiale, et le
silence embarrassé des
sociologues en rajoute une
lourde couche dans le
confinement de périphéries !
Comment inscrire l'attachement
culturel et politique des mondes
ouvriers les moins déstructurés
(la majorité) aux fondamentaux
anthropologiques des cultures
populaires et comment le rendre
compatible avec l'effort
privatif pour la promotion
scolaire substitué à une culture
usinière qui fut la matrice à la
fois réelle et imaginaire d'une
unité ouvrière perdue, pour
autant qu'elle ait jamais
majoritairement existé ? Comment
décrire l'impur mélange des
classes, qui s'évaporent en
simples classements, et des
cultures dans le couple
"ouvrier" modal, c'est à dire
socialement hétérogène, homme
ouvrier, conjointe employée,
institutrice, agricultrice etc.
et encore nombreuse dans le
Nord-est prolétarien, "au foyer"
? Comment rendre compte des
solidarités sociales et
culturelles à géométries
variables d'une diversité
ouvrière liée à la géographie
anthropologique et historique
des écosystèmes sociaux de
reproduction (J Réault
Nantes Lersco, 1989), de
la polarisation assez radicale
des villes et des campagnes
toujours agissante quoique
complexifiée par la
rurbanisation, comment abolir
l'écartèlement des ex cultures
ouvrières entre un néo
collectivisme assistantiel et un
individualisme moderne cherchant
dans l'école une promotion
privée ? Comment oser, contre
l'injonction néo-intellectuelle
de l'identité française
négative, nommer l'attachement
ouvrier, non à un mondialisme
abstrait ou à un européisme que
les post (?) marxistes
prétendent héritiers de
l'internationalisme, mais à une
souveraineté nationale dont
pourtant Emmanuel Todd a si
brillamment montré dans sa
conférence de 1994 à la
Fondation Saint-Simon ( Aux
origines du malaise politique
français) qu'elle était
organiquement solidaire de ce
qui pouvait éventuellement se
pérenniser et resurgir (lors
d'évènements historiques
singuliers non déductibles et
non dans le ciel des éternités
marxistes), comme plus ou moins
fugace et partielle
conscience de classe. Et la
crise immense qui vient de
surgir (2007-8) comme étant à la
fois celle de la mondialisation
et de la dé mondialisation
pourrait encore de ce point de
vue réserver quelques surprises.
L'impossible
évitement des espaces-temps des
sociétés de la mondialisation.
La mondialisation telle que nous
l'avons analysée au sein du
Lestamp, (J. Réault, Les
sociétés de la mondialisation,
Appel à communiquer et
"Pour un lieu commun des
sciences sociales", introduction
au colloque
Les sociétés de la
mondialisation,
Nantes, Edition Lestamp juillet
2005) d'une part comme processus
global et comme politique
centrale étatsunienne jouant
comme prédation des sociétés des
classes et modalement de tous
collectifs modernes associatifs
au profit d'un retour des
communautés primitives, et
d'autre part comme rapport
social dans lequel les sociétés
contradictoirement menacées,
restent plus ou moins et
toujours contradictoirement des
sujets dans et
contre elle, la
mondialisation donc est
étrangement abstraite sinon
absente de cet texte écrit un
quart de siècle après son
imposition centrale à toute une
planète. Est-ce parce que MV a
muté son l'internationalisme
verbal de l'ère soviétique en
euromondialisme spécifique des
néo-bourgeoisies bobos
des grandes villes, ce qui est
effectif mais pas forcément
déterminant ici ? Est-ce plus
profondément parce que la prise
en compte des nouveaux rapports
sociaux que la mondialisation
structure mettrait en
pièce toute tentative de faire
survivre l'ancien système de
classes indépendamment et
corollairement à la dé
subjectivation idéologique et
culturelle, subie et volontaire,
de la classe ouvrière par les
ouvriers eux-mêmes au sein de
leur expérience bien réelle de
ces processus ? Et pourtant s'il
y avait en 2003, et il y a
toujours, un héritage à
sauvegarder des apports marxiens
et de l'expérience historique
ouvrière des rapports sociaux ce
serait dans la recherche des
nouveaux fronts dans de nouveaux
rapports sociaux induits par les
processus et la politique
mondialisante. Ces fronts de
rapports contradictoires
virtuellement champs de
mobilisations de forces se
situent d'abord - et chacun peut
en faire le constat empirique -
entre sociétés-nations (voire
ensemble civilisationnels?) et
prétention violente de
domination centrale, entre
peuples dans toutes
leurs modalités et
territorialisations et appareils
centraux visant à les néantiser
inséparablement comme
peuples sociaux
affrontant le capital
mondialisé, et comme
peuples nationaux,
indispensables unités de
résistance pour qu'en ce
processus et face à cette
politique de dédifférenciation
régressive des sociétés en unité
biologique de marché, l’histoire
humaine soit encore possible car
peuplée de sujets.
Souverains.
JP M semble avoir au, delà des
réponses pondérées à apporter
aux deux questions ici posées,
intégré l'interdit, passé depuis
1984 par les gauches
de gouvernement libéralisées
dépopularisées et de facto
mondialisées, de considérer
encore la souveraineté des
peuples sans laquelle, il est
parfaitement oiseux de chercher
des subjectivations collectives
de classes qui requièrent - ce
que la classe en soi de Verret
avait par avance neutralisé -
l'instance politique de l'État
nation, pour se présenter à la
fois comme consciences et comme
luttes. Les ouvriers en France
qui avaient concomitamment
perdu,- avec la financiarisation
du capital relayée par leurs
propres représentants dans leur
État de société salariale leur
pouvoir de négociation du
salaire pour eux et pour le
salariat, -leurs appareils de
combats organisés détruits
dans et par la
désindustrialisation des années
80, l'appui mythifié mais
précieux de l'intelligentsia
d'après 1984 (Vive la crise ! de
Libération, Y Montand etc.), et
seulement in fine leur propre
auto-identification comme acteur épico-historique autonome et/ou
indexé à l'URSS; ont
cependant perpétué leur
existence sociale dans les
nouvelles unités composites
revitalisées et métamorphosées à
la fois par la mondialisation.
Loin de se dissoudre dans la
légitime privatisation de leur
genre de vie ils perdurent avec
des effets pertinents dans des
unités populaires, à la fois
nationales - d'où la captation
conséquente de leurs votes par
ceux qui osaient encore se
revendiquer du peuple souverain,
fussent-ils portés par J M Le
Pen, et par ceux qui se
présentaient comme résistance
populaire, la plus précieuse et
charnelle, territorialisée au
niveau des formes de vie et
d'habiter réelles, comme
le mouvement rural emblématisée
par le révolutionnaire (du
printemps 1789) droit de la
chasse dont le vote fut souvent le plus
ouvrier pendant le dernier quart
de siècle. Cette double myopie à
l'égard de l'inscription socio
spatiale des rapports sociaux
qui n'est pas neuve mais dont
l'intensité et la centralité
structurante est spécifique de
la mondialisation, se résout
finalement en une seule. En deçà
de l'analyse qui reste en
procès, des restructurations
sociales dans et contre la
mondialisation, il y a le
refoulement, actif chez MV qui
le connaissait bien, plus latent
et mimétique chez JPM, de
l'apport braudélien que nous
avions développé au sein du
Lersco.
Depuis
les premières
économies-mondes,
le
capitalisme historique
se présente comme un emboitement
d'espaces temps
multiples dans
Un
espace temps à prétention
totale, en procès à la fois
résistible constant et
dépassable (recentrages), celui
du
temps du
monde.
Dans la mondialisation stricto
sensu (telle qu'elle s'induit
comme nouvelle forme
d'adaptation (Guy Bois)
à la crise survenue après1974,
avec la convergence d'un processus
devenu planétaire et d'un centre
de violence sans contrepoids
systémique, la résultante tend à
devenir non seulement totale
mais totalitaire de par la
désubstantialisation de la
démocratie
corollaire de la prédation
(relative) des nations et
(donc ?) des classes. S'il y a
encore des logiques
de
classes
à
invoquer pour l'intelligibilité
des sociétés ; encore faut-il les
rapporter à cette structure
globalisante et en interférence
avec le rapport social principal
que constitue le rapport des
peuples (,ou d'ensemble
identitaristes fourvoyés dans
l'ethno-culturalisme,) au processus et à la
domination centrale comme procès
ou comme appareil de pouvoir revendiqué.
Ce ne sont plus des bourgeoisies
nationales qu'affrontent les
peuples travailleurs (unités des
peuples nationaux et des
exploités de la financiarisation
dont les ouvriers ne sont qu'une
des composantes, minoritaires
dans les sociétés
péricentrales). A plus forte
raison, ce ne sont pas les
grotesques
classes
sup
(en réalité le salariat le plus
expert plus ou moins
artificiellement séparé
statutairement du reste et en
voie de prolétarisation)
recuites par le sociologisme
bureaucratisé et notamment
bourdivin, mais l'hyperbourgeoisie
mondiale profilée par Denis
Duclos,
et ses relais idéologiques,
classes parlantes,
avons-nous formulé en 2004-- restes
bureaucratiques des ex partis,
ex
ouvriers
compris- monopolisant le
discours légitime unique de
scène politique culturelle et
médiatique des capitales et
grandes villes de l'archipel
de la mondialisation,
l'industrie, le peuple, les
ouvriers les familles du
salariat expert, se trouvant en
de multiples modes
périphérisés
dans les espaces opacisés
et occultés par les media, du
périurbain, du rurbain et du
rural
L'orthodoxie
poststalinienne où doit régresser
JPM pour remplir son contrat
avec l'intellectuel qui en fut
probablement l'idéaltype doublé
d'un croyant, refoule ces
réalités dont il n'a certes pas
l'intelligibilité claire mais
dont il a l'expérience partielle
pratique et théorique. Elle le
met dans l'impossibilité de
penser même, (ce qui serait la
continuation féconde d'une
sociologie
ouvrière non idéologisée qui
reste une des ambitions du
Lestamp, dans le fil des œuvres
"ouvrières" notamment de Joëlle
Deniot et de Jacky Réault voire
même par son matériau empirique
spatialisé sur des enquêtes
inédites sur l'adhésion
ouvrière au communisme, de J
P Molinari lui-même, une
sociologie contemporaine des
mondes ouvriers réels dans leurs
communalisations populaires
spatialisés où l'on se soucie
désormais comme d'une guigne de
l'ex classe ouvrière,
concept d’identification
historique qui a été dès le
début des années 80, et sous le
règne de ses ultimes
représentants (le PC et le
PS de 1981, en 1984 c’est
terminé ?) , comme frappé de
péremption
Pourtant JPM a introduit
dans son article une
complexification de la CSP 6,
introduite en 1982 à l'orée même
de la mondialisation, qui aurait
pu ouvrir la voie à cette
analyse concrète socio-spatiale
des rapports sociaux dans la
mondialisation comme elle avait
été éprouvée dans l'analyse plus
générale que nous avons menée
sur le temps long des degrés
et formes de prolétarisation.
Il s'agit de la distinction
entre ouvriers de travail
artisanal et ouvriers de
travail industriel,
dont nous avions montré en
1989 la pertinence analytique
Au delà du marquage productif
c'est le maintien, de tonalité
très braudélienne, de modes de
production hétérogènes sous la
dominante capitaliste
financiarisée, que pouvaient
indiquer cette partition à forte
composante spatiale de surcroît
donc virtuellement supports de
communalités populaires
différenciées, urbaines,
rurbaines, rurales et évidemment
de formes de prolétarisation,
le seul concept pouvant perdurer
sur le temps long des
métamorphoses du capitalisme.
Nous les avions systématiquement
éprouvées dans ce travail de
1989, sur les formes de vies
ouvrières dans les écosystèmes
sociaux (populaires donc) de
reproduction. Tous les pluriels
y étaient déjà de même que la
problématique dominante de la
mondialisation dans les rapports
sociaux affrontés par les
ouvriers était déjà
explicitement affirmée dans
notre Ouvrier de l'Ouest
publiés à la fin et dans le fil
de la dernière recherche à vaste
ambition nationale, de l'ATP
CNRS Observation du
changement social et culturel,
Jacques Lautmann, Henri Mendras.
La régression sur ce point
marxiste orthodoxe,
de la pensée tardive de M Verret
a éloigné JPM de cet héritage
qu'il connaissait
comme participant tardif mais
réel à l'ATP et parce que les
œuvres citées avaient été
conçues en radicale autonomie
personnelle certes mais dans le
cadre de notre commune
appartenance au Lersco. Ainsi
l'idéologie économiste
stalinienne - où l'expérience
humaine réduite à la
chosification des forces
productives - (ou social
démocrate, sur ce point assez
proches) l'emporte, et, des deux
indicateurs cruciaux ouvriers de
l'industrie, ouvriers de
l'artisanat, n'est fait qu'un
usage réducteur sous la rubrique
du travail productif alors
qu’ils renvoient à des univers
sociétaux différents, ne
serait-ce que par le lien des
modes de production de la petite
production avec les mondes
ruraux qu’ignore radicalement
JPM.. Ainsi les virtualités
théoriques malgré tout accrues
de la CSP revue PCS de 1982,
sont étouffées dans l'œuf, cuit
et recuit du fossile théorique
de la classe en soi. Si reste
quelque chose à sauver de la
thèse qui fait des ouvriers, (à
intégrer désormais d’une part
dans des ensembles de salariés
requis par la production au sein
des sociétés nationales
affrontant la mondialisation,
d’autre part dans des milieux
socio-spatiaux populaires) ceux
qui affrontent en première ligne
le capital mais dans son
actuelle forme financiarisée,
c'est d'évidence dans ce
contexte qu'il faut les analyser
dans la double médiation des
deux modalités spatiales du
populaire, le territorial
qualifié et le national. Au delà
le concept n'a plus aucun sens
comme l'idée d'un peuple
transnational, une absurdité.
Dans ses limites qui sont celles
de l'économisme mais aussi
de son meilleur corollaire le
goût de la précision
statistique, par sa probité
descriptive y compris
lorsqu'elle gène la théorie
(l'ouvrier du tertiaire ?), par
certaines inquiétudes qui osent
s'y manifester marginalement et
par le souci permanent
d'introduire des successions
datées sinon strictement de
l'histoire, parce que donc
irréductible au vide idéologique
du champ, gardant, ne serait-ce
que dans son nominalisme, la
nostalgie d'une totalité
concrète intelligible, ce texte
pourra faire référence
sociographique et sous réserve
de contextes plus larges,
historique. Son édition sur ce
site du Lestamp Association est
à lire comme un hommage à un
auteur et une personne, que son
institution universitaire,
département et UFR de sociologie
de Nantes, s'avéra incapable de
lui rendre, trop atteinte
qu'elle était déjà, il y a déjà
cinq ans, par le mal
autophagique et épurateur dont
elle ne finit pas de mourir et
qui l'empêche à jamais se donner
le miroir de son inexistence
dans la fête (la célébration en
est une) impossible. Le propos
est hélas généralisable à
beaucoup d'autres sites de la
post-université. Comme l'a
évidemment constaté le lecteur
qui nous aura suivi jusque là
c'est à propos d'une pensée
inquiète donc vivante, qui
méritait et mérite toutes les
joutes de la disputatio
intellectuelle dont JPM fut si
friand et parfois dans une
dureté de parti et d'époque
durant sa vie, que nous avons
esquissé cette exégèse sans
complaisance qu'appelait le
contexte d'une école
intellectuelle survivante dont
l'histoire reste à écrire. Et
c'est dans cet esprit que ce qui
n'a été au début qu'une brève
médiation (y compris sur ce
site) est devenu d'une certaine
façon, comme son objet-sujet
même, un autre
essa.
Il fut un membre actif et parmi
les plus éminents des collectifs
de chercheurs, le Lersco, le
Lestamp EA Université de Nantes,
dont nous procédons, comme
toujours dans les
identifications vivantes, par
héritages et par ruptures. Ceux
qui se prétendent encore
gardiens d'une tradition
théorique plus féconde que ses
pétrifications dogmatiques, en
l'occurrence la pensée de Marx,
- et parmi eux le maître
d'ouvrage même de l'essai de
Jean-Paul Molinari l'inspirateur
adulé de ses postulats-, n'ont
pas cru devoir manifester leur
réception de leur travail
littéralement sous-traité, ni
encore moins le publier. Le
Lestamp association, laboratoire
associatif qui n'a d'autre
ligne théorique que son goût de
la liberté et de la profusion
des idées et sa quête des unités
vivantes contre le côté
mortifère du construit
sociologiste, se devait de
mettre ce texte comme réprouvé
par son inspirateur, à la
disposition butineuse et
critique de tous ceux qui
restent en faim insatiable de
connaître, et même si c'est
(peut-être ?) dans des
catégories antérieures à leur
gestation, les
sociétés
de la mondialisation.
Jacky REAULT
Lestamp-Association (Que faire
de la classe du Lersco ?) Juin
2005. Revu et très largement
augmenté entre le 11 novembre
2008 et février 2009.
Lestamp-Association,
Habiter-PIPS EA de l’Université
de Picardie Jules Verne, sous le
titre Les ouvriers de la
classe au peuple. L'après de
l'émancipation.
Dernières interventions de
lissage formel 2014.
__________________________
Notes
Certaines
des notes
ici fournies constituent de
brefs essais et notamment les
exposés théoriques concernant le
devenir contemporain et les
limites d'une heuristique de
classe ainsi que la genèse du
concept historique organique de
classe ouvrière.
Ils sont pour l'essentiel
élaborés dans le fil de J Réault,
De l’en soi au pour soi, le chez
soi.
Communication à
Bilan
réflexif d’itinéraires de
recherches en sciences sociales
;
Journées d'Habiter-Pips. Axe III
Amiens 5 décembre. une
pré-édition web (
e-publication) est
disponible à J Réault (Editeur)
Bilan réflexif d'itinéraires de
recherche en sciences sociales,
in
www.sociologie-culture.com
C'est
de loin la plus importante et la
plus nourrie des trois œuvres
posthumes qui sont désormais
avec celle-ci accessibles, avec
l'article Retour à Mauss, parue
in Y Guichard-Claudic, Ph
Lacombe, C. Papinot,
De
Bretagne et d'ailleurs.
Université de Brest 2004,
(Mélanges offerts à Anne
Guillou), et Ouvriers classe
ouvrière : entre déclin et
redéploiement, sa contribution à
P. Bouffartigue.
Le retour
des classes sociales,
inégalités, dominations,
conflits,
La Dispute 2004. Signe de liens
et de reconnaissance fort, es
auteurs et éditeur ont dédié
leur livre à JPM. Ce qui est un
élément de réponse à une de nos
questions.
Ce qui est d'ailleurs
tautologique car le mythe est
l'attribut organique de tout
grand sujet historique (ou
biographique d'ailleurs) et non
une sorte de maladie archaïque
que traitent avec mépris les
sociologues qui en se drapant
dans quelque parti de la raison
évolutive se montrent
radicalement inaptes à rendre
compte de l'épaisseur complexe
d'un réel
humain
non
modernisable
sous
peine de ne plus l'être
J Deniot, J Réault 2006 sur
www.sociologie-cultures.com
Emmanuel Todd,
Sur le malaise politique
français.
Fondation Saint-Simon. 1994. Et
l’illusion économique, essai sur
la stagnation des sociétés
développées. Gallimard 1998
D'autres couples antinomiques et
interrogatifs peuvent peut-être
plus dialectiquement l'exprimer
: - Cet essai constitue-t-il
comme un retour aux sources ou
un retour en arrière ? Un reflux
dans l'imaginaire ou une
résurgence du réel ?
L'avenir
d'une illusion
ou un
repentir de l'histoire
qui vit s'effacer dans les
sociétés centrales
les
classes sociales
issues
des deux premières révolutions
industrielles et qui étaient
encore plus ou moins constituées
politiquement à l'orée de la
mondialisation (1974-1984) ? Ces
formulations ne sont pour nous
exclusives ni dans leur
successions ni même au sein de
leur polarisation. Pourquoi
faudrait-il répondre dans
l'univocité tant à la complexité
d'une pensée qu'à celle du réel
? Pour ce faire point n'est
besoin de s'inscrire dans un
métalangage théorique radicalisé
par la sauvage fétichisation
d'une "rupture", - sommet de la
schizoïdie althussérienne-,
notre épistémè, autour des
concepts de
milieux, commun, populaire,
etc., se résume autour de la
formule fédérative de
lieux communs des sciences
sociales,
une "sociologie" véritable a
besoin de toutes les sciences
sociales donc d'un langage
transversal qui participe,
certes, sous réserve d'une
exigence de rigueur
particulière, des
mots de
la tribu,
( Mallarmé). Il y a dans cette
démarche une interférence avec
d'autres réflexivités critiques
des sciences sociales dont
celle de Michel Maffesoli autour
de la
connaissance ordinaire
(Méridiens 1985) qui reconnait
une dimension de connaissance
dans toute expérience sociale,
sous réserve peut-être,
d'ajouter, pour ce qui nous
concerne que c'est chaque fois à
éprouver en termes de forme et
de degré de connaissance
Les contemporains de la
genèse des
ouvriers
modernes
selon
l’expression classique des Marx
et Engels du Manifeste,
dans l'Angleterre du dernier
tiers du 18° siècle les
appréhendèrent comme une unité
historique nouvelle à
l'interférence de trois
déterminations théoriquement et
réellement différentes et dont
la confusion est jusqu'à nos
jours source de confusion jusque
dans la sociologie la plus
contemporaine, -
1°) la
prolétarisation
abusivement absolutisée en
prolétariat
(formule savante et/ou
assistantielle à l'origine, puis
idéologique), mais dont le
succès s'ancra dans les
caractères particuliers de
l'accumulation primitive
anglaise qui avait effectivement
engendrée, avant
l'industrialisation, un
prolétariat. La prolétarisation
en
revanche reste un concept non
idéologique si on en cherche les
indicateurs de formes et de
degrés, mais ce qu'il dénote et
pondère est transversal à toutes
les sociétés agies par
l'accumulation du capital et non
à un sous-ensemble fut-il
ouvrier.
-2°) le
travail
intégré
aux machineries de la naissante
grande industrie
de la première
révolution industrielle,
définissant des
producteurs
(parmi d'autres, artisans,
paysans, composantes à un autre
niveau de largement dé dans la
société) inséparablement de
valeurs d'usages et de survaleur
-
3° la stricte situation
hiérarchique et statutaire
d'exécutants
pour l'immense majorité, ce qui
n'exclut pas de grandes
variations dans
l'autonomie
pratique,
objet notamment de la belle
sociologie ouvrière de Pierre
Dubois, un des rares sociologues
à avoir sociologisé l'usine de
l'intérieur avec Joëlle Deniot
(autour du concept ouvrier de
coopération). Ces deux auteurs
mettent à l'avance en pièce la
tardive définition verticale de
M. Verret (salariés
d'exécution),
une de ses transitions, en y
réfléchissant de la "classe
ouvrière" au "bas". La
seule identification
indigène
et la
plus auto revendiquée (ouvrier,
working classe, Arbeiter,)
fait référence à la seconde
détermination, inégalement
solidaire de la troisième et
c'est dans la
fabrique (usine, factory...)
matrice de nouveaux collectifs
justement soulignée par ce qu'il
y a de sociologie transférable
dans le
Manifeste
communiste,
surgit l'identification
nominale dans un mot qui en
français reste, on l'oublie
trop, une perception sublimée et
non dévalorisée de leur activité
Œuvre, ouvrier, et à un niveau
de conscience de soi interactive
avec la conscience sociale
générale, classe ouvrière,
furent, au cours des
développements des révolutions
industrielles dans l'espace du
monde, universellement le
principal principe
d'identification collective au
point que dans la plupart
des
sociétés centrales
le mot de
travailleur
fonctionna comme quasi synonyme,
alors que, tant dans la réalité
que dans la conscience de soi la
prolétarisation, d'ailleurs
lentement surmontée jusqu'à la
veille de la mondialisation, ne
fut jamais un critère principal
et il ne pouvait évidemment pas
être un critère exclusif. Quant
au terme de
prolétariat,
il était devenu le marqueur
principal de l'idéologie
marxiste
et pire, des États qui
prétendirent s’en inspirer, et
fut privilégié comme principe
massifiant de perception que se
donnèrent les partis et les
états communistes.
Du travailleur libre au
travailleur libre ?
la classe ouvrière comme
parenthèse ?
Deux
révolutions industrielles
avaient tendanciellement permis
leur -toujours relative-
constitution en
classe,
comme
classe
ouvrière,
unité de
pratiques d'institutions et de
sens cependant toujours
partiellement hétéronome pour
les ouvriers existants parce que
disputée entre des fractions
ouvrières plus ou moins
durablement organisées
inégalement autonomes, les
appareils politiques et
syndicaux toujours ambivalents,
voire les États (?), qui
s'étaient proclamés leurs
représentants, différentes
fractions de l'intelligentsia
dans ou hors l'Université. Après
l'abandon quelque peu dans un
autre ordre de cette
représentation
pratique
(grèves, mouvements sociaux)
et/ou instituée, d'un
sujet historique
qui fut toujours et par
définition de son lien organique
( là le Marx de la section
VI du Capital est indépassable),
à l'accumulation du capital, à
géométrie variable donc toujours
inégalement
réalisée,
la mondialisation accéléra
la
transformation
des ex -
appartenant (?) de tous degrés
de toutes positions centrale ou
périphériques, de toutes formes
d'action et de "consciences" à
une
classe
ouvrière-
en
ouvriers,
personnes familles lignages. Des
sujets modernes
en l'occurrence ?
Ne
peux-ton dire, au vu de la
démanuélisation du travail
ouvrier et de la mécanisation du
travail employé voire expert, et
en considérant l'homogénéisation
populaire sociale et/ou
populaire commune des modes de
vie, que l'appellation ouvrier
est, y compris pour les
intéressés (sans négliger
l'effet interactif des
appellations maisons) est en
recul et pas nécessairement par
un effet de rapport social subi.
Pour passer à un niveau théorisé
d'une telle hypothèse, en
inversant d'une certaine façon
le propos tenu dans l'ordre
d'exposition du Capital qu'avec
la mondialisation les ouvriers
sans classe ouvrière font
retour au
statut générique de travailleurs
libres, salariés parmi d'autres
?
Ils vivent normalement d'abord
une vie privée durement conquise
quoique sans doute plus
intensément impliqués que les
salariés à statut hiérarchique
ou d'expertise scientifique, et
de toute façon spatialement
séparés, au sein de tissus
populaires variés unifiés
spatialement. Dans ces
milieux fortement
empaysés
(ancrés dans un territoire
immédiat), ils s'inscrivent dans
et s'identifient modalement de
façon tenace et contraire à
l'idéologie prolétarienne des
marxistes, comme peuples
national en même temps que
partie principale d'un peuple
social. Le local serait ainsi
par ce biais de l'expérience
populaire vécue, médiateur plus
qu'opposé au national. C'est
dans cette référence qu'à partir
environ de l'année charnière
orwellienne et symbolique de
1984, en majorité, contre la
majorité de leurs anciens
représentants politiques et ex
alliés intellectuels, mais au
sein de leurs hétérogènes
milieux de vie, ils s'engageront
parmi les plus tenaces
résistants à la
désouverainisation, cette pointe
aigüe des processus et des
politiques de la mondialisation.
Libérés du double mythe
stalinien de la "dictature du
prolétariat" par l'effondrement
symbolique de l'URSS et
l'obsolescence intellectuelle
morale et politique de leurs
représentants
qui les renient jusqu'à oublier
leur nom, c'est dans des
résistances doublement
empaysées,
localement et nationalement
qu'ils se sont principalement
situés. Loin de s'évanouir,
selon la description aussi myope
que malveillante qu'en donnera
la fraction de la sociologie qui
continue à invoquer leur passé
pour déconsidérer leur présent,
dans une passivité sociale et
politique, une démoralisation
« populiste » etc., ils
intègrent dans leurs
mobilisations le dense faisceau
des déterminations
contemporaines qui constituent
autant des contributions actives
à... que des effets de..., la
mondialisation. On citera pour
mémoire et sans aucune
exhaustivité - La rupture par
leurs organisations politiques
du contrat scellé jusqu'en
1983-4 avec l'État nation qui
avait imposé au capital
l'indexation de la croissance
au
progrès social (Aglietta,
A Brender,
Les métamorphoses de la société
salariale.
Calmann-Lévy 1984)
dont la hausse continue de
salaires, -la désolidarisation
active et très vite méprisante
des intelligentsias mutant en
classe culturelle
(E. Todd
L'illusion
économique)
mondialisées, la constitution
d'un nouveau
bloc historique
adverse (des partis de
gouvernement et des
intellectuels euromondialisés),
unifiée, selon les auteurs, par
la
pensée unique, la pensée zéro,
qui leur barre tout espoir
généralisé de hausse des
salaires interdites par
l'asservissement par Fr
Mitterrand du franc au
mark-rentier déflationniste,
tant au niveau largement dé
monnayé de leur établissement de
travail, qu'au niveau national à
l'issue de mouvements sociaux.
Entériner, avec ce
réalisme historique qui
constitue un élément structurant
de temps long des cultures
populaires, paysannes
artisanales et rurales d'abord
mais aussi largement ouvrière,
ce qui dans une conjoncture
historique
dépend
d'eux et ce qui n'en dépend pas,
ne signifie pas bien au
contraire, s'enfermer dans cette
amère nostalgie auquel les
réduisent l'ethnocentrisme de
classe et de scène de la
sociologie post-classe ouvrière
des années de la
mondialisation.
Une
théorie générale de la
mobilisation (la
société est contre nature,(Moscovici),
la
crise est première
(R.
Girard, P. Legendre, la culture
est (d'abord) un
système
de défense,
G Devereux, voire Marcel Maget)
A partir
du colloque du GIRI (1984,
Les processus de la mobilisation
sociale)
que nous avions personnellement
proposé et directement organisé
(et dont seules les
communications d’historiennes
sont éditées, d’autres le seront
par nos soins), la culture du
Lersco (sa composante
sociologique, intégra avec des
variantes personnelles le
concept de mobilisation pour
faire pièce à ce que nous
pensions être une tendance
logomachique dans l’utilisation
de celui de
stratégie,
que ce soit dans sa variante
économiste rationaliste ou dans
sa variante bourdivine cumulant
tous les désavantages du
dogmatisme de l’habitus et de
l’idéalisme idéologique. Le
texte de JPM revient en deçà de
cette critique après que MV se
soit rapproché du clan
disciplinaire des descendus de
P. Bourdieu. A l'encontre de la
réduction passéiste et un tant
soi peu condescendante de
l'ainsi-nommé Monde privé des
ouvriers
vus par Olivier Schwartz, nos
travaux et ceux de Joëlle Deniot
avec son
Décor
ouvrier,
la seule socio-ethnographe
conséquente de l'intimité
populaire, principalement
ouvrière, convergent dans ce
postulat que penser concrètement
les ouvriers réels passe par la
prise en compte des
mobilisations au sein même des
formes de vie ; leur
mobilisation principale est
devenue leur forme de vie elle
même, ce qui les a mis
finalement (ou en réalité
maintenus ?) dans le lot commun
des hommes (homines) et a fait
sortir ceux qui en étaient
englués, de la
condition
prolétarienne ; mais cette
irruption de réalités brise le
caractère exhaustif et le
caractère exclusif de la
définition distinctive d’une
« classe ouvrière » par . On
rappelle pour mémoire(dans le
fil de notre ouvrage
de
1989 , Formes de vie ouvrière et
écosystèmes sociaux de
reproduction,
Nantes, Lersco, o.c. les
éléments principaux d’une
grammaire générale d’une telle
approche. C'est à travers elle
que l'on peut penser -les
-mobilisations lignagères
familiales territorialisés en
tissus populaires restreint, -
les mobilisation
territorialisées en tissus
populaires larges, suburbaines
rurbaines rurales, - les
mobilisations économiques
nationales, l'hégémonie des
services matériels face à l'Etat,
- les mobilisation
d'établissements essentiellement
défensives, virtuellement trans-salariales,
et même - les mobilisations
syndicales et politiques où se
condense l'unité dialectique des
écosystèmes de reproduction
populaire et du national. C'est
sans doute dans la mobilisation
la plus sociétalement requise,
pièce maîtresse du roman social
de ce pays mais en même temps
structuration de sa
reproduction, l'ambition à
s'instruire, les mobilisations
scolaires, que la
survivance d'une vision de
classe unifiable des ouvriers se
trouve le plus radicalement mise
en défaut. Les fonctions de
cette scolarisation, à la fois
transmission virtuellement
égalisant et marquage statutaire
très intense en ce pays sont
d'entrée devenues radicalement
ambivalentes : vertueuses
tant que l'école transmit, elles
deviennent perverses par la
disqualification sociale de
l'absence de diplôme, qui,
instrumentalisée par les media
et les
classes
parlantes
françaises, voire plus largement
les classes culturelles
triturées par la presse des
années 80-90 ont induit, (sur ce
point E Todd de
l'illusion économique)
est irremplaçable),
l'antipeuplisme
et son instrumentalisation
politique, pour tenter de
promouvoir encore leur
descendance par l'accès à
l'Université, dans lesquelles
ils se trouvent ; la possibilité
d'y pourvoir les met dans une
assez radicale inégalité selon
leur qualification et
leur degré de prolétarisation
et
plus relativement au sein de
tissus territoriaux hétérogènes
selon les
écosystèmes sociaux
populaires de reproduction
où
ils sont insérés. Certes tous,
mais ils ne sont pas les seuls
subissant les effets de
l'abandon par l'institution
scolaire puis universitaire et
largement là aussi à
l'initiative de leurs ex
représentants, de la
transmission d'un haut niveau de
savoirs à l'échelle de
multitudes. Dans les années
80-90, derrière les plumes
venimeuses de la presse des
bourgeois maoïstes de 68, avec S
July, H Le Bras, A Lipietz,
etc., l'attribut populaire
historique de l'absence de
diplôme devient un marqueur de
leur sous humanité de peuple
indigne au vote déshonorant.
Ignoble retournement du handicap
relatif en pêché originel pour
le plus grand profit du parti
socialiste, jusqu'à ce que
l'histoire leur renvoie la
pichenette vengeresse de
l'éviction de Lionel Jospin, ce
grand liquidateur de l'école du
peuple en avril 2002.
__________
1999. L’Harmattan.
J Réault,
Formes de
vie ouvrière et écosystèmes
sociaux populaires de
reproduction.
Nantes Lersco 1989.
In, J Deniot, avec C Dutheil,
Crises et métamorphoses
ouvrières. L’Harmattan 1994.
E Todd,
L’illusion économique,
o.c. et P A Taguieff,
Résister au bougisme.
Mille et une nuits 1998.
Cet
antipeuplisme
est d'abord l'expression et
l'injonction du
haut
des scènes médiatiques et des
oligarchies
monopolisatrices des
centres, bobos
qui
titrait le Monde des 24 et 25
juin "font passer les villes à
gauche", - Gauche ? Tendance
mondialisation-. Il trouve son
complément apparemment paradoxal
dans le verbalisme gauchiste
universitaire de dénonciation du
peuple
et du
populaire,
méprisés réduits à l'abjecte
domination
sans appel et sans espérance de
la vulgate bourdivine dont le
succès, jusque sur les ondes de
BFM (Business FM) tient au
mélange de simplisme théorique,
une pensée binaire non
contradictoire à connotation
éthologique, et d'une langue
confuse et ampoulée qui
impressionne naturellement
l'inculture. . Et ce n'est pas
le seul terrain où les deux
anciens rivaux (les marxistes
orthodoxes irréductible ex
communistes et le clan bourdivin)
se sont, dans cette nouvelle
période, profondément
rencontrés- le
bas
et la
misère
mêmes
appas, - jusqu'à ce que leurs
héritiers mêlés forment le
l'appareil de pouvoir le plus
cynique et cruel de la lutte
pour le pouvoir les places et
l'argent dans la sociologie
instituée. Leur dénonciation du
dit
populisme
reste
cependant embarrassée voire
confuse, comme celle de l'Alain
Pessin du
mythe du
peuple,
tentant avec Bruno Péquignot,
lors du colloque
Les
peuples de l'art
(Octobre 2002 Nantes, Lestamp)
d'imposer un brulot à prétention
définitivement abolitionniste en
propos liminaire normatif.
L’édition des actes a
ironiquement repondéré leur
tentative en la reléguant en fin
d’un tome sous la rubrique
« déconstruction ». En revanche
il n'y a aucun état d'âme, sur
des scènes légitimes et de la
bien-pensance dénonciatrice du
populisme,
chez Pierre Rosanvallon,
l’idéologue principal - le plus
haineux en tout cas - de ce
mouvement d'abolition
scientifique
des
peuples. La cohérence est
radicale de celui qui fut de
surcroit un des inspirateurs de
la CFDT rompant avec le
mouvement ouvrier du premier
recentrage de 1978 jusqu'à
l'effondrement de 2003 et qui
signa dans
les lieux
de Mémoire
de Pierre
Nora l’article qui prétendait
désymboliser la souveraineté du
peuple obsession de toute son
œuvre. Mais c'est avec
La
nouvelle question sociale.
(Seuil 1995) que la clé de
cette pensée se livre avec une
théorie d'une raison sociale
réductible à la supposée
transparence darwinienne des
gènes prétendant annexer
la théorie de la justice de
Rawls et prôner cette
inversion
de l'égalité républicaine en
équité alias inégalité,
fondatrice d'un nouvel ordre
social totalitaire, comme
l'avait lumineusement montré Luc
Boltanski dans le célèbre
article
misère de
la philosophie sociale
(Le Monde
7 fév. 1995)L'antipeuplisme
théorique a dans les sciences
sociales également une
dimension de guerre civile
contre toute sociologie qui la
récuse : les héritiers du
Lersco non marxiste et
radicalement autonome à l'égard
de tout appareil politique dans
le Lestamp et d'abord la plus
illustre, l'auteure de deux des
références les plus achevées
d'une sociologie et d'une
anthropologie ouvrières,
La coopération ouvrière à
l'usine des Batignolles
(Anthropos 1984),
Le décor ouvrier
(L'Harmattan 1996),
l'éprouvèrent pratiquement sur
eux-mêmes et sur leurs
entreprises de recherche avec
une violence qui alla croissante
entre la mise au mur publique à
Nantes (28 janvier 2003) au nom
du fondateur du Lersco et de
quelques comparses, en janvier
2003, la privation de tout moyen
de recherche et de direction de
thèse, et le détournement,
matériellement découpé par ce
même fondateur, vers une
récupération
Grenobloise de tout un pan
d'œuvres au profit d’un
personnage médiocre et creux
devenu la nouvelle épouse
du maître du lieu en 2004, puis
son successeur après décès en
passant par une HDR ad hoc.
Classes
et problématiques de classes :
Marx est le théoricien et plus
modestement l'annaliste,
historien du présent, des
luttes de
classes
pas des
classes
dont toute
sociologie
s'inscrit dans un fixisme
bureaucratique, latent dans les
classes du Lersco et manifeste
dans sa dégénérescence en
reproduction
et
habitus
dans la vulgate bourdivine dont
la responsabilité est radicale
dans le déclin intellectuel de
la sociologie instituée. Si l'on
veut se donner une approche à la
fois extrêmement élaborée,
profonde et prudente de la
fécondité relative d'une
problématique de classes
et non de
classes entités nominalistes,
il faut lire et relire, des
historiens d'avant une
stérilisante sociologisation
mais, pour faire vite et fort et
sans trop se soucier de la forte
coloration structuraliste d'un
discours partiellement daté,
l'un des plus savants
interprètes contemporains de
Marx, pour qui la connaissance
des sociétés ne saurait se
réduire à une conception
disciplinaire bornée de la
sociologie, Nikos Poulantzas (Pouvoir
politique et classes sociales
Maspero 1975).
Une détermination de classe se
manifeste par
l’effet
global des structures d'une
formation sociale,
(complexe
singulier et historique de modes
de production, d'institutions de
langue d'ordre sociétal, etc.)
dans le domaine des rapports
sociaux.
Sachant que cet effet se
manifeste (ou pas) spatialement
et historiquement dans des
actions
(virtuellement ou manifestement,
politiques)
déclarées
de quasi groupes dont le degré
d'existence réelle, ne s'adjuge
que dans des pratiques réelles
manifestant l'effet
pertinent
de la
position
dans les rapports de production,
dans le domaine politique, comme
forces sociales,
parmi d'autres forces
sociales.
Cet effet global manifesté en
effet pertinent ne s'adjuge pas
a
priori
dans les agrégats économistes
d'une
classe en soi,
pur artefact de statisticien se
disant sociologue, mais dans des
actions déclarées
et des
déterminations éventuelles sur
l'ensemble des pratiques
(hypothèse de totalisation).
Le
tournant de la mondialisation
(1974-1984) et la fin des cycles
ouvrier
(Régis Debray) et
socialiste,
qu'entérina l'effondrement de
l'URSS
avec
un retard dû à l'inertie des
rapports sociétés-États, ne
signifient pas que de tels
effets tendanciellement
tous azimuts et
les
actions déclarées de forces
sociales
soient
devenus inexistants. Il est
notamment indispensable
d'éprouver heuristiquement
une
problématique de classe à
l'échelle de la mondialisation
(Guy Bois,
Une nouvelle servitude. Essai
sur la mondialisation
F-X de
Guibert 2003), c'est à dire
pensant l'interférence
contradictoire du processus mondialisateur et des sociétés
réelles modalement nationales.
Les configurations-actions de
classes continuent de s'adjuger
d'abord, ce qu'avait d'ailleurs
fortement affirmé le Marx du
Manifeste,
au sein des États-nations
affrontant les processus et les
politiques, internationales en
1848, mondialistes en 2008.
C'est cette approche qu'a
esquissée, par exemple Denis
Duclos avec le repérage d'une l'hyperbourgeoisie
mondiale
(Monde
diplomatique Août 1998), à base
évidemment principalement
centrale (américaine) reléguant
les bourgeoisies nationales dans
la même subordination que les
mondes populaires (plèbe
travailleuse et ensembles de
communalités culturelles et
politiques transclasses) et les
peuples (populi).
De la même façon on ne peut
penser désormais en termes de
sciences sociales (expression
plus fiable que l'étriquée
sociologie)
sans intégrer le développement
au sein des sociétés nationales
mais en plus ou moins grande
fusion mondialisée entre elles)
de
classes
relais
de l'hyperbourgeoisie mondiale
: les bourgeoisies
intellectuelles médiatiques et
institutionnelles des grandes
capitales travesties dans une
bien-pensance
de
gauche,
les
bobos
de
David Brooks. Sous réserve d'en
étudier les attributs plus
larges que le repérage purement
culturel de D.B., liés aux
conjonctures et situations
nationales, ces nouveaux
complexes de classes constituent
un objet d'étude indispensable,
adossées en France non seulement
aux media et à la monopolisation
de toutes les scènes sociétales,
mais à l'État
culturel,
avec une plus ou moins grande
hégémonie sur une plus vaste (et
conceptuellement plus floue)
classe culturelle, telle que l'a
définie Emmanuel Todd dans
l'Illusion économique.
Dans l'analyse de Poulantzas les
classes
qui ne
sont que des ensembles
dynamiques entre virtuel et réel
et à géométrie variable, ne sont
qu'une des manifestations
historiques de l'ensemble
logique plus large de
forces
sociales
trouvant hors l'économie, dans
la religion, les cultures
territoriales, etc. d'autres
bases à leur mobilisations
sociétales et ou politiques.
Loin de nous l'idée que la
fécondité qu'une telle
problématique
de classe,
dans un sens à la fois rigoureux
et souple, soit totalement
épuisée, sous réserve de
toujours la situer dans une
conjoncture historique et
spatiale (les
économies-mondes
de
Fernand Braudel, l'actuelle et
singulière
mondialisation),
singularisée. Mais cette posture
intellectuelle ne saurait
ressusciter les formes abolies.
Les ouvriers, pour autant que
l'on puisse les appréhender
unitairement, s'inscrivent
désormais au sein du travail de
l'emploi et surtout des formes
de vie modalement hétérogènes,
dans de vastes ensembles
transclasses que la
qualification de
populaires
nous paraît le mieux approcher,
sous réserve d'inventaires sans
fin (c'est cela une science
sociale : à jamais inachevée).
Supplémentairement à cette
approche théorique abstraite, un
indice politique fort de la
pertinence d'une telle
conceptualisation nous en semble
donné par la disqualification du
populaire,
des
peuples
et évidemment de leur
constitution politique comme
nations souveraines, de la part
des classes mondialisées et de
leurs relais (post ?) nationaux.
Cette disqualification est
active et manifeste depuis le
tournant de 1984 avec le
Vive la
crise !
, des
autoproclamées élites ex
de gauche
voire ex communistes ou
gauchistes,
version
soixante-huitarde.
Elle vaut pour les peuples et
cultures populaires. Elle vaut
pour ceux qui, dans les sciences
sociales s'inscrivent dans une
problématique qui refuse de
disqualifier à la fois les
concepts et la réalité charnelle
vivante des personnes dont les
attributs participent des trois
acceptions du populaire, la
plèbe travailleuse (l'essentiel
du salariat), les symbolisations
et valorisations relativement
communes transversales à de
multiples ensembles sociaux, les
peuples nations à vocation
souveraine dans l'anthropologie
qui s'origine dans le printemps
de 1789. (Extrait de J Réault,
Documents pour servir à la
communication aux journées
d'Habiter-Pips Axe III Amiens 5
décembre 2008.
Selon l’expression devenue
canonique et le livre de H.
Hamon et P. Rottman. Ramsay
Mac-Donald. 1984.
Voir
sur ces concepts nos
articles
Retour des peuples ?-I-
Les
milieux populaires du Non
français
d'avril 2005
Analyse
au vif des composantes du NON
français au referendum de
l'Europe des oligarchies.
Retour
des peuples II-
Peuple
politique Peuple social Peuple
sociétal, pour un lieu commun
des sciences sociales Essai
de
sociologie politique
Février
2009,
www.sociologie-cultures
Relaté sur des documents de
première main par François
Matheron - site web
Dir. J Deniot,
Libre
prétexte.
Disponible.
Où va la classe ouvrière
française ?
, Où va
le mouvement
ouvrier français ?, Où va la
culture ouvrière française ?
(Sociologie du travail 1989
-I-). La façon de titrer est
verretienne, - mais le rival de
la très officielle Documentation
française, Olivier Schwartz et
l'adversaire (J N Rétière),
n'avaient-ils pas déjà donné
l'exemple du mimétisme rival?-, à
ceci près qu'une salubre
modestie, peut-être leur a fait
abandonner la prétention
prophétique attribut divinatoire
du, seul, maître. JPM se range à
cette modestie conforme. On est
passé du devenir prophétisé à la
présentification quasi
tautologique. Mais de ce fait il
se coule, et tout aussi
littéralement dans une
référence, très officielle
(éditée en 1994 par la
Documentation française, après
l'effondrement socialiste de
1993, mais commandé en un temps
où la présence socialiste dans
l'État croyait encore utile de
se justifier par la
conscience philosophique
d'autrefois)
sous les plumes conjuguées J-N
Rétière et O. Schwartz, se
disant avec chacun leur modalité
de distance, hérétiques mais
restant fascinés par le
fondamentalisme de M.
Verret. L'anachronisme de
l'expression était déjà radical
et l’année même de l'édition, E
Todd l'avait magistralement
montré dans son essai sur
le malaise politique français
(Fondation Saint-Simon) ;
c'était désormais ce nouvel
ensemble pertinent "les classes
populaires" qui constituait la
forme et le pôle pertinent de la
contradiction sociétale
principale face aux dites
"élites" et dans les rapports
sociaux de la mondialisation.
Peut-être la classe
ouvrière
réduite au minimum du mot,
trouve t elle là dans cette
illusoire survie insufflée par
des intellectuels d'État, son
ultime mention
Il
est vrai que son commanditaire
travaillait parallèlement et
très activement à la disparition
intellectuelle et matérielle du
Lestamp de sa directrice (qu'il
fit coller sur une liste de
proscription dans sa propre
Université) et de l'auteur de ce
texte et que son action visible
s'était déjà manifestée à deux
reprises Par une tentative de
disqualification solennelle
du
populaire
du Lestamp dans le colloque du
GDR Opus (Les
peuples de l'art octobre
2002; Edition J Deniot A Pessin
L'Harmattan 2004) ), à Nantes
même, en ayant exigé la
communication inaugurale, menée
par son complice
et éditeur Bruno Péquignot et le
nouveau mari de sa dernière
entreprise de découpage dans le
vif (de l'œuvre de Joëlle
Deniot), Alain Pessin. Nous
avons (comme membre du comité de
lecture du livre, soigneusement
conservé ce texte d'anthologie
dans l'édition sous la rubrique
Déconstruction).
Et comme cela n'avait pas suffi
l'hallali fut tenté par une mise
au mur du lynchage public de la
directrice du Lestamp le 26
janvier 2003, avec la
bénédiction écrite de Michel
Verret et de ses amis. Jean-Paul
Molinari était encore vivant et
membre du Lestamp. Après la
délicate suggestion de devenir
cendre qui lui avait
personnellement été faite dans
ses Mélanges, et cet autre
exercice in vivo
de la scène capitale, l'effroi
qu'il nous manifesta était tout
sauf feint. Il n'en termina pas
moins son texte et le remis à
son commanditaire, trois mois
avant de disparaître.
Outre les références déjà
données supra, voir pour
l’exhaustivité de ces titres
l’article précisément écrit par
J P Molinari dans le Mouvement
social et intitulé La
sociologie de la classe ouvrière
de Michel Verret.
Le désastre scientifique des
SES.
L'invention de cette formation
finalisée sur l'enseignement
secondaire et très scolaire qui
par une dérive de l'institution
devint une vivier de recrutement
d'universitaires très formatés
devrait être interrogée comme
une des composantes de la crise
des sciences sociales
puisqu'elle donne un statut
sanctionné d'éminence
scientifique à des
enseignants
encore
supposés chercheurs qui se
réclament à la fois de
l'histoire, de l'économie, de la
sociologie, alors qu'ils n'ont
dans aucune de ces matières une
formation fondamentale achevée
dans le sens et les exigences où
on l'entend au sein de chacune
de ces disciplines, et dont le
recrutement favorisé par la
clôture idéologique fascinante
de leur propos, passe par les
réseaux de pouvoir des sciences
sociales des ENS et des IEP,
d’où semble avoir disparu le
critère scientifique de la
réfutabilité au profit de la
clôture systémique d’un savoir
supposé achevé, à l’instar de
l’illusion requise dans un
manuel d’enseignement
secondaire, mais
épistémologiquement désastreux
pour l’invention au niveau de la
recherche fondamentale.
Allons plus directement à notre
cible ici : l'immobilisation
mentale de ceux qui prétendent
encore vif ce qui est mort, et
les classes sociales d'hier
transférables dans les sociétés
de la mondialisation ne
signifient pas forcément
l'obsolescence définitive d'une
heuristique
de
classe.
Nous en traitons largement dans
la communication pour la Journée
Retour réflexif sur des
itinéraires de recherche
de l’EA
de l’Université de Picardie
Jules Verne, d'Habiter-Pips, Axe
III
Amiens 5 décembre 2008.
J Réault,
L’en soi, le pour soi, le chez
soi…
Ainsi
les
ouvriers nazairiens (de
l'aire d'emploi
de Saint-Nazaire) ou en
meilleure rigueur, y compris
marxienne certaines de leurs
actions collectives déclarées,
pourraient passer, comme "de
classe ouvrière". Il n'y a pas
pour contredire cela encore d’anatopisme
(Michel Tournier,
Vus de dos.
Gallimard.)
:
Saint-Nazaire, le jour en tout
cas, reste une des rares villes
authentiques,
c'est à dire microcosme relatif
de toute la société, avec
Saint-Etienne et Marseille, tant
que des peuples œuvrant mais
aussi, ouvriers
se
retrouveront dans ses chantiers
et qu'elle ne sera
pas ridiculisée par le "sur mer"
dont veut l'affubler, pour
singer du Nantes bobo de J
Blaise et J Marc Ayrault, la
réduction spectaculaire
marchande à l'image,
son maire post-chevènementiste.
Quant à l'anachronisme, la
mythique matrice, la fourme
comme on dit en Auvergne, des
paquebots des petits vieux
mondialisés mais aussi des
tankers d'un demi kilomètre, si
braudélienne dans sa civilisation
matérielle méprisant
Le
temps du
monde (A
Colin), n’a t elle pas la force
titanesque
de son propre temps ? Peut-être
même existent aussi (mais dans
quelles modalités spécifiques)
comme une "classe ouvrière"
coréenne, brésilienne en tout
cas de Sao Paulo ?) ? Quant à
"nos" Ouvriers
de l'Ouest de 1984,
ils étaient au bord du
basculement mondialisateur et
déjà on ne pouvait les décrire
que d'un côté ou de l'autre du
nouveau versant ; ceux que leur
conscience mobilisée tirait
encore vers l'être,
c'est à dire l'éternité,
glissaient tout aussi réellement
, et en toute -tragique-
conscience,
(contrairement à toute
définition distinctive
univoque), vers le non être,
dont tout admirateur du Poème de
Parménide, sait aussi, et pour
la consolation de toutes les
nostalgies, qu'il
est et qu'il n'est pas,
et que la connaissance ( y
compris philosophique), loin de
se définir exclusivement par la
rupture et la dénégation,
puise dans le mythe et dans la
poésie ?
Consulter les sites, www.
sociologie-cultures.com, et
www.lestamp.com.
I Wallerstein,
La Découverte.
Une nouvelle servitude. Essai
sur la mondialisation.
François-Xavier de Guibert. 2003
Monde Diplomatique
Une
nouvelle classe s’empare des
leviers du pouvoir mondial.
Naissance de l’hyperbourgeoisie.
Août 1998. Bizarrement,
pusillanimité ou lissage
politique, Denis Duclos n’a
jamais repris et valorisé son
invention, qui nous paraît
pourtant capitale, - et nous lui sous réserves
d’adaptation contemporaine sans
fin.
JR De l’antimondialisme à l’altermondialisme,
la question d’une servitude.
In Guichard-Claudic, Lacombe,
Papinot,
De Bretagne et d’ailleurs.
UBO.
Brest 2004.
Pour reprendre l'expression
d'Alain Bertho. C’est à nos yeux
un des rares sociologues qui
aient échappé aux paroles gelées
ou tordues concernant les
ouvriers perdurant au sein de
milieux populaires. Il a intégré
d'entrée la territorialisation,
solide garde-fou contre
le
déréalisme
idéologique. Son propos concerne
l’étonnante mutation de la
banlieue rouge
en banlieue,
( ou "quartiers"),pont-aux-ânes de beaucoup de
déversements pseudo-savants le
plus souvent induit par la
demande politique et médiatique
depuis le début des années 80.
Jacky
Réault,
Formes de
vie ouvrières et écosystèmes
sociaux de reproduction.
Nantes Cahier Lersco 1989.
ATP CNRS,
L’Ouest bouge-t-il ? Son
changement social et culturel
depuis 30 ans.
Nantes, Vivant 1983.
Mais qu’il avait interdit de
citer à l’auteur de la thèse
qu’il dirigeait et qui alla
jusqu’à emprunter littéralement
notre titre « ouvriers de
l’Ouest » (son livre est édité
par l’Harmattan sous le titre,
Sociologie politique d’ouvriers
de l’Ouest), sans la moindre
citation de notre ouvrage
pourtant devenu classique et
référentiel. (cf. Y. Lacoste, M. Phliponneau, Bernard Kayser,
Gérard Noiriel, J.R. Tréanton,
Pierre Naville, etc. Michel
Verret lui-même quand il n’en
fait pas en acte
manqué « paysans de l’ouest »).
Le plagiat est devenu si banal
dans certains placards de la
discipline
sous
l’autorité de nos anciens camarades
que dont nous avons trop longtemps
intériorisé la fatalité. La dame
qui a ainsi capté ce titre et ce
découpage d’objet s’est réfugiée
à l’extrémité la plus
occidentale de l’Eurasie sous
l’inspiration d’on ne sait quel
Tournesol. A
l’ouest, toujours à l’Ouest !
(Hergé, Le trésor
de Rackham Le Rouge)
Colloque international des 3,
4,5, décembre 2004, évènement
fondateur public du
Lestamp-Association, libre
société savante associative que
conquirent avec leurs seules
forces et revenus privés les
chercheurs refusant de briser
leur coopération intellectuelle
toujours féconde lors de la
liquidation autoritaire de l'ex
laboratoire d'Université en
1984, Le Lestamp. Édité en cdrom
par J Deniot et J Réault, The
societies of globalisation.
Nantes Lestamp 2007 et
disponible sur ce site
www.sociologie-cultures.com
Anne Réault
Etude de
mains d'après l'autoportrait de
Dürer
(Le Louvre) 2009.
La main humaine ou
l'unité anthropologique
totale(Leroi-Gourhan) des
arts, artisans, ouvriers,
paysans, artistes. Arts Cultures
et Sociétés Habiter-Pips Projet
quadriennal 2010 ne peut rester
emblématique du travail ouvrier
si souvent démanuélisé, ou de
multiples travaux supposés non
ouvriers remanuélisés et
mécanisés, que si on pense cette
unité intelligente cultivée qui
spiritualise toute pratique
humaine et que pourraient
symboliser ces mains de Dürer.
___________________
Où en est la classe ouvrière ?
Jean-Paul MOLINARI
2003
CLIQUER
29 juillet 2014
 bronze
de Françoise Marbleu image offerte à Jacky Réault à
l'occasion de la parution de bronze
de Françoise Marbleu image offerte à Jacky Réault à
l'occasion de la parution de
Joëlle
DENIOT Antigone MOUCHTOURIS Jacky REAULT
Eros
et liberté, Trois essais de sociologie et d'histoire
Paris Le Manuscrit Juillet 2014
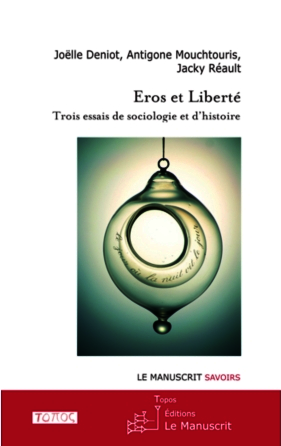
|